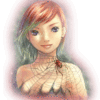-
Par djeser le 21 Février 2015 à 17:51
Mercredi 23 avril (suite)
D'après la carte, Saint Julien se trouvait à environ 70 kilomètres du Chalet des Iles, vers le sud. Deux routes étaient envisageables : l'autoroute à condition de savoir la quitter assez tôt et une route côtière - en tous cas plus près de la côte - qui contournait l'étang de Biscarosse. Ni Coralie, ni Larcher n'étaient jamais venus dans la région et partir à la découverte de ce dernier itinéraire ne leur disait rien. En conséquence, ils choisirent logiquement de reprendre la voie rapide. Comme dans un rallye, Larcher avait l'impression de se trouver dans la dernière ligne droite. Il était à présent à peu près sûr que Willy et ses compagnons ne cherchaient pas à leur tendre un piège, piège qu'ils auraient eu tout le temps de refermer déjà, s'ils l'avaient voulu, au Chalet des Iles dont la tranquillité leur aurait permis de monter toutes les machinations possibles. Il avait repris le volant et conduisait nonchalamment, fenêtre ouverte, sifflotant et commentant le paysage à son amie silencieuse. A quelque distance de la sortie qu'il avait soigneusement identifiée, il se contracta soudain en apercevant un véhicule qui approchait en sens inverse. Coralie le lui désigna du doigt sans prononcer un mot. Il s'agissait d'un camion qui, arrivé à leur hauteur, leur fit un appel de phares sur la signification duquel ils se perdirent en conjectures.
- Il voulait seulement nous dire bonjour, hasarda finalement Coralie. Il ne faut quand même pas voir des gens hostiles partout, non ?
Larcher hocha la tête sans répondre, heureux néanmoins que le camion se fut trouvé en sens inverse de leur route.
La petite ville de Saint Julien était évidemment déserte mais, dans les rues paisibles aux maisons bien alignées, il flottait comme un air de vacances, ce qui, étant donné la région, n'était au fond guère étonnant. Larcher arrêta le Range devant la mairie et, sans perdre une minute, le couple s'enfonça dans le bâtiment. Ils trouvèrent sans difficulté ce qui devait être dans le temps le secrétariat municipal. Il y avait effectivement deux placards à gauche de l'entrée de la pièce. S'étant avancée vers le plus éloigné, Coralie regarda Larcher puis, retenant sa respiration, elle l'ouvrit d'un coup. Il était totalement vide à l'exception d'un porte-document qui trônait en plein centre. Coralie s'en empara et le posa sur un des bureaux voisins. La serviette n'était pas très lourde. Il n'y avait à l'intérieur qu'un talkie-walkie et une feuille de papier qu'elle ne chercha pas à déchiffrer. Ils regagnèrent leur voiture.
La lettre était de Willy qui leur souhaitait la bienvenue et leur demandait de mettre en marche le talkie-walkie. Larcher le retourna quelques instants entre ses mains. C'était un engin plutôt volumineux, vraisemblablement d'origine militaire, qui devait porter assez loin. Les doigts un peu moites, il essaya d'obtenir un contact mais sans succès. Il insista, commença à s'énerver au point que Coralie le lui arracha presque des mains pour essayer à son tour. Elle eut la satisfaction d'entendre presque immédiatement la voix de Willy et, de façon inattendue, elle repassa sans répondre l'appareil à son ami.
- Julien, c'est vous Julien ?
- C'est bien Julien qui vous parle.
- Coralie est avec vous ?
- Je suis là, cria la jeune femme en se penchant vers le talkie.
- Bravo, mes amis, je suis heureux de vous entendre. Vous avez fait vite.
- Oui, mais pas sans mal. On vous racontera.
- Bon, je pense qu'on peut parler sans crainte dans cet appareil. Voilà ce que vous allez faire.
- On vous écoute Willy.
- Bien. Vous allez prendre la route de Contis. C'est la départementale 41. Vous la trouverez facilement : c'est celle de la plage. Vous la prenez et, à environ 6-7 kilomètres, vous trouverez un petit chemin sur votre gauche. Vous ne pouvez pas vous tromper : il y a un panneau avec une publicité pour Volkswagen à l'angle. Vous le suivez jusqu'au bout et vous trouverez une maison en haut d'une dune. C'est là. Vous m'appelez quand vous arrivez, d'accord ? Ah, j'oubliais. C'est fermé à clé et la clé est dans... (ils entendirent un bref conciliabule)... dans la boite aux lettres. Entrez, mettez vous à l'aise et appelez-moi. Heu, en principe, il n'y a pas de risque de faire une mauvaise rencontre mais soyez quand même prudents, hein ?
Ils n'eurent aucune difficulté à trouver le petit chemin si sablonneux et si défoncé que Larcher se sentit très heureux de piloter un 4X4. La maison, ancienne et isolée, se dressait effectivement en haut d'une petite colline qui dominait l'océan qu'on entendait, omniprésent. Larcher arrêta la voiture et regarda Coralie descendre fouiller la boite aux lettres, à l'entrée de la courte allée qui conduisait à la maison. Elle se retourna, agitant un trousseau de clés à la main, et Larcher s'empressa de la rejoindre.
La maison était une habitation de famille, très certainement un endroit réservé jadis aux vacances. Avec un soupçon d'imagination, on se serait presque attendu à voir des enfants dévaler à toute vitesse l'escalier pour se ruer à l'extérieur, vers la plage en contre-bas, un ballon ou une serviette de bain à la main. Des cris de joie devaient résonner ici il n'y avait pas si longtemps, les aboiements d'un chien ou la voix pressante d'une mère appelant les siens pour le repas qui refroidissait. A présent, la maison était silencieuse, s'éveillant à peine de son long silence hivernal pour accueillir une fois de plus des occupants pressés de profiter de son calme et de son dépaysement. Loin de la ville. Mais il n'y avait plus de ville et les nouveaux arrivants, pour un temps, allaient s'efforcer d'oublier là l'enfer qu'était devenu le monde extérieur. La maison le savait et on pouvait deviner qu'elle les aiderait du mieux qu'elle pourrait. Ils en firent le tour lentement pour apprendre à la connaître. Ni Coralie, ni Larcher ne parlaient beaucoup en parcourant sans se presser les pièces silencieuses, en montant l'escalier qui menait aux chambres, en regardant la mer par les fenêtres dont les volets avaient été ouverts en prévision de leur venue. Graves, ils se contentaient d'échanger quelques phrases brèves, quelques impressions fugitives, à voix basse. Ils éprouvaient une sorte de timidité face à ces murs étrangers qui avaient vu, au cours des ans, défiler des générations d'enfants qui s'étaient forgés là des souvenirs, ces murs qui avaient senti palpiter la vie d'une famille maintenant éteinte. Des drames peut-être, des moments de bonheur intense sans doute, avaient peuplé la maison et la rendait éminemment respectable. D'emblée, ils furent séduits par cette grande bâtisse si chargée d'une histoire qu'ils ne pourraient jamais partager.
Dans la salle à manger aux meubles de bois sombre patinés par les années et salés par l'océan, une main amie avait installé un vase débordant de fleurs multicolores et ce geste simple, le premier du genre depuis bien longtemps, émut Coralie plus qu'elle ne l'aurait avoué. Un petit mot qu'ils n'avaient d'abord pas vu reposait au pied des fleurs et leur signalait la présence, dans la chambre principale du premier étage, d'un matériel de CB qui devait leur servir à communiquer plus facilement avec leurs hôtes. Ils l'avaient remarqué lors de leur passage, quelques minutes plus tôt. On avait également préparé pour eux de quoi se restaurer. Ils en profitèrent bien qu'ils n'aient pas faim, pour l'unique raison que ce petit signe de bienvenue les touchait et qu'ils ne voulaient pas le perdre. Coralie, un verre à la main, s'approcha d'une marine qui décorait le couloir d'entrée et, se penchant pour observer un détail, interrogea Larcher.
- C'est vraiment sympa, ici, tu trouves pas ? Je pense que nous y pourrons y trouver enfin la tranquillité. Une sorte de tranquillité du moins. Tout de même, ce que je me demande, c'est pourquoi Willy ou quelqu'un d'autre ne nous y pas attendus. J'ai quand même assez envie de connaître ces gens. T'as pas envie toi ?
Elle s'écarta du tableau et, dans la lumière de la fin de l'après-midi, ses yeux bleus brillaient d'une lueur indécise. Il s'approcha d'elle et lui caressa gentiment la joue.
- Ben justement, il faudrait p't être lui dire, à Willy, que nous sommes bien arrivés.
Ils se dirigèrent lentement vers la chambre du premier. C'était une pièce grande et lumineuse, peut-être la plus belle de la maison, dont les deux fenêtres qui faisaient face au lit s'ouvraient sur la plage. Ils prirent le temps d'admirer la marée montante qui détachait son vert profond sur le ciel gris. La jeune femme laissa Larcher s'installer devant l'appareillage de CB qu'il commença à manipuler. Il n'avait en fait qu'à suivre les indications portées sur un carnet disposé bien en évidence sur un des côtés de la petite table. Coralie resta près de sa fenêtre. Elle n'arrivait pas à détacher ses yeux du spectacle paisible de l'océan. Elle avait toujours été attirée par la mer, par ces eaux immenses qui roulaient depuis toujours, indifférentes. Mais, aujourd'hui, elle discernait un élément nouveau dans cette fascination. A présent que la terre était devenue folle, que l'empreinte des humains s'en effaçait peu à peu, l'océan inchangé lui indiquait par sa proximité tranquille quelque chose de plus, un sens jusque là dissimulé. Il évoquait le pressentiment du caractère immuable de la nature humiliée, cette tonalité inaltérable, ce soupçon d'éternité, qui la réconfortaient au plus profond d'elle-même. La voix de Larcher qui s'essayait dans son micro l'arracha à sa méditation rêveuse.
Willy devait attendre leur appel car il répondit du premier coup.
- Je suis content de vous savoir là, mes amis, leur dit-il. Tout va comme vous voulez ? La maison vous plait ?
- C'est parfait, Willy. je crois qu'on va pouvoir se reposer ici parce que je ne vous cache pas que les deux derniers jours ont été pénibles. Vous savez, on aimerait bien vous rencontrer. Pour vous remercier de tout, bien sûr, et surtout aussi parce qu'on a hâte de vous connaître.
La voix de Willy sortait parfaitement nette de l'appareil. Il ne devait pas être très loin.
- Je comprends ça. Nous aussi, ici, on a hâte de vous rencontrer mais... Il faut que je vous raconte quelque chose. Vous savez, comme je vous ai dit, nous sommes maintenant une cinquantaine de personnes. Mais au début, nous n'étions que huit ou neuf. On est venus dans la région parce qu'un de nos amis connaissait. Il avait l'habitude de passer ses vacances par ici. Quoiqu'il en soit, peut-être, trois-quatre jours après notre arrivée, nous sommes entrés en contact avec des nouveaux, des gens que nous ne connaissions pas. Un couple avec un enfant. On a rencontré la femme presque par hasard. Elle nous a invités à venir chez eux pour faire plus ample connaissance. Comme elle paraissait assez sympathique et qu'elle et son mari désiraient rejoindre notre petit groupe, eh bien, j'y suis allé avec Alain et Marie-Claude, deux membres de notre groupe que je vous présenterai bientôt. En fait, nous avions été trop confiants. C'était un traquenard. Les gens qui nous attendaient... c'étaient certainement des Viraux. Très agressifs. Ils nous ont attaqués dès qu'ils nous ont vus, comme ça, sans raison. On s'en est tirés de justesse. Alors, depuis, nous avons décidé d'être un peu plus prudents et de laisser passer quelques jours avant de... Vous me comprenez ?
- Bien sûr que nous comprenons. C'est horrible ce que vous racontez. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces gens ? Ils sont toujours dans la région ?
- Nous sommes repassés une semaine plus tard parce que... pour voir... Mais il n'y avait plus personne. Disparus ! Volatilisés ! On n'a jamais rien su d'autre. Mais depuis cette histoire, on fait attention.
- Je comprends.
- Notez bien que j'ai confiance en vous, je vous l'ai déjà dit. Pas de problème là-dessus. Mais quand on a décidé d'une manière d'agir...
- Entendu, Willy. Coralie et moi, nous comprenons. Vous nous direz seulement quand...
- Oh, assez vite, Julien. De toute façon, on reste en contact au moyen de la CB. On pourra discuter plus tranquillement qu'avec l'émetteur et dans, disons quatre ou cinq jours, le temps de vous installer, on se donne rendez-vous pour faire définitivement connaissance, qu'est-ce que vous en dites ?
- Parfait pour nous. Je vous passe d'ailleurs Coralie qui a un mot à vous dire.
- Willy, je voulais vous dire, s'exclama la jeune femme, je comprends tout à fait votre prudence. On n'est pas à deux jours près. Vous savez, on vous racontera mais nous aussi nous avons eu des contacts, heu, difficiles alors... Mais c'est pas pour ça : je voulais vous remercier pour les fleurs. J'ai été très touchée...
- Les fleurs ? Oh, c'est Joy que vous devez remercier. Vous le ferez quand vous la verrez. Ah, excusez ma curiosité mais j'ai une chose à vous demander : finalement, vous veniez d'où ?
- De la région de Reims.
Ils entendirent Willy siffler de surprise.
- Eh bé ! Ca fait une sacrée trotte. Vous avez eu de la chance de passer. Vous devez être crevés !
- Surtout à cause de quelques mauvaises rencontres en chemin, précisa Coralie, mais maintenant ça va.
- Faudra nous raconter tout ce que vous avez vu, hein ? reprit Willy. Mes amis, je vous laisse vous reposer. Vous savez, aujourd'hui, je suis seul au micro mais demain je vous présenterai du monde. Et n'hésitez pas à appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. On s'arrange pour qu'il y ait toujours quelqu'un au standard.
Vendredi 25 avril
Du pied, il écarta la carapace d'un petit crabe mort et s'amusa à soulever un enchevêtrement d'algues rejetées sur la grève par la marée nocturne. Une bouteille en plastique, cabossée et presque totalement opacifiée par son séjour dans l'eau, restait accrochée aux plantes en un ultime témoignage. L'humble objet résisterait encore longtemps, bien plus que nombre d'entreprises humaines plus conséquentes. Le soleil de midi chauffait la peau de Larcher au travers de sa chemisette légère. Il étira les bras lentement et inspecta le sol à la recherche d'un endroit pour s'asseoir. Il choisit la lisière du sable sec et laissa errer son regard sur l'océan. Les vagues battaient sagement la plage mais leurs sommets se hérissaient de pointes d'écume blanche, sans doute le reflet lointain d'une tempête au large. La mer ne doit pas être commode, dans cet endroit, en hiver, pensa-t-il.
- Interdit de se baigner ici sans les maîtres-nageurs !
Comme si elle avait deviné ses pensées, Coralie venait de s'asseoir près de lui. Elle était pieds nus et arborait une robe colorée, à dominante bleue. Laura Ashley, se fit-il la remarque. Il se rendait compte que c'était probablement la première fois qu'il la découvrait sans ses habituels pantalons de jean. Elle dégageait une impression de féminité troublante, très désirable. Il lui entoura les épaules de son bras gauche.
- Très jolie robe, madame, remarqua-t-il.
- N'est-ce pas ? lui répondit-elle. Je l'ai trouvée dans une des armoires du haut. Sa propriétaire n'en a certainement plus besoin.
- Ca va ? interrogea-t-il au bout d'un moment.
- Ca va. Puis, après deux à trois secondes, elle poursuivit : je suis bien contente qu'on ait fini de décharger l’auto. J'ai enfin l'impression d'être arrivée chez moi, de ne plus errer au hasard, dans l'inconnu.
- Tu sais ce que nous a dit Pierre, hier soir ? Il a dit que, en tant que responsable du groupe pour l'installation des gens, il a choisi cette villa pour nous, affirma Larcher en désignant d'un mouvement de tête la maison, mais que si on veut, y en a plein d'autres un peu plus loin dans les terres. Et qui font aussi partie du territoire surveillé par eux.
- Qu'est-ce que tu en penses, toi ? T'as envie d'aller ailleurs ?
- Non, pour le moment, moi je suis bien ici.
- Moi aussi. J'aime bien être près de la mer. C'est la première fois, tu sais. Je veux dire, la première fois que j'ai une maison si près de la plage. J'aime bien.
Ils suivirent des yeux le vol aérien des goélands qui se poursuivaient en criant dans le ciel. Larcher se sentait enfin en paix avec le monde ou ce qu'il en restait. Il savait que rien n'était réglé, qu'ils auraient encore des moments difficiles mais, comparé à leur situation pas si ancienne de Paris, c'était le paradis ici. Et puis, il y avait les autres qu'ils ne connaissaient encore que par leurs voix mais qui lui plaisaient déjà. Il se pencha vers elle.
- Tu penses à quoi ?
Elle hésita avant de répondre.
- A Laurent.
- Il te manque ?
- Non. Enfin pas comme tu pourrais croire. En réalité, j'avais une grande admiration pour lui. Parce que c'était quelqu'un de très brillant, de très dynamique. Il était curieux de tout. J'avais de l'estime pour lui, tu sais, même si je dois reconnaître que je ne le comprenais pas toujours. Et c'est vrai que, par moments, j'avais l'impression qu'on était plus tout à fait en phase, lui et moi, qu'on avait des vies... comment dire ?... parallèles, avec des préoccupations différentes. Mais j'avais de la tendresse pour Laurent, tu comprends. Alors, quand je pense à la manière dont tout ça a fini...
Coralie avait baissé peu à peu la voix jusqu'à devenir inaudible pour Larcher qui était pourtant tout proche. Il serra la jeune femme plus fortement contre lui. Il revoyait le cadavre ensanglanté de l'homme dans la cuisine de Sainte Hippolyte et la fosse qu'il avait creusée dans l'obscurité, l'esprit en déroute. Il en frissonna malgré la douceur de l'air. Quand, le dernier jour, il avait sorti le 4X4 pour quitter tout ça, il avait vu Coralie fermer soigneusement sa maison à clé, dans un geste inutile qu'il avait parfaitement compris. Elle avait regardé autour d'elle pour une dernière vision de cet endroit qu'elle ne reverrait plus puis, de toutes ses forces, elle avait lancé le trousseau à travers les arbres comme pour une incantation au sort, une rupture définitive. Elle s'était alors avancée vers la voiture d'une démarche décidée mais, dédaignant la porte qu'il lui avait ouverte, elle avait fait le tour pour le rejoindre. Sans le regarder, elle avait demandé, la voix blanche : « Tu l'as mis où ? Laurent, tu l'as mis où ? ». Il l'avait conduite vers le bosquet et l'avait abandonnée à ses réflexions, à ses prières peut-être. Elle était restée seule quelques longues minutes. Ils n'en avaient plus jamais reparlé. Mais cela ne voulait pas dire, il le savait bien, que le souvenir de son mari ne la poursuivait pas. Même les moments les plus durs vécus par la suite, l'avenir si différent, ne pouvaient effacer le passé. Larcher, lui-même, s'était surpris plus d'une fois à repenser à Elisabeth qu'il retrouvait de temps à autre dans ses rêves. Il se revoyait dans cet hôpital où il l'avait abandonnée, impuissant. Cette pensée lui faisait mal et quand elle venait, toujours à l'improviste, il s'efforçait de la chasser le plus rapidement qu'il pouvait. Une fois, peu après leur départ de Sainte Hippolyte, il avait appelé Coralie du nom de son épouse. Terriblement désolé de son erreur, il avait adressé à la jeune femme un sourire affligé mais elle avait fait semblant de ne rien remarquer. Ces souffrances solitaires, autant que toutes celles passées en commun, le rapprochaient de Coralie, lui faisaient saisir combien elle était désormais proche de lui. Mais leurs souffrances, leurs peurs, leur solitude étaient finies. Tout ça était fini. Par moments, il avait du mal à s'en persuader. Ils étaient libres à nouveau. Libres de reconstruire ce qui pouvait l'être car il ne doutait pas que les gens qu'ils venaient de rejoindre allaient leur permettre de revivre. Différemment, évidemment, il y avait encore tant de problèmes... Mais, au moins, une certaine forme d'espoir était-elle revenue.
Il se leva en époussetant son jean et, se mettant en marche vers la maison, il lança joyeusement :
- C'est pas tout ça mais je commence à avoir faim. Tu casserais pas une petite graine ?
Elle attrapa le sac contenant le revolver dont elle ne se séparait jamais et le suivit lentement.
Dimanche 27 avril
D'emblée, Willy, grand gaillard barbu d'une soixantaine d'années, aux gestes rares et précautionneux, et ses acolytes, leur furent sympathiques. Ils en avaient besoin. Ils sentaient qu'ils auraient eu du mal à surmonter une nouvelle déception. Mais ce premier contact réel fut excellent. Le groupe, comme ils se nommaient eux-mêmes, avait élu domicile dans une grande ferme que Larcher et Coralie n'avaient eu aucun mal à trouver. Son appellation - 128 - qui avait tellement intrigué Larcher, venait de la borne métrique qui se trouvait devant l'entrée. La ferme était gigantesque, avec de volumineux corps de bâtiments qui entouraient une cour centrale encombrée d'un nombre impressionnant de véhicules divers. Elle paraissait aussi bien protégée qu'un château-fort du Moyen-Age et servait de centre logistique à cet embryon d'organisation dont ils souhaitaient tant faire partie. Ils passèrent une soirée au plus près de ce qui rappelait l'ancienne civilisation si proche encore de leurs mémoires, dans une grande pièce éclairée par la lumière presque naturelle d'un groupe électrogène. Il s'y pressait une foule d'inconnus souriants, et même quelques enfants, qui voulaient tout savoir de leur périple. Ils furent entourés, questionnés, félicités. On leur tapa sur les épaules en de multiples gestes de bienvenue; on leur offrit de petits cadeaux; on leur donna à boire et à manger des aliments rares par les temps qui couraient. En bref, ils furent reçus comme des amis, les parents d'une même famille que l'on retrouverait avec délice après des aventures inimaginables, des difficultés insurmontables qu'ils auraient réussi à vaincre. Dans cette agitation affectueuse, Larcher avait un peu l'impression de se perdre. De retrouver ainsi une apparence de société, tant de visages inconnus mais si hospitaliers, le saoulait presque et, plus d'une fois, devant cette gentillesse, il eut les larmes aux yeux. Le cauchemar était fini. On ne chercha d'ailleurs pas à évoquer les moyens de surmonter les problèmes de l'heure, de relancer la machine comme disait Willy : ce serait pour plus tard. Quand ils résolurent, à contre cœur, de regagner leur maison, le jour commençait à se lever. Pour une nouvelle journée placée enfin sous des hospices différents. Epuisés par leur nuit d'amitié, devant la maison de la plage encore obscurcie, Larcher et Coralie regardèrent le soleil se lever dans les terres. Ils ne parlaient pas mais chacun savait que l'autre pensait la même chose : un monde nouveau apparaissait enfin devant eux. Ils n'étaient plus seuls. La société repartait.
Tous droits réservés
copyright 943R3EB
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par djeser le 28 Février 2015 à 17:05
Lundi 28 avril
On pouvait voir la rue principale sur pratiquement toute sa longueur. Elle s'étirait, sans le moindre signe de vie, sur plusieurs centaines de mètres. Deux voitures aux couleurs rendues imprécises par une trop longue exposition à la pluie et à la poussière étaient paisiblement garées à l'entrée du village. L'enseigne à moitié arrachée d'un poste à essence battait par intermittence au vent léger. Toutes les maisons avaient leurs volets clos mais la porte de l'une d'entre elle, toute proche, entrebâillée sur l'obscurité obsédante de son intérieur, venait rappeler qu'il n'y avait plus nulle part de lieu inviolable à moins de le défendre les armes à la main. Limoges lui fit un léger signe de sa mitraillette et, sans se soucier de sa réponse, se mit à avancer lentement dans la rue, à la manière des commandos, courbé en avant, arme pointée droit devant et le regard dirigé vers les étages supérieurs des habitations. C'était un petit homme maigre, d'âge moyen, vêtu d'une tenue paramilitaire dépareillée qu'il ne quittait jamais. Taciturne, il ne s'exprimait que par quelques monosyllabes jetés comme à regret et toujours pour une raison très justifiée. Il s'était présenté à la ferme deux semaines plus tôt et, après les quelques heures d'observation de rigueur, avait été accepté sans autre formalité. Son calme et son ardeur à la tâche l'avaient vite rendu indispensable. On ne savait pas si Limoges était son véritable nom ou s'il l'avait choisi en souvenir de la ville et cela n'avait d'ailleurs aucune importance. Larcher lui emboîta le pas, deux mètres derrière lui. Il ne discuta pas ces précautions de guerre civile qu'en d'autres temps il aurait trouvées parfaitement ridicules. Dans le même instant, de l'autre côté de la rue, Zigzag et Stephie, une très jeune fille brune dont l'apparente jeunesse cachait une volonté de fer, s'avançaient lentement en rasant les murs. Arrivé à la hauteur de la porte entrouverte, Limoges fit signe aux autres de s'arrêter puis, d'un violent coup de botte, il envoya s'écraser le panneau contre la pierre. Se protégeant dans l'encoignure, il braqua sa mitraillette vers l'intérieur. Rien ne bougea. Une fois de plus, Larcher sentit une profonde nostalgie l'envahir à la pensée de ce qu'était devenu son pays. Ils descendirent le reste de la rue, toujours aussi silencieux et prudents. Limoges se tourna enfin vers ses compagnons et, d'une voix indifférente, déclara :
- Personne.
On aurait pu croire qu'il le regrettait presque. Zigzag haussa les épaules. C'était un individu étrange. Dès la première fois où il l'avait aperçu, Larcher avait ressenti à son égard un mélange d'attirance et de répulsion qu'il ne pouvait expliquer. Bien qu'il soit probablement assez jeune, on ne pouvait pas vraiment lui donner un âge précis. C'était peut-être dû à son physique curieux qui combinait une apparente fragilité sous la forme d'un grand corps très maigre, presque squelettique, décharné, et une dureté sous-jacente, une puissance à fleur de peau, la volonté de celui qui a connu tant d'épreuves, vu tant de souffrances, qu'il en est resté quelque part indifférent à tout. Le teint mat, il s'habillait toujours de noir, et arborait en toutes circonstances une casquette de base-ball ornée des seuls mots "Black Indians", noire elle-aussi. On avait expliqué à Larcher qu'il devait son étrange surnom au fait que, lorsqu'il conduisait une voiture, à chaque fois qu'il croyait discerner un élément suspect - reflet inattendu ou mouvement inhabituel - il tournait brutalement son volant de gauche à droite, en un geste inconscient destiné à le mettre à l'abri d'un éventuel projectile. Il mettait mal à l'aise ceux qui le connaissaient peu. Il se tourna vers les maisons qu'il contempla un bref instant avant de murmurer entre ses dents, comme pour lui-même :
- M'ouais. Je crois aussi.
Larcher sentit se relâcher la tension de ses muscles bien qu'il s'inquiéta sérieusement d'une éventuelle présence hostile retranchée quelque part au sein de ces pierres muettes. Les trois autres ne paraissaient pas s'en soucier. C'était sa première mission d'exploration avec le groupe. Joy leur avait dit que deux ou trois hommes vraisemblablement armés avaient été aperçus marchant dans la direction du village par une de leurs voitures et ils avaient décidé d'aller voir de plus près de quoi il s'agissait. Il laissa courir son regard sur les murs anonymes. Après son voyage éprouvant avec Coralie, il aurait préféré rester se reposer sur la plage et essayer d'oublier cette misère mais il comprenait aussi que ce genre d'expédition, pour dangereux et désagréable qu'il fut, était une des conditions de leur relative tranquillité, et peut-être aussi un moyen de le tester, lui, Larcher. La jeune fille brune lui toucha le bras en souriant.
- Alors, quelle impression ça fait d'être plongé dans la guerre ? lui demanda-t-elle. Parce que c'est la guerre, tu sais. Même si on n'est pas vraiment d'accord...
Zigzag venait d'entrer dans une petite boulangerie, un des deux magasins du village avec le Tabac-Buvette dont on pouvait apercevoir la civette intacte, un peu plus bas, de l'autre côté de la rue. Il en ressortit presque aussitôt et, devant l’œil interrogateur de Limoges, il crut bon de préciser :
- Allez pas là-dedans, c'est plein de cadavres !
- Hein ? Récents ? demanda Larcher alarmé.
- Mais non, répondit Zigzag, ceux-là, ce sont plus que des squelettes ou presque. Sont morts dès le début, probable.
Il riait de sa plaisanterie. Stephie, désignant le Tabac, proposa :
- Si on allait plutôt boire un coup la-bas ? On trouvera bien une ou deux boites de bière...
Le Tabac avait été vandalisé et ils eurent du mal à se faire une place au milieu du mobilier renversé, des débris de verre, des objets éparpillés par des mains avides de pillage. Poussant un petit cri de victoire, Stephie revint de sa recherche avec une demi-douzaine de bouteilles de soda. Larcher, assis avec ses compagnons autour d'une table bancale, se sentait infiniment plus à l'aise dans la petite salle dévastée qu'en terrain découvert.
- Vous avez eu souvent des problèmes au cours de ce type d'expéditions ? adressa-t-il à Zigzag
- Pas souvent heureusement, répondit ce dernier en reposant sa bouteille de Seven-Up. Mais, faut être quand même très prudent, on sait jamais ce qui peut arriver. Tiens, demande à Stephie, tu verras.
Larcher tourna les yeux vers la jeune fille dont le visage s'était assombri. Devant son silence, il s'apprêtait à changer de sujet quand, baissant la tête, elle reprit la parole d'un ton contracté.
- Il fait allusion à des écolos qui ont eu des ennuis, il y a trois semaines. On venait juste de rencontrer Willy et quelques autres. Moi, comme j'habite la région depuis toujours, je leur servais de guide pour trouver une baraque qui aurait pu nous convenir comme position de repli. Tu comprends, on était déjà une trentaine de personnes au total et on voulait se regrouper. Alors, à une quinzaine de kilomètres au nord d'ici, près d'Escource, un bled pas très loin de l'autoroute, on a vu une ferme qui aurait pu faire l'affaire. Mais, y avait déjà des gens. Des sortes de hippies, tu vois, l'homme, la femme et trois petits gosses. On n'a pas été mal reçus. Plutôt bien, même. Le type, c'était une caricature de John Lennon. Petites lunettes cerclées et tout le tremblement. Le genre on est tous des frères, faut profiter de la situation pour s'entraider, pour tout recommencer sur des bases nouvelles, etc. La femme, elle, elle était étrangère, une Suédoise ou une Allemande, je sais pas. Elle parlait pas français. Vachement gentils, les gens, en fait. Willy et moi, on a pourtant insisté, que c'était dangereux, qu'il fallait pas rester tout seuls comme ça. Mais le type, il souriait. Il disait qu'il voulait vivre en paix avec sa petite famille, qu'il voulait du mal à personne, qu'il avait pas d'armes parce qu'il aurait pas su s'en servir. Enfin, tout ça, quoi. Alors, on les a laissés, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse d'autre ? Mais, on a décidé de repasser plus tard, pour voir si tout allait bien. Je revois encore les gosses qui riaient quand nous sommes partis et les gens qui nous faisaient des grands signes d'adieu. Ils devaient nous prendre pour des cinglés, pour des fauteurs de guerre. Et puis on a trouvé notre ferme, le 128. On n'a plus repensé à eux pendant quelques jours. Le temps de s'organiser un peu, tu comprends ? Un jour, on devait aller de ce côté là et Willy nous a dit : "Si on allait dire bonjour à nos écolos pour voir comment ils se débrouillent ?". Hop, on y va. A deux kilomètres de leur maison, on a vu une fumée au loin. Mais une grosse fumée, hein, à tous les coups celle d'un incendie. Alors, on s'est approchés mais méfiants, tu peux me croire. J'étais sûre qu'il y avait du grabuge et, effectivement, d'un peu plus près...
Stephie se pencha vers le siège avant droit du Toyota où Willy, à l'aide d'une énorme paire de jumelles, cherchait à se faire une idée sur l'origine du panache de fumée noire qui tournoyait dans tous les sens, rabattu par des vents contraires. Elle lui désigna trois voitures qui s'éloignaient sur une route latérale. Willy lui répondit par un léger signe de tête et s'adressa à Presley, le conducteur, un vieux jeune homme chauve qui marchait en tirant la jambe, souvenir d'une mauvaise chute de cheval survenue des années auparavant.
- Ralentis et gare toi un peu plus loin. On continuera à pied.
Il se tourna vers l'arrière pour savoir si le deuxième véhicule, qui les suivait à distance, avait compris la manœuvre. Les voitures furent garées sur le bord de la route, tout contre l'entrée d'un champ encore protégé par une barrière soigneusement fermée. Les cinq hommes et la jeune fille se regroupèrent devant le capot du Toyota.
- On va voir ce qui se passe, commanda Willy. Bernard et moi, on passe par la gauche. Vous deux par la droite mais gaffe, hein ? Stephie et Presley, vous restez pour surveiller les voitures. En cas de problème, deux coups de klaxon, d'accord ?
- Non, moi, je viens avec vous, affirma Stephie d'un ton décidé.
Willy la fixa en silence deux à trois secondes puis reprit :
- OK, tu viens.
C'était la grange qui brûlait. Les flammes déjà hautes s'élevaient vers le ciel dans un crépitement assourdissant. La fumée intense était par moments rabattue dans la cour centrale. Toussant et crachant, Willy et ses deux compagnons virent les deux autres les rejoindre. Ils avaient contourné la ferme sans rien remarquer d'autre d'anormal. Willy se retourna vers la jeune fille.
- Steph, tu restes dans la cour et tu surveilles. Nous, on va voir à l'intérieur.
Les quatre hommes s'approchèrent de la porte ouverte. Appelant pour prévenir les occupants, Willy entra. La première chose qu'il vit en pénétrant, ce fut un tout petit chien blanc et noir étendu en travers, apparemment coupé en deux par un coup de hache. Il enjamba le misérable cadavre, revolver braqué, essayant d'accoutumer ses yeux à la faible lumière de la pièce. S'avançant lentement, il faillit glisser sur une immense flaque de sang, ne se rattrapant qu'au tout dernier moment. C'était une boucherie atroce. Devant lui, affalé dans le bas de l'escalier, le hippie était allongé jambes et bras écartés, couvert de tant de blessures à l'arme blanche qu'on avait l'impression d'une unique et gigantesque plaie. Le sang, abondamment répandu ne permettait plus de distinguer la couleur de ses vêtements. Chose incroyable, il respirait encore. Quand Willy s'approcha de lui, l'homme eut un petit mouvement de la tête comme s'il voulait dire quelque chose. Willy se pencha. Dans une espèce de croassement, l'homme essaya de parler mais on ne pouvait pas le comprendre. Il arriva quand même à chuchoter dans un ultime effort :
- Les enfants... Les enfants...
Epuisé, il ferma les yeux et s'immobilisa définitivement dans un spasme presque imperceptible. Willy ne pouvait plus rien pour lui. Il scruta du regard dans le désordre. Un peu plus loin, le corps dénudé de la femme était étendu, inerte. Avec horreur, Willy s'aperçut qu'elle avait été décapitée. Il se redressa au bord de la nausée et regarda ses hommes qui étaient restés pétrifiés près de l'entrée. L'odeur acre du sang rendait sa respiration malaisée et, pris de faiblesse, Willy sut qu'il devait immédiatement rallier l'extérieur. C'est alors qu'il entendit crier Stephie. Quand il sortit, muette d'effroi, elle désignait du bras la grange en feu. Au premier étage ouvert du bâtiment, les silhouettes de deux des enfants s'agitaient. Le bruit de l'incendie couvrait leurs cris et leurs pleurs. S'avançant le plus près possible, Willy hurla, imité par les autres.
- Sautez ! Sautez vite tout de suite ! N'ayez pas peur, on vous rattrapera. Vite. Sautez !
Un des deux enfants - on ne voyait pas le troisième - hésitait. En pleurant, il s'approchait du bord puis reculait. Durant un moment infime, le temps donna l'impression de se figer puis, soudain, dans un énorme appel d'air, toute la grange s'enflamma. Quelques secondes plus tard, elle s'écroulait dans une formidable gerbe d'étincelles. Willy se retourna vers Stéphie qui oscillait sur elle-même, au bord de l'évanouissement. Il la rattrapa de justesse. Il pleurait à chaudes larmes en la serrant contre lui et criait :
- Je les avais prévenus, merde, je les avais prévenus ! Pourquoi mais pourquoi ?
Bernard, un grand blond en chemise à carreaux, tentait d'expliquer aux autres qui avaient regardé impuissants cette scène abominable :
- Les salauds ! Les salauds ! Quand ils ont vu que les mômes étaient planqués dans la grange, ils y ont foutu le feu. Par pure saloperie ! Faut être vraiment dégueulasse pour faire ça, nom de Dieu ! Mais qui ça peut être ces ordures, putain !
- On saura jamais, répondit Willy. Ils sont loin à présent.
Devant tant de violence, il serrait ses poings de rage, jusqu'à en blanchir les jointures de ses doigts.
- Allez, il faut enterrer ces malheureux, poursuivit-il. On leur doit bien ça. Dire qu'à une heure près...
Stephie lui prit le bras en murmurant doucement :
- On pouvait rien faire, Willy. Ca serait arrivé à un moment ou à un autre, tu sais. Ils voulaient pas t'écouter.
Ils enveloppèrent les corps avec des couvertures trouvées dans une des chambres du haut. Assis sur le pas de la porte, Willy observait, consterné, les ruines de la grange qui achevait de se consumer. Stéphie s'était écartée et jouait machinalement du pied avec une pierre, les yeux fixés sur le sol inégal de la cour. Au moment où les deux autres hommes de Willy revenaient avec des pelles, Bernard, qui était resté dans la maison et qui furetait près de l'escalier, fit un bond en arrière et hurla :
- Willy, y a un mec, là !
Tous se précipitèrent. Un homme était effectivement étendu sous l'escalier, probablement abandonné par ses comparses dans leur fuite hâtive. Se sentant découvert, il s'avança vers eux en rampant, une jambe cassée. Willy s'approcha de lui en sifflant doucement.
- Mais on dirait qu'il s'est bien défendu, notre écolo. Il en a amochées quelques unes de ces ordures.
Il décocha un coup de pied à la forme étendue devant lui qui poussa un petit cri geignard. L'homme devait avoir environ vingt-cinq ans. Ses cheveux noirs collés de sueur lui tombaient sur les yeux et une terreur abjecte avait envahi son visage. Appuyé sur un coude, il regardait Willy en levant son autre bras dans un puéril geste de défense. Sans que personne ne lui ait rien demandé, il se mit à crier d'une voix aiguë, les mots se bousculant dans sa bouche au point d'en devenir incompréhensibles.
- C'est pas moi, je le jure ! Je voulais pas ! C'est les autres ! Y m'ont forcé ! J'étais leur prisonnier, je pouvais rien faire !
Dans l'espace confiné, le fracas de la détonation fut assourdissant. La tête de l'homme explosa littéralement, projetant des débris sanglants partout. Les oreilles sifflantes, Willy se retourna vers Bernard dont le pistolet fumait.
- Excuse, Willy, lança ce dernier, mais je pouvais plus écouter cette charogne.
- T'as bien fait, répondit Willy.
Larcher regardait par la fenêtre brisée du Tabac. Il en avait assez de ces horreurs, de ces scènes de cauchemars mille fois répétées. Pourtant, il semblait impossible de les éviter dans ce monde en folie. Quand ces tueries se termineraient elles donc ? se répétait-il. Stéphie avait baissé la tête puis, fixant à nouveau Larcher, elle poursuivit :
- Tu comprends pourquoi c'est la guerre ? Tant qu'il y aura des salauds comme ça qui se baladent... Willy dit que le pire, c'est de penser que ces gens sont des gens normaux. Pas des Viraux. Enfin, pas tous. Des salauds qui profitent du malheur des autres. Willy, il dit aussi qu'avant, ces gens-là, c'étaient des gens bien calmes, qui faisaient consciencieusement leur petit boulot. Qui avaient des femmes ou des maris, des enfants. Qui allaient avec eux en vacances au mois d'août et qui disaient toujours poliment bonjour à leurs voisins.
- Et qui cassaient aussi de temps en temps dans les banlieues, coupa Limoges. Y a rien de nouveau sous le soleil.
Ses trois compagnons le regardèrent avec surprise. C'était une des phrases les plus longues qu'ils lui aient jamais entendu dire.
Mercredi 30 avril
A deux kilomètres de l'embranchement, Larcher aperçut un véhicule qui venait à sa rencontre. Il freina puis arrêta le break Volvo qu'il rapatriait du 128. Il pouvait à présent mieux distinguer l'engin qui, à cent mètres environ, lui faisait face. C'était une camionnette rouge parfaitement inconnue. Son conducteur avait également ralenti puis, comme pris d'une inspiration subite, il relança son véhicule et, sans plus s'occuper de Larcher, le dépassa dans un emballement de moteur. Larcher regarda la camionnette disparaître dans son rétroviseur. Surpris de cette présence inattendue, il mit quelques secondes avant de réenclencher la boite automatique de sa voiture. Deux minutes plus tard, il s'engagea dans le chemin de terre, fortement secoué, comme il l'avait prévu, par les inégalités du sol. Au 128, il n'y avait plus de 4X4 disponible et il avait dû se contenter du seul break accessible. Il secoua la tête. Tant pis. De toute façon, la Volvo ne devait leur servir que de véhicule de secours. Au dernier tournant, il distingua la maison dont les fenêtres brillaient au soleil du début de l'après-midi. Tout paraissait calme, tranquille, et, pourtant, d'un coup, un pressentiment s'empara de lui. Leur 4X4 était toujours au même endroit, bien rangé comme lorsqu'il était parti une heure et demie plus tôt, mais Coralie, qui aurait dû guetter son retour, ne se montra pas. Son cœur s'accéléra quand il devina plus qu'il ne la vit la porte d'entrée grande ouverte, d'une manière tout à fait inhabituelle. Il ne prit que le temps d'arrêter son moteur et se rua vers la maison. Les chaises renversées, de la vaisselle brisée, confirmèrent ses soupçons. Hurlant de peur, il parcourut fébrilement les pièces du bas avant de s'élancer dans les chambres du premier étage. Là, tout était en ordre mais pas de Coralie. Au bord de l'évanouissement, agité par une angoisse extrême, il ressortit de la maison, tournant autour d'elle au hasard, dans une confusion totale. Il criait le nom de son amie mais seuls le silence et le bruissement du vent dans les arbres lui répondaient. Maintenant, il en était sûr, Coralie avait disparu. Enlevée, blessée, peut-être. Mais comment ? Par où les salopards étaient-ils arrivés pour qu'elle ne les entende pas, qu'elle se laisse faire sans se défendre ? Mais il était complètement stupide. Bien sûr qu'elle s'était défendue. Le désordre du mobilier au rez-de-chaussée était là pour en témoigner. Par la plage ? Ils étaient arrivés par la plage ? A moins que... La camionnette rouge ! Il y repensa soudain. C'était ça. Il s'appuya contre un des murs de la maison et passa une main tremblante sur son visage en sueur. Que faire ? Se lancer à leur poursuite. Tout de suite. Ils n'avaient pas beaucoup d'avance. Dix minutes, un quart d'heure à tout casser. C'était jouable. Il s'élança en direction de la Volvo dont la portière encore ouverte semblait l'attendre puis s'arrêta net. Prévenir les autres. Prévenir Willy. Sans savoir comment, il se retrouva au premier, face au matériel de CB. Ses doigts fébriles n'arrivaient pas à effectuer les manœuvres nécessaires. Enfin, au comble du désespoir, il entendit la voix de Joy.
- Joy, Joy, vite, préviens les autres. Coralie a disparu. On l'a enlevée.
- Hein, c'est toi, Julien ? Mais qu'est-ce que...
- On a enlevé Coralie que je te dis. A l'instant. Je crois même que j'ai repéré leur bagnole. J'y vais.
- Julien, attends. On arrive. Ne pars pas seul. Il faut absolument que...
- Préviens les autres. J'y vais. Tout de suite. Y a encore une chance... Vers le sud, merde. Vers Saint Julien.
- Non, attends...
Mais Larcher avait déjà rejeté son micro et s'était élancé dans l'escalier. Il ne prit pas la peine de refermer la porte d'entrée : qu'est-ce qu'il en avait à foutre à présent ? Un bond jusqu'à la voiture, puis, au dernier moment, il obliqua vers le 4X4, sûrement plus résistant et tout aussi rapide. Mais il n'en avait pas les clés. Pas le temps de fouiller la maison. Retour vers la voiture. Ensuite le chemin de terre à toute vitesse malgré les plaintes de l'automobile malmenée. Parvenu à l'intersection de la route, il ralentit, conscient tout à coup que, s'il voulait rattraper les salopards, il devait ménager son véhicule. Il regarda un bref instant la route déserte et s'engagea, désespéré, sur la droite. Il avait l'impression de revivre une scène passée. En réalité, il le comprenait à présent, malgré tout ce qu'il avait espéré, il n'était jamais sorti du cauchemar.
Tous droits réservés
copyright 943R3EB
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par djeser le 7 Mars 2015 à 15:37
Mercredi 30 avril (suite)
Durant près de deux heures, Larcher sillonna les routes de la proche région. Sans résultat. Il s'était tout d'abord lancé sans plus réfléchir dans la direction où il avait vu disparaître la camionnette rouge. Après avoir traversé St Julien totalement désert, il s'était enfoncé vers le sud, en direction de Bayonne. Il n'avait qu'imperceptiblement hésité au premier véritable embranchement, choisissant de privilégier la route la plus importante mais, au troisième carrefour, l'irrationalité d'une telle démarche le frappa : qu'est-ce qui lui prouvait que la camionnette était partie à droite plutôt qu'à gauche ? En réalité, il n'avait aucun moyen de le savoir. Il gara sa voiture pour réfléchir. Bien que son anxiété soit toujours extrême, il sentait se ralentir les battements de son cœur et son agitation se tempérer. Petit à petit, le désordre du début laissait la place à une froide détermination. Il n'était pas question d'abandonner ses recherches - plutôt mourir - mais il fallait raisonner. Il se pencha vers le vide-poche et se saisit de la carte routière locale qu'il y avait glissée quelques heures plus tôt sans alors se douter de ce à quoi elle lui servirait. Il l'examina attentivement. Un sentiment d'urgence l'habitait plus que jamais. Il savait que chaque minute qui passait rendait sa recherche plus problématique. Mais les premiers instants écoulés, ce n'était plus le moment de céder à l'improvisation. Il décida de parcourir l'ensemble des routes et des chemins compris dans un grand périmètre situé au sud de St Julien. Aucune autre raison à cela que le désir de faire quelque chose, d'être au fond à peu près certain que les salauds étaient partis plus loin. En cas d'échec, il serait toujours assez tôt pour aviser. Il démarra la voiture pour une exploration plus systématique et presque un quart d'heure plus tard, il eut l'impression, enfin, d'aboutir à quelque chose : alors qu'il s'approchait d'un petit hameau, il vit son pare-brise s'étoiler avant d'entendre distinctement le bruit d'une détonation. Poussant un cri de victoire, il freina si brutalement que la voiture s'arrêta en travers de la route. Il ouvrait déjà sa portière et, son fusil à pompe à la main, il sauta dans le fossé tout proche. Sans perdre de temps, il entreprit un long mouvement tournant destiné à l'amener derrière le ou les tireurs. Il espérait qu'il s'agissait bien des ravisseurs : ce serait ensuite à lui d'agir, par la force si nécessaire. Il n'avait aucun plan préétabli mais la perspective de les perdre à nouveau en allant chercher du renfort du côté de Willy lui était absolument insupportable. Il devait intervenir seul. Il mit plus de dix minutes à travers champs pour arriver à l'endroit voulu mais sa déception fut immense : le tireur était seul et ce n'était certainement pas un de ceux qu'il recherchait. Il s'agissait d'un très vieil homme qui, un fusil de chasse à la main, surveillait encore la route où Larcher pouvait deviner la silhouette immobile de sa voiture. L'homme se parlait à voix basse tout en furetant maladroitement dans une musette posée près de lui. La déception, la rage de Larcher furent telles qu'il épaula pour se débarrasser de ce gêneur, de cet idiot qui lui avait fait perdre tellement de temps. A l'ultime moment, malgré la colère qui l'aveuglait, un dernier reste d'humanité le fit tirer un peu en arrière de l'homme. Le vieillard poussa un cri de frayeur et s'aplatit dans l'herbe les mains sur la tête mais Larcher était déjà reparti. Le plus rapidement qu'il put sans offrir de cible trop évidente, il récupéra sa voiture et la relança sur la route sans entraîner la moindre réaction de la part de son ennemi involontaire.
Une heure et demie plus tard, il en était au même point. Aucune trace des ravisseurs. Pas la moindre tache rouge dans la campagne indifférente. La tentation était grande maintenant de retourner au 128, d'aviser avec Willy et les autres. Il avait d'ailleurs espéré les rencontrer au cours de son périple infructueux mais il devait être trop loin vers le sud. Il se gara le long de la départementale qu'il venait de parcourir dans les deux sens avec l'espoir de découvrir un chemin de terre quelconque, des traces, n'importe quoi. Epuisé, il consulta sa montre : presque cinq heures de l'après midi. Dans deux, trois heures au plus, ce serait la nuit. Le temps de retourner et il faudrait ajourner les recherches jusqu'au lendemain. Impossible d'abandonner Coralie à cette nuit pour elle de toutes les incertitudes. Si elle était encore vivante mais cette idée-là, il la repoussa avec force. Il lui fallait de l'aide. Rencontrer des gens malgré le danger. Obtenir des renseignements coûte que coûte. Quelqu'un avait bien dû voir passer cette saloperie de camionnette. Il revint à proximité de St Julien et arrêta une nouvelle fois sa voiture. Repartir de zéro. Tout recommencer. Il reprit sa carte, évalua les distances, examina sa jauge. De ce côté là, au moins, il n'y avait pas de problème : le réservoir était aux trois-quarts plein ce qui signifiait des centaines de kilomètres d'autonomie pour un diesel comme le sien. Le souvenir du sourire de Coralie lui brouilla la vue quelques secondes. Il retint sa respiration puis, d'un air décidé, enclencha le levier de vitesses. Plein sud. C'était ce qui lui apparaissait le plus logique. Territoires inconnus. Risques évidents. Mais risques calculés.
Il aperçut les premiers signes de vie depuis le vieillard au fusil de chasse une trentaine de kilomètres plus loin. Il était encore assez éloigné mais il avait nettement distingué des silhouettes qui s'engouffraient dans une villa, à droite de la route, probablement alertées par le bruit de son moteur. Il arrêta la voiture dans un chemin de terre et se risqua à pied en direction de la maison. Il avançait lentement, demi courbé, cherchant à rester au maximum à couvert. Heureusement la route était bordée d'arbres derrière lesquels il pouvait effectuer des haltes fréquentes pour observer le terrain. Il avait conscience de présenter, avec son fusil à la main et ses bonds successifs à la manière des troupes d'assaut, un aspect volontiers inquiétant mais il tenait à être excessivement prudent. L'épisode du vieillard lui avait servi de leçon. La maison était silencieuse, ses volets et ses portes bien fermés. Une fraction de seconde, il se demanda s'il n'avait pas rêvé, si les silhouettes qu'il avait cru apercevoir n'étaient pas seulement le fruit de son imagination et de son angoisse. Il sentait la fatigue dans ses jambes, le poids de l'arme à son bras droit. Il hésitait à rebrousser chemin. Retourner. Partager son inquiétude avec les autres. Réenvisager tout de manière plus sereine, plus systématique et probablement plus efficace. Au lieu de cela, il se redressa devant la porte et frappa distinctement. Aucune réponse. Il insista. Une voix de femme se fit entendre. Il ne s'était pas trompé. La maison était habitée.
- Qu'est-ce que vous voulez ? Passez votre chemin. On n'a pas besoin de vous ici.
- Un renseignement. J'ai besoin d'un simple renseignement, cria Larcher.
- J'sais rien, j'vous dis ! répliqua la femme.
- Je veux seulement savoir si vous avez vu passer une voiture. Une camionnette rouge.
- J'ai rien vu. Foutez le camp !
- Ecoutez, vous pouvez me renseigner. Je ne vous demande pas de m'ouvrir. Simplement de me dire si vous avez vu une camionnette passer. Une camionnette rouge, une Opel, je crois. Il ne doit pas y avoir beaucoup de circulation ici, quand même. Vous devriez vous en souvenir. Et qu'est-ce que ça peut vous faire de me renseigner, hein ? Après, je m'en vais, je vous le promets.
La femme parut hésiter avant de répondre.
- Bougez pas. Surtout vous cherchez pas à rentrer. Je vais demander à mon mari.
Larcher dut patienter un long moment. Si long qu'il se demanda s'il ne devait pas partir, chercher plus loin une aide moins difficile. Il était sur le point d'abandonner quand une voix d'homme relança le dialogue.
- Ouais. Alors c'est quoi que vous voulez au juste ?
Larcher dut reprendre ses explications. L'homme paraissait peu coopératif mais, en même temps, il ne donnait pas l'impression de vouloir abréger trop brutalement la conversation. Cela faisait plusieurs minutes déjà que Larcher faisait face à cette porte fermée et cette halte prolongée, alors que le temps fuyait toujours plus vite, commençait à l'inquiéter. Le bruit d'un moteur lui fit soudain comprendre la raison de ce dialogue absurde. Il se retourna brutalement. Quelqu'un manœuvrait sa voiture et lui avait déjà presque fait faire un demi-tour. Larcher en hurlant se lança à sa poursuite mais la lutte était parfaitement inégale. Il s'arrêta et tira sans espoir sur l'automobile qui s'éloignait. Impuissant, des larmes de rage aux yeux, il la regarda disparaître. On avait endormi sa méfiance. Pendant qu'il discutait vainement à travers la porte, fixé par l'espoir d'obtenir une indication, même vague, un complice s'était glissé par derrière et avait réussi à le voler. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Il y avait aujourd'hui autant de voitures disponibles qu'on le désirait. Pourquoi lui prendre la sienne ? Il retourna à la porte. La colère l'étranglait. Il avait du mal à trouver ses mots.
- Bande de salauds ! Qu'est-ce que vous voulez faire avec ma voiture. Rendez la moi, merde !
- Ta gueule, sale Viral, rétorqua l'homme. Ca t'apprendra à venir emmerder les honnêtes gens.
On sentait dans la voix de l'homme une joie malsaine. Il avait du mal à contenir un rire de satisfaction. Larcher était effondré. Il chercha à négocier, à s'expliquer.
- Mais je vous veux pas de mal, moi. Je voulais seulement un renseignement. Pourquoi vous m'avez volé ma voiture ?
- Et toi, pourquoi que t'es venu parlementer avec un flingue, hein, si tu voulais un simple renseignement ? Eh bien, je vais te le dire, mon pote. C'est parce que tu voulais nous buter. Comme tes autres potes, les Viraux. Tous des ordures. Tu l'as dans l'os, hein, maintenant ? Mais bouge pas d'ici, les gendarmes vont venir te cueillir. T'auras qu'à t'expliquer avec eux si t'es si malin.
- Mais, merde, j'suis pas un Viral, qu'est-ce que c'est que ce bordel ! Je suis à la recherche de ma femme, c'est tout !
- Ben voyons ! Maintenant, c'est plus une bagnole que tu cherches mais une bonne femme. Tu nous prends vraiment pour des cons.
Larcher ne savait plus quoi dire face à ce monument d'indifférence et de haine. Il fit une dernière tentative.
- Et c'est quoi, ces gendarmes, hein ? Des copains à vous, sans doute. Et qui font leur propre Loi, c'est bien ça, n'est-ce pas ?
- C'est ça, marre-toi. Attends donc qu'y z’arrivent, les flics. Des vrais gendarmes que j'te dis. T'auras qu'à leur signaler la disparition de ta femme, y sont là pour ça, poursuivit l'homme en riant méchamment.
Larcher se retourna vers la route. Elle était déserte mais, à en croire cet abruti, ses copains allaient rappliquer avec les plus mauvaises intentions du monde à son égard. Encore des soi-disant miliciens, probablement. Comment pourrait-il leur résister avec son pauvre fusil ? Il se dirigea vers les champs qui bordaient l'autre côté de la chaussée. Disparaître. Pour le moment, il n'avait que ça à faire. Pour la voiture, ce n'était pas grave. Il en retrouverait d'autres. Mais tout ce temps à nouveau perdu... Il en aurait pleuré de colère. Il sauta dans le fossé et s'enfonça dans la campagne. Droit devant lui, à quelques centaines de mètres, il distinguait un petit bois. Il aviserait la-bas.
Les deux véhicules blindés légers s'immobilisèrent doucement devant la villa. Leurs carrosseries bleutées paraissaient presque noires dans le jour qui faiblissait. Le commandant Bocquillon attendit une trentaine de secondes avant de faire signe à deux de ses hommes. Il sauta d'un geste assuré du véhicule et inspecta les environs. Son regard revint aux véhicules blindés. Flambants neufs, lavés de la veille, ils étaient superbes et, comme chaque fois qu'il était en opération, le commandant Bocquillon sentit une fierté et une joie intenses l'envahir. Après toutes ces semaines d'anarchie, de violences incontrôlables, les deux blindés, récupérés dans une caserne de gendarmerie près de Bayonne, représentaient à ses yeux le premier signe évident d'un certain retour à la normale. Et c'était lui, Gilles Bocquillon, simple ancien pompier volontaire de Castets, qui était indéniablement le principal artisan de ce renouveau. Pas sans difficultés d'ailleurs si l'on voulait bien considérer tout le mal qu'il avait eu pour constituer sa petite troupe en ces temps troublés. Mais il y était quand même arrivé. Sans doute, seulement une dizaine d'hommes mais des bons. Des hommes sur lesquels on pouvait compter et qu'il avait méticuleusement sélectionnés et entraînés. Le résultat ne s'était pas fait attendre : dès que l'on avait su - par un mouvement mystérieux de bouche à oreille - que l'ordre était revenu dans le territoire qu'il contrôlait et qui, d'ailleurs, s'étendait chaque jour un peu plus, les gens s'étaient regroupés. Quelques familles, quelques solitaires, tous parfaitement identifiés. Peu de monde suivant les critères anciens, c’est vrai, mais une population presque immense à l'échelle du pays abandonné. Et il le faisait respecter l'ordre. Les étrangers, du moins ceux qui ne créaient pas d'ennuis, devaient montrer patte blanche. C'était son rôle à lui. C'était sa responsabilité et il tenait à l'assumer du mieux qu'il pouvait. Il fit jouer les manchettes de son impeccable uniforme et, après un regard vigilant sur les deux hommes qui l'encadraient silencieusement, un pas en arrière de lui, se retourna vers la maison. Sur le seuil de la porte grande ouverte, un homme d'une cinquantaine d'années, en survêtement rouge, attendait, bras croisés, qu'il veuille bien lui adresser la parole. Le commandant Bocquillon s'approcha lentement de lui.
- Alors, monsieur Laffay, vous avez observé quelque chose de suspect ?
Comme s'il n'attendait qu'un signal, l'homme s'anima soudainement.
- Oui, mon commandant. Sinon, je ne me serais pas permis de vous déranger. Voilà, que je vous explique...
De ses propos tout à coup véhéments, il ressortait qu'un inconnu, vraisemblablement un Viral étant donné son agressivité permanente - il avait fait usage de son fusil à plusieurs reprises mais heureusement leur porte était solide - avait cherché à forcer l'entrée de sa maison. Il n'y était pas parvenu à cause de leur fermeté inflexible, à sa femme et à lui, et grâce aussi au courage d'un ami qui n'avait pas hésité à subtiliser sa voiture pratiquement sous les yeux du Viral qui n'avait alors eu comme seule ressource que de décamper.
- Vite fait, qu'il s'est tiré, le salaud, poursuivit l'homme. Là-bas, dans la direction du bois des Joliettes. Faut nous en débarrasser, n'est-ce pas, mon commandant ? Et n'hésitez pas à le descendre, hein ?
- On va essayer de vous le prendre, votre Viral. Comptez sur nous. On est là pour ça.
- Mais faut le descendre, c'te ordure, hein ? L'a essayé de nous tuer, moi et ma femme. Pas de pitié avec ces salopards, c'est moi qui vous le dis !
Le commandant Bocquillon fixa l'homme d'un regard sévère, presque méchant, qui fit taire son vis-à-vis.
- On s'en occupe, monsieur Laffay, je viens de vous le dire. A présent, c'est à nous de jouer. Ce soir, c'est un peu tard, il va faire nuit, mais demain il va danser, je puis vous l'assurer. En attendant, au moindre signe suspect, vous nous prévenez avec votre CB.
- Entendu, mon commandant. D'ailleurs, je...
Mais le commandant Bocquillon ne l'écoutait plus. Il fit un signe à ses hommes et remonta dans son blindé. A présent, il avait envie de retourner chez lui où l'attendait son dîner. Bien calé à l'avant du véhicule, il enleva son képi et se pencha vers le conducteur.
- Si je compte bien, ça fait trois signalements de ce genre durant les dernières vingt-quatre heures, n'est-ce pas, Cohen ?
- Heu, oui, mon commandant, trois.
- Sûrement pas le même à chaque fois. Eh bien, messieurs, on dirait que les affaires repartent. Demain, à cinq heures trente au Poste, pour le briefing. Tous. Nous avons du pain sur la planche.
Il se renfonça dans son siège. Il aimait bien qu'on fasse appel à lui. Au moins, dans ce monde pourri, il avait vraiment l'impression de faire oeuvre utile.
SUITE ICITous droits réservés
copyright 943R3EB
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par djeser le 14 Mars 2015 à 15:30
Mercredi 30 avril (fin)
Larcher n'était resté que quelques minutes dans le petit bois. Qui n'était d'ailleurs pas si petit que cela puisque ses pins semblaient s'étendre à perte de vue vers le sud et vers l'ouest. A peine le temps de se remettre un peu et de faire le point. Sa situation ne lui semblait pas si désespérée mais ce qui le chagrinait, ce qui l'épouvantait même, c'était le sort de Coralie, perdue quelque part au milieu de ces terres sur lesquelles rougeoyait encore le soleil couchant, à la merci de psychopathes inconnus. Il évaluait la distance qui le séparait de ses amis à une quarantaine de kilomètres c'est-à-dire un univers pour lui qui, à pied et sans repère, commençait à frissonner dans le jour déclinant. Son premier mouvement avait été de continuer sa recherche encore plus au sud, avec comme seul but avoué de ne pas perdre plus de temps, mais la vanité d'une telle tentative lui sauta malgré tout aux yeux. Il devait remettre à plus tard. Mais de quelle façon ? Avant toute chose, il lui fallait se procurer une voiture en état de marche. Pour la trouver, un seul moyen : se rapprocher d'une agglomération. Et pour cela continuer, tant qu'à faire, vers le sud. Qui sait si, en cherchant la voiture, il ne trouverait pas enfin quelques renseignements ? Appuyé contre un des premiers pins de l'orée de la forêt, il en était là de ses réflexions quand il entendit les moteurs. De l'endroit où il se trouvait, il pouvait facilement voir la route et la villa, source de ses ennuis. Quelques secondes plus tard, il distingua deux lourds véhicules qui s'arrêtaient devant la maison et, peu après, des silhouettes qui lui parurent militaires. Des gendarmes ou des policiers. Il n'en crut pas ses yeux. Durant un fragile moment, il pensa à un retour de la civilisation avant que les vieux réflexes ne s'estompent. Il haussa les épaules. Encore des cinglés déguisés en flics et qui jouaient aux petits soldats. Les blindés, toutefois, par leur apparente organisation, l'inquiétaient. Il n'attendit pas davantage et s'enfonça pour de bon vers les bois, attentif néanmoins à en suivre la lisière. Il progressait lentement. Il ne craignait plus les pseudo-policiers que, depuis longtemps, il avait laissés derrière lui mais il était fatigué et il avait soif. Son fusil, son seul ami maintenant, lui pesait. Avec inquiétude, il voyait la nuit gagner le paysage et il avait à présent du mal à éviter les pièges du terrain. Il décida de se rapprocher de la route. Quelques maisons distinguaient vaguement leurs silhouettes devant lui et il envisagea d'y trouver refuge. Hélas, elles étaient occupées, des lumières tremblotantes, des bougies peut-être, en témoignaient. Il dut laisser le hameau derrière lui. Trop dangereux. Malgré la douceur relative de la nuit sans lune, il avait froid. Il pensa à sa parka oubliée dans la Volvo mais comment aurait-il pu prévoir... Depuis une dizaine de minutes, un petit crachin rendait sa progression très pénible. Il se heurta à la clôture avant de la voir et faillit tomber lourdement. Dans l'obscurité, il distingua la masse sombre d'une habitation. Il resta un long moment à observer et à écouter. L'endroit semblait désert. Son état d'épuisement était à présent si intense qu'il lui fallait absolument faire halte. Il se risqua dans la maison dont la porte baillait. Pour la première fois, il s'autorisa à utiliser la petite lampe de poche dont il ne se séparait jamais et il balaya la pièce, une sorte de grande salle à manger. Désordre indescriptible. Tout était sans dessus dessous. Cela lui aurait été bien égal s'il n'avait également aperçu dans un des coins, tout contre la cheminée, deux cadavres d'hommes totalement décomposés. Il détourna puis éteignit le faisceau lumineux. D'un coup, l'odeur de moisi, omniprésente, lui assaillit les narines. Il ressortit rapidement et se dirigea vers la grange attenante qu'il avait entraperçue en arrivant. Elle semblait plus hospitalière et il y trouva même quelques bottes de foin. Il s'y laissa tomber. Il pensa à explorer la maison à la recherche d'une couverture, peut-être d'un peu de nourriture, mais sa fatigue était trop forte. Il plongea dans un demi-sommeil agité, peuplé de fantômes et de bruits. Il crut même entendre des voix se renvoyant des ordres. Réveillé en sursaut, il écouta attentivement mais ce n'était que son imagination malade. Seul le crépitement monotone de la pluie se faisait entendre. L'orage s'était aggravé et il se félicita de son abri improvisé. Il réinstalla le foin sur lui et se laissa glisser vers ses rêves tristes.
Jeudi 1er mai
Pendant près d'une heure Larcher observa avec attention la petite maison isolée. Depuis le départ d'un homme, un bon moment auparavant, plus rien n'avait bougé. La maison était pourtant occupée puisque, du seuil, une femme avait regardé l'homme s'engouffrer dans la voiture qui stationnait dans le petit jardin. Il aurait dû s'emparer de l'auto, il le regrettait amèrement à présent, mais il avait trop hésité, se demandant si, malgré les conseils de Limoges dispensés longuement quelques jours plus tôt - mais cela paraissait tellement loin - il saurait démarrer le moteur sans les clés. De plus, il n'était pas tout à fait sûr que le véhicule ait été en état de marche et il avait eu peur de se faire repérer pour rien. L'homme lui avait démontré combien il avait eu tort. Quoi qu’il en soit, bien trop tard.
Après une nuit peuplée de cauchemars multiples et aussitôt oubliés, il avait quitté la grange presque aussi fatigué que la veille, sans même vouloir explorer la maison voisine. Il était persuadé de trouver ce qu'il voulait plus loin. Erreur : les rares maisons habitées donnaient l'impression d'être bien surveillées. Quant aux autres, volonté délibérée ou malchance de sa part, elles ne contenaient rien d'utile pour lui. Il avait avant tout besoin de nourriture - presque vingt-quatre heures qu'il n'avait rien mangé et, en dépit de sa peur, son estomac criait famine - et d'un moyen de transport. Il pensait sans arrêt à Coralie que, par sa faute, il avait abandonné à son sort. Il espérait que Willy et les autres avaient pu la récupérer mais il en doutait. Un bref instant, il envisagea de tout simplement sonner à la porte de la maison et de quémander un peu de pain. Peut-être même la femme, si elle n'était pas trop hostile ou trop effrayée, aurait-elle pu lui donner un renseignement, lui dire à qui s'adresser. Mais, un peu plus tôt dans la matinée, il s'était désaltéré à un puits, dans un petit village désert, et il avait alors aperçu son reflet dans une vitre : il était à faire peur. Pas rasé, les cheveux collés, les vêtements maculés de boue et de poussière. N'importe qui de sensé lui tirerait dessus avant de discuter. Non, d'abord, manger un peu, n'importe quoi, puis investir une maison abandonnée pour changer de vêtements et faire un brin de toilette. Mais d'abord manger. Il s'arracha de la haie où il s'était tapi et décida de contourner la maison. Il s'approcha d'une fenêtre de derrière. C'était une cuisine et il put y distinguer la femme qui marchait de long en large. Elle parlait à quelqu'un qu'il ne pouvait pas voir. Il lui fallut se pencher un peu plus, au risque de se faire repérer, pour découvrir une petite fille d'une dizaine d'années qui, assise à une table, tournait les pages d'un grand livre. Pas d'hésitation, il devait entrer : qui savait au bout de combien de temps l'homme allait revenir ? Il se glissa vers la porte vitrée qui n'était pas fermée. Il surgit brutalement dans la cuisine, le fusil en avant. De surprise, la femme qui faisait face à la porte laissa tomber les couverts qu'elle avait à la main. Dans le silence soudain, le bruit de la chute fut énorme. Larcher porta un doigt à ses lèvres puis en avant de lui, dans un geste futile d'apaisement. Il tenait le fusil de l'autre main, le canon dirigé vers le sol, incapable de menacer directement la femme.
- Chut, pas un bruit. Je ne vous veux aucun mal, arriva-t-il à murmurer.
La femme devait avoir une trentaine d'années. Blonde et élancée, elle semblait plus jeune qu'il ne l'avait cru en la voyant plus tôt devant sa porte. Elle fit un pas en arrière, sans prononcer la moindre parole, et s'appuya contre un placard. La petite fille, toujours assise, le regardait, pétrifiée. Il pouvait distinctement apercevoir ses pupilles dilatées par la surprise et la peur.
- N'ayez pas peur, reprit Larcher. Je veux seulement manger quelque chose. Vite. S'il vous plait.
Comme la femme ne répondait pas et restait immobile à le regarder, il leva son fusil. La petite fille poussa un cri de terreur et se leva d'un bond, renversant bruyamment sa chaise. La femme l'attrapa d'une main et la serra contre elle. Elle avait hurlé son prénom, Aurélie, d'une voix blanche, assourdie par l'angoisse. Larcher était sincèrement désolé d'entraîner, par son apparition brutale et son aspect qu'il savait effrayant, tant de crainte, cette terreur indicible dans un monde où l'on pensait à juste titre que de l'inconnu ne pouvait venir que le pire. Mais il n'avait pas le choix.
- Allez, exécution, reprit-il d'un ton plus ferme.
La femme sortit enfin de sa léthargie et, les gestes raides, l'enfant toujours serrée contre elle, elle se tourna vers le placard d'où elle sortit du pain, des restes de poulet, un véritable festin pour Larcher qui en salivait à l'avance. Assis à la table, il attrapa la nourriture à pleines mains, le fusil sur les genoux, et put assouvir sa faim taraudante. Du coin de l’œil, il surveillait la femme qui s'était ressaisie et s'était assise sur un tabouret lui faisant face, la petite fille debout contre elle, le visage enfoui dans ses cheveux. Étrangement, Larcher trouvait presque amusante cette situation, le pouvoir qu'il exerçait sur les deux pauvres créatures. Sans qu'il le lui demande, la femme se leva sous son regard méfiant et lui tendit une bouteille d'eau. Le geste, par sa simplicité, le détendit et il chercha, par de courtes monosyllabes, à se justifier, à expliquer ses propres ennuis, ses recherches, ses peurs. Il se rendit compte que c'était la première fois depuis bien longtemps qu'il pouvait se confier ainsi à un être vivant et, d'une certaine manière, cette espèce de confession lui faisait du bien. La petite fille le regardait par instants à la dérobée, comme on le fait de quelqu'un d'intimidant mais de plus vraiment effrayant. La femme, elle, hochait la tête comme pour lui signifier qu'elle le comprenait, qu'elle ne lui en voulait pas.
La voix d'un homme qui appelait du devant de la maison les figea tous les trois. Larcher repoussa sa chaise et reprit son fusil en main.
- C'est Loïc, mon ami, chuchota la femme. Je vous en supplie, ne lui faites pas de mal...
D'un geste impatient de la tête, Larcher la fit taire. Il n'avait pas entendu de bruit de moteur mais sa concentration sur les deux femmes expliquait peut-être cela. Des pas puis, de nouveau, le même nom :
- Émilie ? Où tu es ?
La femme fit un mouvement mais, une nouvelle fois, Larcher l'arrêta du regard. L'homme surgit à la porte du couloir. Grand, blond, dans la force de l'âge, il était habillé d'une sorte de grand caban gris qui lui conférait une vague allure de marin. Il s'immobilisa sur le seuil de la cuisine. Larcher s'était levé et, d'une voix sèche, il lui cria :
- Par ici, mon vieux, et pas de blague.
- Ne lui faites rien, hurla la femme, toute sa terreur du début revenue. La petite fille s'était mise à pleurer en regardant l'homme immobile.
- La voiture. Prenez les clés de la voiture. On en a une dans le garage juste à côté. Je vous en supplie mais laissez nous tranquille... hurla la femme en sanglotant.
Extraordinairement vigilant, Larcher se laissa conduire jusqu'au garage sans perdre un instant de vue ses trois otages. Un vélo, appuyé contre l'entrée de la maison, expliquait l'arrivée silencieuse de l'homme. Trois minutes plus tard, Larcher était au volant d'une grosse Mercedes noire dont le moteur démarra à la première sollicitation. Il lança brutalement la voiture sur la route. Dans son rétroviseur, il pouvait voir ses trois hôtes involontaires qui n'esquissèrent pas le moindre geste. Il ne se détendit que quelques centaines de mètres plus loin. Il était assez satisfait de la tournure des événements. Il ne regrettait pas la peur qu'il venait de causer. Tant pis pour eux. Ils n'avaient qu'à être plus méfiants. Qui sait d'ailleurs si son apparition inattendue n'allait pas leur sauver la vie, plus tard. Et puis, il n'y avait eu finalement aucune violence réelle. Larcher n'arrivait pas à croire à sa chance et il se mit à siffloter de soulagement. Maintenant, Coralie. Mais avec Willy et les autres, ça, il l'avait compris. Définitivement compris.
Penché vers son fusil qui menaçait de tomber du siège avant, il ne vit que du coin de l’œil, l'énorme masse qui se jetait sur sa voiture. Le choc fut terrible. Dans un énorme craquement de métal et de verre, il eut l'impression que la Mercedes était projetée en l'air. Il eut le réflexe de s'accrocher au volant et à la poignée de la portière ce qui lui évita d'être éjecté. Il se retrouva couché en travers de la banquette avant et mit plusieurs secondes à recouvrer ses esprits. Sa surprise était totale. Quand il se redressa, son véhicule s'était immobilisé de travers, sur le côté droit de la route, et il put voir une fumée bleutée sortir de son capot déchiqueté. A quelques mètres de là, lui faisant face, un petit camion lui exposait sa calandre fracassée. Durant quelques secondes rien ne bougea. Larcher n'arrivait pas à comprendre, ni même à réaliser la présence de ce véhicule inconnu qui paraissait sorti du néant et qui, sans le moindre doute, était venu le heurter volontairement. Il avait dû surgir du chemin dont il apercevait l'entrée boisée sur la gauche. Quelque chose bougea derrière le pare-brise du camion. Un homme cherchait à sortir et secouait désespérément la portière. Sans réfléchir, Larcher sauta sur sa propre portière qui - miracle - s'ouvrit sans effort. Il se laissa tomber sur le bitume, s'abritant derrière l'épave de la Mercedes. C'est seulement alors qu'il entendit les inconnus. Celui qui avait réussi à sortir s'était mis à hurler :
- Tu vois bien, connard, que c'était pas Loïc ! On va s'le faire ce fumier...
Malgré l'intense mal de tête qui l'assaillait, Larcher se mit à ramper, le fusil pointé vers les inconnus. Celui qui s'était extrait du camion, un homme corpulent à l'abondante chevelure blanche, se redressa lentement pour chercher à évaluer les dégâts et à l'apercevoir. Larcher ne lui en laissa pas le temps. Par dessous la portière ouverte de la voiture, il épaula et, presque sans viser, il appuya sur la gâchette. A travers la fumée, il vit l'homme se redresser brutalement et porter ses mains à sa poitrine qui rougit instantanément. Un étonnement sans borne, une incrédulité totale marquaient son visage comme s'il ne pouvait pas croire que cela puisse lui arriver à lui. Titubant, il fit trois pas en avant puis s'écroula d'une seule masse, face contre terre. Durant deux à trois secondes, Larcher contempla, hypnotisé, la main droite de l'homme qui avait laissé échapper son revolver et qui griffait désespérément le sol. L'autre inconnu se mit alors à hurler et le pare-brise du camion explosa tout à coup quand il déchargea son arme au hasard, dans un geste de terreur absolue. Sans plus attendre, Larcher se redressa et se rua vers le bas-côté du plus vite qu'il le put. Il sentit un impact à son épaule gauche et la réalisation soudaine qu'il venait d'être touché par un éclat quelconque le fit se jeter à plat ventre. Il attendit un bref moment avant de s'élancer à nouveau vers les pins qui bordaient la route. Une fois à l'abri, à bout de souffle et couvert de sueur, il jeta un dernier coup d’œil sur les carcasses encore fumantes des voitures. Plus rien ne bougeait. Le deuxième homme, épouvanté de la tournure prise par l'interception, devait se terrer tout au fond du petit camion. En d'autres temps, cela aurait fait sourire Larcher mais il était à présent bien trop mal pour seulement y songer. Le corps du grand type aux cheveux blancs, autour duquel une mare de sang commençait à s'étaler, était là pour lui rappeler jusqu'à la nausée qu'il venait encore de tuer un être humain. Sans qu'il n'ait jamais eu la moindre chance d'agir autrement. Ce qui ne le réconfortait nullement. De plus, il se retrouvait une nouvelle fois livré à lui-même, seul, dans un pays à l'évidence des plus hostiles. Son mal de tête était intense, conséquence probable du choc qu'il venait de subir. Il porta la main droite à son bras gauche. Affolé, il se rendit compte qu'elle revenait couverte de sang. Fébrilement, oubliant le danger permanent que faisait peser l'autre homme dans son camion, il releva sa veste et sa chemise. Sa plaie saignait abondamment. Il n'était pas médecin mais il avait l'impression que, heureusement, la blessure était superficielle. Probablement le ricochet d'une balle qui n'était pas restée si l'on en jugeait par l'estafilade, profonde mais nette. Il était très impressionné par le fait de ne sentir aucune douleur. En gémissant de peur, il rejeta son fusil en bandoulière et roula sa manche sur son bras pour comprimer la plaie. Il se releva avec difficulté, à deux doigts de défaillir, et s'enfonça dans le bois en clopinant.
Tous droits réservés
copyright 943R3EB
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par djeser le 21 Mars 2015 à 14:37
Jeudi 1er mai
A présent, son épaule lui faisait mal. La douleur était sourde, une espèce d'élancement diffus, et cela le brûlait en permanence. Il ne pouvait plus se servir de son bras qui était ankylosé sur toute la longueur. Le sang, toutefois, avait arrêté de couler mais il ne faudrait pas beaucoup, lui semblait-il, pour relancer l'hémorragie. C'était quand même la seule bonne nouvelle car il savait par ailleurs sa situation des plus précaires. Son mal de tête avait également un peu diminué mais il avait l'impression de ne jamais avoir été aussi fatigué. Son fusil, pourtant en bandoulière, pesait des tonnes. Il s'arrêta pour souffler un peu et passa sa main droite sur son visage luisant d'une mauvaise sueur. Il avait froid. Il observa les environs. Des pins partout mais un sous-bois relativement dégagé qui aurait rendu sa progression presque confortable s'il n'y avait eu son bras. Durant les premiers instants qui avaient suivi la fusillade, il s'était enfoncé entre les arbres, sans souci de savoir où cela le mènerait, uniquement préoccupé de fuir au plus vite le lieu du carnage. Puis, il avait commencé à réfléchir. Le meilleur moyen de rallier ses amis lui avait semblé être de se rapprocher de la mer. En suivant la grève, il était certain de revenir vers la maison de la dune d'où il pourrait demander de l'aide mais cela sous-entendait marcher à découvert ce qui était dangereux. C'est pourtant la solution qu'il avait choisie en se répétant encore et encore que ses poursuivants - car il était persuadé que les gens qu'il venait bien involontairement de maltraiter n'en resteraient pas là - ne pouvaient surveiller tout le territoire. Ils s'en tiendraient d'abord aux axes routiers, voire aux petits chemins, d'où la relative sécurité de la plage. Il n'aurait qu'à être tout particulièrement vigilant en croisant les voies en culs-de sac qui desservaient les villages de vacances abandonnés, nombreux dans ce pays. Le seul problème qui demeurait était celui du ravitaillement mais, là, il n'avait pas encore trouvé de solution. Il tablait sur un peu de chance, cette chance qui, jusqu'à présent, lui avait particulièrement fait défaut. Il regarda sa montre : quatre heures de l'après-midi. A travers les cimes des pins qui par moments se raréfiaient, il croyait deviner malgré les nuages une luminosité différente devant lui, une sorte de halo qui lui indiquait l'ouest. Il se remit péniblement en marche. Il pouvait entendre des oiseaux qui se taisaient quand il s'approchait et il enviait leur liberté plus que jamais. Deux fois, il avait débusqué sans le vouloir des lapins; l'un des deux était même resté un long moment à l'observer, nullement craintif, et n'avait détalé qu'à la toute dernière seconde. A un autre moment, une forme noire, assez volumineuse, s'était enfui à son approche dans un froissement de broussailles. Il s'était immobilisé, le cœur battant, et n'avait repris son chemin qu'après plusieurs minutes d'une écoute méticuleuse. Un sanglier, peut-être. De toute façon, il n'en avait absolument pas peur. Il lui restait une bonne vingtaine de cartouches éparpillées dans ses poches mais il devait convenir que le bruit de son fusil aurait été des plus malvenus.
Il venait d'entendre le grondement épisodique de l'océan, preuve qu'il ne s'était pas trompé dans ses estimations, quand il repéra la cabane. Il s'en approcha lentement, les yeux aux aguets, bien qu'il soit raisonnablement assuré qu'il ne pouvait y avoir personne. C'était une petite bâtisse d'une pièce, au toit en partie délabré, probable habitation de chasseur ou de pêcheur, perdue dans les pins, à quelques dizaines de mètres de la plage qu'il pouvait maintenant apercevoir par intermittence. Le salut. Ou du moins la certitude de pouvoir se reposer un temps. Il en fit le tour avant de faire sauter de la crosse de son fusil la serrure qui céda sans difficulté. Le fusil toujours à la main, il pénétra dans l'obscurité et entrouvrit à tâtons les volets de l'unique fenêtre. Mobilier des plus rudimentaires : une petite table, deux tabourets, un placard fermé par un énorme cadenas, des filets de pêche dans un des coins et, suprême luxe, une paillasse sur laquelle il se laissa tomber après en avoir chassé d'un geste négligent la volumineuse araignée noire qui s'y prélassait. Il s'endormit presque instantanément. Quand il s'éveilla, le crépuscule était bien avancé. Il referma les volets avant d'allumer sa lampe de poche, précaution probablement inutile. Il s'approcha du placard et examina attentivement le cadenas avant de le faire sauter, non sans mal, à coups de crosse. Il poussa un cri de joie en découvrant les paquets de gâteaux secs et deux bouteilles de vin. Il emporta ses trouvailles jusqu'à la table où il se mit à les dévorer avec application. Les gâteaux étaient presque complètement moisis mais le vin parfaitement buvable. Au fur et à mesure qu'il se restaurait, il se sentait devenir un autre homme. Même sa blessure paraissait lui faire moins mal. Il attendit la nuit complète pour aller se baigner, laver ses vêtements crasseux et refaire son pansement avec un des torchons du placard. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait résolument optimiste. Il était à présent certain de s'en sortir. Même le souvenir de Coralie n'arrivait plus à assombrir ses pensées. Il en arriva à se demander si, après tout, il ne s'était pas emballé un peu vite : peut-être avait-elle quand même réussi à s'enfuir ? A moins que la vaisselle brisée de leur maison ait eu une toute autre signification et qu'elle soit à présent tout bêtement à sa recherche, avec les autres, tous morts d'inquiétude sur son sort supposé. Il avait hâte de se remettre en route. Il s'endormit sans difficulté, d'un sommeil lourd et sans rêve.
Vendredi 2 mai
Quand il se réveilla, le volet légèrement disjoint laissait pénétrer un filet de lumière grise. Son mal de crâne s'était dissipé mais il se sentait engourdi, les yeux chassieux, les paupières lourdes. Il comprit qu'il commençait à avoir de la fièvre. Il attendit immobile un long moment que cette impression de malaise s'estompe mais, bien au contraire, au fur et à mesure que le temps passait, il se sentait de moins en moins bien. La veille, quand il s'était endormi dans un état proche d'une euphorie peut-être due à l'excès de vin, il avait décidé de voyager de nuit. Cela paraissait la solution idéale : aucun risque de se tromper en suivant la plage et la quasi-certitude d'échapper à la vigilance d'éventuels poursuivants. Tout était à présent remis en question puisque chaque minute qui s'écoulait lui donnait le sentiment de le rendre un peu plus faible. Il eut tout à coup la certitude qu'il devait partir immédiatement sinon il risquait de pourrir dans cette cabane où, de plus, il ne restait que quelques gâteaux parmi les moins comestibles. En grognant, il se leva et s'avança jusqu'à la petite fenêtre dont il poussa le volet, minimètre par minimètre. A l'extérieur, le jour était bien avancé, un jour un peu gris qui roulait des nuages hauts derrière lesquels le soleil semblait vouloir percer. L'air était doux pour autant qu'il pouvait en juger. Avec précaution, il dégagea sa blessure, non sans quelques gémissements parfaitement involontaires, et il s'approcha de la porte pour se rendre compte plus complètement. La plaie était toujours franche, creusée, semblait-il, par le bain de la veille qui l'avait faite resaigner un peu. Il ne regrettait rien puisqu'il avait lu quelque part que l'eau de mer pouvait faire office de cicatrisant. Un début de croûte recouvrait en partie l'estafilade. Il en sourdait un peu de liquide incolore et la peau tout autour était rosie et brûlante. Il ne pouvait que difficilement la toucher. Tout cela ne lui inspirait par une confiance extrême et il était prêt à parier que, sans un antibiotique ou une pommade quelconque, rien ne s'arrangerait tout seul. Raison de plus pour tenter le coup maintenant alors qu'il tenait à peu près sur ses jambes.
Il ne s'encombra que de son fusil, de la dernière bouteille de vin et, découverte également dans la cabane, d'une vieille veste dont la laine était imprégnée d'un mélange d'odeurs de poisson et de moisi mais qui lui assurerait une bonne protection contre la fraîcheur des soirs à venir. Il marcha un long moment le long de la plage en direction du nord. Le soleil avait fini par apparaître et la veste lui tenait trop chaud mais il n'avait certainement pas envie de s'en séparer. Il était fatigué et son bras l'élançait. Par instants, la lumière l'éblouissait et il devait fermer les yeux. Devant lui sur la dune, à quelques centaines de mètres, plusieurs maisons se dressaient. Il s'en approcha d'une démarche pesante. La plus proche possédait un petit escalier de béton qui descendait sur la grève. Un peu plus loin, sur une espèce de rond-point surplombant la plage et qui devait terminer une route, le scintillement d'une vitre de voiture lui blessa la rétine. Comme il se l'était promis en pareil cas, il se rapprocha de la dune afin de progresser dans son abri relatif. Il savait qu'il faisait une cible encore bien trop visible mais, dans son état, il était hors de question d'escalader tout ce sable. Ce qui, d'ailleurs, n'aurait vraisemblablement rien changé. On n'entendait que le mugissement de l'océan qui roulait ses vagues dans le vide, pour personne. Le lotissement était à l'évidence abandonné. Dans une sorte de rêve éveillé, il se demanda curieusement ce qu'étaient devenus les propriétaires de la voiture. Sans doute venus là dans un ultime effort, dans une dernière tentative pour échapper à la mort qu'ils portaient en eux, leurs squelettes devaient à présent blanchir quelque part dans les dunes alentours, disloqués par la hargne de quelque prédateur. Il se laissa tomber contre une sorte de hangar qui s'élevait, solitaire, sur la plage, en contrebas des habitations. L'ombre du petit édifice fut la bienvenue et il put laisser son bras reposer sur son ventre, à la recherche d'une position antalgique que, bien sûr, il ne trouva pas. A présent qu'il ne bougeait plus, un semblant de vie avait ressurgi : des oiseaux, hauts dans le ciel, des insectes qui bourdonnaient comme ils l'avaient fait pendant des millions d'années. Le calme. Un semblant de repos. Depuis plusieurs minutes, il s'évertuait à se donner du courage pour se relever quand il entendit les chiens.
Tout d'abord, ce ne fut qu'un bruit imperceptible, très loin vers l'intérieur des terres, espèce d'hallucination auditive qui avait de la peine à couvrir le murmure du ressac. Il tendit l'oreille. Peut-être un chien qui chassait un lapin quelconque. Mais quand les aboiements s'amplifièrent, il put distinguer plusieurs bêtes. Et qui se rapprochaient assez vite. Pour lui. C'était sans doute pour lui. Des chiens. Comment n'y avait-il pas pensé ? L'angoisse lui fit immédiatement exécuter ce qu'il n'arrivait pas à entreprendre. Il se leva et se mit à clopiner vers le nord. Il inclina bientôt sa trajectoire vers l'océan. Il espérait que, en marchant sur le sable mouillé, il pourrait tromper quelques temps les chiens, suffisamment pour s'éloigner, pour décourager ses poursuivants. Et puis, près des vagues, sa silhouette serait probablement moins visible que sur l'arrière-fond blanc des dunes. Il courut lentement sans se retourner, attentif seulement à accroître les distances. La marée montante compliquait sa tâche car il devait éviter les vagues les plus fortes. Dans un brouillard par moments intense, les tempes battantes, il fixait l'horizon de la grève, toujours identique. Quand il entendit le grognement, il se retourna d'un bloc. A une dizaine de mètres derrière lui, un chien s'était arrêté en surprenant son mouvement. C'était un grand animal blanc et noir, sorte de corniaud de chien de chasse, qui le regardait de ses yeux mauvais. Il était seul. Larcher essaya de le faire fuir d'un grand mouvement du bras droit qui amplifia les élancements de son épaule blessée. Mais, loin d'être impressionné, le chien s'avança lentement vers lui, tête baissée et toutes dents dehors.
- Fous le camp, sale con ! hurla Larcher dans une espèce de croassement. Je vais t'allumer, merde !
Le chien s'était dangereusement rapproché et lui coupait toute retraite vers la plage. Larcher s'empara fébrilement de son fusil et, au moment précis où il sentit que la bête allait s'élancer, il tira. Frappé de plein fouet, l'animal sauta en l'air et alla s'écrouler quelques mètres plus loin dans un gémissement d'agonie. Le bruit de la détonation s'était répercuté tout au long des dunes. En jurant, Larcher reprit sa marche. Quelques minutes plus tard, la respiration coupée par son nouvel effort, il s'arrêta et se retourna. Il pouvait à présent parfaitement distinguer plusieurs silhouettes qui gagnaient du terrain sur lui. C'était un véritable cauchemar. Il abandonna l'océan qui ne pouvait plus lui être d'aucune utilité, bien au contraire, et, par un mouvement de diagonale, se rapprocha à nouveau des dunes. Il pensa un moment s'abriter dans l'ombre du vieux blockhaus allemand, aux trois-quarts enfoui dans le sable, qu'il avait depuis longtemps repéré mais au dernier moment il opta plutôt pour l'escalade de la dune, plus basse à cet endroit. Cela lui prit de précieuses minutes mais, une fois en haut, il pouvait dominer la plage et apprécier la situation. Ses poursuivants étaient peu nombreux, trois ou quatre hommes et quelques chiens. Il n'en fut nullement rassuré, persuadé qu'il était à présent d'avoir affaire à une véritable chasse à l'homme et que d'autres salopards devaient certainement chercher à le prendre à revers depuis l'intérieur des terres. Il se traîna vers un bosquet d'arbres. De là, il pouvait voir les environs. Il était de plus relativement à l'abri derrière une sorte de remblai naturel. Il se détendit un peu et chercha à récupérer de ses efforts. Il n'avait plus qu'à attendre. Peut-être même qu'avec un peu de chance, les autres passeraient au large sans le voir, qu'ils le laisseraient tranquille. Il ne demandait que ça... Le premier chien, assez semblable à celui qu'il avait tué sur la plage, surgit au bout de plusieurs minutes. Il reniflait le sol sableux qui le faisait par moments éternuer puis s'arrêta tout à coup, les yeux braqués vers son bosquet. Larcher se garda bien de tirer ce qui n'aurait servi qu'à dilapider ses rares munitions. Le chien, en arrêt, donnait l'impression de regarder Larcher directement, comme s'il avait été pleinement à découvert. Une voix résonna sèchement et le chien fit demi-tour. Larcher n'avait pas entendu les hommes arriver et, de l'endroit où il se trouvait, il ne pouvait pas les voir. Les minutes s'écoulèrent doucement, sans que ses poursuivants ne donnent l'impression de vouloir s'approcher. Sa première idée avait été d'attendre la nuit pour profiter de l'obscurité et échapper à ses ennemis qui ne devaient quand même pas être si nombreux. Mais le temps passant, il se demanda si c'était le bon choix. Après tout, les autres devaient certainement se méfier et ils avaient dû raisonner comme lui. Pourquoi ne pas chercher à ramper tout de suite à travers les herbes assez hautes par ici et gagner les pins derrière lui ? Reprendre l'initiative, d'une certaine manière. Mais ce qui le désorientait, c'était ce silence. Il savait bien que les autres étaient toujours là et il se demandait pourquoi on ne lui faisait aucune sommation, pourquoi on ne cherchait pas à le faire sortir de son abri. Non, aucun bruit de voix, aucun geste. Rien qu'une immobilité presque minérale, à peine coupée de temps à autre par un souffle de vent qui agitait faiblement les herbes. C'en était d'autant plus angoissant. Il se décida. Sa progression fut extrêmement lente, entrecoupée de multiples et longues pauses, sans oser relever la tête ne serait-ce que de deux centimètres par peur d'être vu. Il profitait des sautes de vent pour avancer puis se recroquevillait sur lui-même dans l'attente du coup qui ne venait pas. Il mit un temps infini, certainement une des expériences les plus angoissantes de son existence, pour atteindre les premiers arbres. Il prolongea sa reptation un long moment et ne se releva que bien au creux de la pénombre complice, n'arrivant pas à se persuader qu'il y était arrivé. Pourtant il l'avait fait ! Il était passé au travers de ses ennemis. Malgré leur vigilance, malgré les chiens. A présent relativement protégé, il accéléra autant qu'il le put son allure. Son plan était des plus simples : suivre la forêt vers le nord, aussi longtemps que possible, avant de regagner la plage. Marcher jusqu'à l'épuisement si nécessaire. De se savoir sorti de cette situation périlleuse lui avait redonné des forces. Sa blessure le laissait presque tranquille. Sa faim et surtout sa soif étaient oubliées. Dans son cerveau en fusion, brûlé par la fièvre, il n'avait qu'une seule idée, un seul but : aller plus loin. Se mettre hors de portée. Après, il verrait bien.
Tous droits réservés
copyright 943R3EB
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique