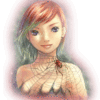-
chapitre vingt et un
Mercredi 30 avril (suite)
Durant près de deux heures, Larcher sillonna les routes de la proche région. Sans résultat. Il s'était tout d'abord lancé sans plus réfléchir dans la direction où il avait vu disparaître la camionnette rouge. Après avoir traversé St Julien totalement désert, il s'était enfoncé vers le sud, en direction de Bayonne. Il n'avait qu'imperceptiblement hésité au premier véritable embranchement, choisissant de privilégier la route la plus importante mais, au troisième carrefour, l'irrationalité d'une telle démarche le frappa : qu'est-ce qui lui prouvait que la camionnette était partie à droite plutôt qu'à gauche ? En réalité, il n'avait aucun moyen de le savoir. Il gara sa voiture pour réfléchir. Bien que son anxiété soit toujours extrême, il sentait se ralentir les battements de son cœur et son agitation se tempérer. Petit à petit, le désordre du début laissait la place à une froide détermination. Il n'était pas question d'abandonner ses recherches - plutôt mourir - mais il fallait raisonner. Il se pencha vers le vide-poche et se saisit de la carte routière locale qu'il y avait glissée quelques heures plus tôt sans alors se douter de ce à quoi elle lui servirait. Il l'examina attentivement. Un sentiment d'urgence l'habitait plus que jamais. Il savait que chaque minute qui passait rendait sa recherche plus problématique. Mais les premiers instants écoulés, ce n'était plus le moment de céder à l'improvisation. Il décida de parcourir l'ensemble des routes et des chemins compris dans un grand périmètre situé au sud de St Julien. Aucune autre raison à cela que le désir de faire quelque chose, d'être au fond à peu près certain que les salauds étaient partis plus loin. En cas d'échec, il serait toujours assez tôt pour aviser. Il démarra la voiture pour une exploration plus systématique et presque un quart d'heure plus tard, il eut l'impression, enfin, d'aboutir à quelque chose : alors qu'il s'approchait d'un petit hameau, il vit son pare-brise s'étoiler avant d'entendre distinctement le bruit d'une détonation. Poussant un cri de victoire, il freina si brutalement que la voiture s'arrêta en travers de la route. Il ouvrait déjà sa portière et, son fusil à pompe à la main, il sauta dans le fossé tout proche. Sans perdre de temps, il entreprit un long mouvement tournant destiné à l'amener derrière le ou les tireurs. Il espérait qu'il s'agissait bien des ravisseurs : ce serait ensuite à lui d'agir, par la force si nécessaire. Il n'avait aucun plan préétabli mais la perspective de les perdre à nouveau en allant chercher du renfort du côté de Willy lui était absolument insupportable. Il devait intervenir seul. Il mit plus de dix minutes à travers champs pour arriver à l'endroit voulu mais sa déception fut immense : le tireur était seul et ce n'était certainement pas un de ceux qu'il recherchait. Il s'agissait d'un très vieil homme qui, un fusil de chasse à la main, surveillait encore la route où Larcher pouvait deviner la silhouette immobile de sa voiture. L'homme se parlait à voix basse tout en furetant maladroitement dans une musette posée près de lui. La déception, la rage de Larcher furent telles qu'il épaula pour se débarrasser de ce gêneur, de cet idiot qui lui avait fait perdre tellement de temps. A l'ultime moment, malgré la colère qui l'aveuglait, un dernier reste d'humanité le fit tirer un peu en arrière de l'homme. Le vieillard poussa un cri de frayeur et s'aplatit dans l'herbe les mains sur la tête mais Larcher était déjà reparti. Le plus rapidement qu'il put sans offrir de cible trop évidente, il récupéra sa voiture et la relança sur la route sans entraîner la moindre réaction de la part de son ennemi involontaire.
Une heure et demie plus tard, il en était au même point. Aucune trace des ravisseurs. Pas la moindre tache rouge dans la campagne indifférente. La tentation était grande maintenant de retourner au 128, d'aviser avec Willy et les autres. Il avait d'ailleurs espéré les rencontrer au cours de son périple infructueux mais il devait être trop loin vers le sud. Il se gara le long de la départementale qu'il venait de parcourir dans les deux sens avec l'espoir de découvrir un chemin de terre quelconque, des traces, n'importe quoi. Epuisé, il consulta sa montre : presque cinq heures de l'après midi. Dans deux, trois heures au plus, ce serait la nuit. Le temps de retourner et il faudrait ajourner les recherches jusqu'au lendemain. Impossible d'abandonner Coralie à cette nuit pour elle de toutes les incertitudes. Si elle était encore vivante mais cette idée-là, il la repoussa avec force. Il lui fallait de l'aide. Rencontrer des gens malgré le danger. Obtenir des renseignements coûte que coûte. Quelqu'un avait bien dû voir passer cette saloperie de camionnette. Il revint à proximité de St Julien et arrêta une nouvelle fois sa voiture. Repartir de zéro. Tout recommencer. Il reprit sa carte, évalua les distances, examina sa jauge. De ce côté là, au moins, il n'y avait pas de problème : le réservoir était aux trois-quarts plein ce qui signifiait des centaines de kilomètres d'autonomie pour un diesel comme le sien. Le souvenir du sourire de Coralie lui brouilla la vue quelques secondes. Il retint sa respiration puis, d'un air décidé, enclencha le levier de vitesses. Plein sud. C'était ce qui lui apparaissait le plus logique. Territoires inconnus. Risques évidents. Mais risques calculés.
Il aperçut les premiers signes de vie depuis le vieillard au fusil de chasse une trentaine de kilomètres plus loin. Il était encore assez éloigné mais il avait nettement distingué des silhouettes qui s'engouffraient dans une villa, à droite de la route, probablement alertées par le bruit de son moteur. Il arrêta la voiture dans un chemin de terre et se risqua à pied en direction de la maison. Il avançait lentement, demi courbé, cherchant à rester au maximum à couvert. Heureusement la route était bordée d'arbres derrière lesquels il pouvait effectuer des haltes fréquentes pour observer le terrain. Il avait conscience de présenter, avec son fusil à la main et ses bonds successifs à la manière des troupes d'assaut, un aspect volontiers inquiétant mais il tenait à être excessivement prudent. L'épisode du vieillard lui avait servi de leçon. La maison était silencieuse, ses volets et ses portes bien fermés. Une fraction de seconde, il se demanda s'il n'avait pas rêvé, si les silhouettes qu'il avait cru apercevoir n'étaient pas seulement le fruit de son imagination et de son angoisse. Il sentait la fatigue dans ses jambes, le poids de l'arme à son bras droit. Il hésitait à rebrousser chemin. Retourner. Partager son inquiétude avec les autres. Réenvisager tout de manière plus sereine, plus systématique et probablement plus efficace. Au lieu de cela, il se redressa devant la porte et frappa distinctement. Aucune réponse. Il insista. Une voix de femme se fit entendre. Il ne s'était pas trompé. La maison était habitée.
- Qu'est-ce que vous voulez ? Passez votre chemin. On n'a pas besoin de vous ici.
- Un renseignement. J'ai besoin d'un simple renseignement, cria Larcher.
- J'sais rien, j'vous dis ! répliqua la femme.
- Je veux seulement savoir si vous avez vu passer une voiture. Une camionnette rouge.
- J'ai rien vu. Foutez le camp !
- Ecoutez, vous pouvez me renseigner. Je ne vous demande pas de m'ouvrir. Simplement de me dire si vous avez vu une camionnette passer. Une camionnette rouge, une Opel, je crois. Il ne doit pas y avoir beaucoup de circulation ici, quand même. Vous devriez vous en souvenir. Et qu'est-ce que ça peut vous faire de me renseigner, hein ? Après, je m'en vais, je vous le promets.
La femme parut hésiter avant de répondre.
- Bougez pas. Surtout vous cherchez pas à rentrer. Je vais demander à mon mari.
Larcher dut patienter un long moment. Si long qu'il se demanda s'il ne devait pas partir, chercher plus loin une aide moins difficile. Il était sur le point d'abandonner quand une voix d'homme relança le dialogue.
- Ouais. Alors c'est quoi que vous voulez au juste ?
Larcher dut reprendre ses explications. L'homme paraissait peu coopératif mais, en même temps, il ne donnait pas l'impression de vouloir abréger trop brutalement la conversation. Cela faisait plusieurs minutes déjà que Larcher faisait face à cette porte fermée et cette halte prolongée, alors que le temps fuyait toujours plus vite, commençait à l'inquiéter. Le bruit d'un moteur lui fit soudain comprendre la raison de ce dialogue absurde. Il se retourna brutalement. Quelqu'un manœuvrait sa voiture et lui avait déjà presque fait faire un demi-tour. Larcher en hurlant se lança à sa poursuite mais la lutte était parfaitement inégale. Il s'arrêta et tira sans espoir sur l'automobile qui s'éloignait. Impuissant, des larmes de rage aux yeux, il la regarda disparaître. On avait endormi sa méfiance. Pendant qu'il discutait vainement à travers la porte, fixé par l'espoir d'obtenir une indication, même vague, un complice s'était glissé par derrière et avait réussi à le voler. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Il y avait aujourd'hui autant de voitures disponibles qu'on le désirait. Pourquoi lui prendre la sienne ? Il retourna à la porte. La colère l'étranglait. Il avait du mal à trouver ses mots.
- Bande de salauds ! Qu'est-ce que vous voulez faire avec ma voiture. Rendez la moi, merde !
- Ta gueule, sale Viral, rétorqua l'homme. Ca t'apprendra à venir emmerder les honnêtes gens.
On sentait dans la voix de l'homme une joie malsaine. Il avait du mal à contenir un rire de satisfaction. Larcher était effondré. Il chercha à négocier, à s'expliquer.
- Mais je vous veux pas de mal, moi. Je voulais seulement un renseignement. Pourquoi vous m'avez volé ma voiture ?
- Et toi, pourquoi que t'es venu parlementer avec un flingue, hein, si tu voulais un simple renseignement ? Eh bien, je vais te le dire, mon pote. C'est parce que tu voulais nous buter. Comme tes autres potes, les Viraux. Tous des ordures. Tu l'as dans l'os, hein, maintenant ? Mais bouge pas d'ici, les gendarmes vont venir te cueillir. T'auras qu'à t'expliquer avec eux si t'es si malin.
- Mais, merde, j'suis pas un Viral, qu'est-ce que c'est que ce bordel ! Je suis à la recherche de ma femme, c'est tout !
- Ben voyons ! Maintenant, c'est plus une bagnole que tu cherches mais une bonne femme. Tu nous prends vraiment pour des cons.
Larcher ne savait plus quoi dire face à ce monument d'indifférence et de haine. Il fit une dernière tentative.
- Et c'est quoi, ces gendarmes, hein ? Des copains à vous, sans doute. Et qui font leur propre Loi, c'est bien ça, n'est-ce pas ?
- C'est ça, marre-toi. Attends donc qu'y z’arrivent, les flics. Des vrais gendarmes que j'te dis. T'auras qu'à leur signaler la disparition de ta femme, y sont là pour ça, poursuivit l'homme en riant méchamment.
Larcher se retourna vers la route. Elle était déserte mais, à en croire cet abruti, ses copains allaient rappliquer avec les plus mauvaises intentions du monde à son égard. Encore des soi-disant miliciens, probablement. Comment pourrait-il leur résister avec son pauvre fusil ? Il se dirigea vers les champs qui bordaient l'autre côté de la chaussée. Disparaître. Pour le moment, il n'avait que ça à faire. Pour la voiture, ce n'était pas grave. Il en retrouverait d'autres. Mais tout ce temps à nouveau perdu... Il en aurait pleuré de colère. Il sauta dans le fossé et s'enfonça dans la campagne. Droit devant lui, à quelques centaines de mètres, il distinguait un petit bois. Il aviserait la-bas.
Les deux véhicules blindés légers s'immobilisèrent doucement devant la villa. Leurs carrosseries bleutées paraissaient presque noires dans le jour qui faiblissait. Le commandant Bocquillon attendit une trentaine de secondes avant de faire signe à deux de ses hommes. Il sauta d'un geste assuré du véhicule et inspecta les environs. Son regard revint aux véhicules blindés. Flambants neufs, lavés de la veille, ils étaient superbes et, comme chaque fois qu'il était en opération, le commandant Bocquillon sentit une fierté et une joie intenses l'envahir. Après toutes ces semaines d'anarchie, de violences incontrôlables, les deux blindés, récupérés dans une caserne de gendarmerie près de Bayonne, représentaient à ses yeux le premier signe évident d'un certain retour à la normale. Et c'était lui, Gilles Bocquillon, simple ancien pompier volontaire de Castets, qui était indéniablement le principal artisan de ce renouveau. Pas sans difficultés d'ailleurs si l'on voulait bien considérer tout le mal qu'il avait eu pour constituer sa petite troupe en ces temps troublés. Mais il y était quand même arrivé. Sans doute, seulement une dizaine d'hommes mais des bons. Des hommes sur lesquels on pouvait compter et qu'il avait méticuleusement sélectionnés et entraînés. Le résultat ne s'était pas fait attendre : dès que l'on avait su - par un mouvement mystérieux de bouche à oreille - que l'ordre était revenu dans le territoire qu'il contrôlait et qui, d'ailleurs, s'étendait chaque jour un peu plus, les gens s'étaient regroupés. Quelques familles, quelques solitaires, tous parfaitement identifiés. Peu de monde suivant les critères anciens, c’est vrai, mais une population presque immense à l'échelle du pays abandonné. Et il le faisait respecter l'ordre. Les étrangers, du moins ceux qui ne créaient pas d'ennuis, devaient montrer patte blanche. C'était son rôle à lui. C'était sa responsabilité et il tenait à l'assumer du mieux qu'il pouvait. Il fit jouer les manchettes de son impeccable uniforme et, après un regard vigilant sur les deux hommes qui l'encadraient silencieusement, un pas en arrière de lui, se retourna vers la maison. Sur le seuil de la porte grande ouverte, un homme d'une cinquantaine d'années, en survêtement rouge, attendait, bras croisés, qu'il veuille bien lui adresser la parole. Le commandant Bocquillon s'approcha lentement de lui.
- Alors, monsieur Laffay, vous avez observé quelque chose de suspect ?
Comme s'il n'attendait qu'un signal, l'homme s'anima soudainement.
- Oui, mon commandant. Sinon, je ne me serais pas permis de vous déranger. Voilà, que je vous explique...
De ses propos tout à coup véhéments, il ressortait qu'un inconnu, vraisemblablement un Viral étant donné son agressivité permanente - il avait fait usage de son fusil à plusieurs reprises mais heureusement leur porte était solide - avait cherché à forcer l'entrée de sa maison. Il n'y était pas parvenu à cause de leur fermeté inflexible, à sa femme et à lui, et grâce aussi au courage d'un ami qui n'avait pas hésité à subtiliser sa voiture pratiquement sous les yeux du Viral qui n'avait alors eu comme seule ressource que de décamper.
- Vite fait, qu'il s'est tiré, le salaud, poursuivit l'homme. Là-bas, dans la direction du bois des Joliettes. Faut nous en débarrasser, n'est-ce pas, mon commandant ? Et n'hésitez pas à le descendre, hein ?
- On va essayer de vous le prendre, votre Viral. Comptez sur nous. On est là pour ça.
- Mais faut le descendre, c'te ordure, hein ? L'a essayé de nous tuer, moi et ma femme. Pas de pitié avec ces salopards, c'est moi qui vous le dis !
Le commandant Bocquillon fixa l'homme d'un regard sévère, presque méchant, qui fit taire son vis-à-vis.
- On s'en occupe, monsieur Laffay, je viens de vous le dire. A présent, c'est à nous de jouer. Ce soir, c'est un peu tard, il va faire nuit, mais demain il va danser, je puis vous l'assurer. En attendant, au moindre signe suspect, vous nous prévenez avec votre CB.
- Entendu, mon commandant. D'ailleurs, je...
Mais le commandant Bocquillon ne l'écoutait plus. Il fit un signe à ses hommes et remonta dans son blindé. A présent, il avait envie de retourner chez lui où l'attendait son dîner. Bien calé à l'avant du véhicule, il enleva son képi et se pencha vers le conducteur.
- Si je compte bien, ça fait trois signalements de ce genre durant les dernières vingt-quatre heures, n'est-ce pas, Cohen ?
- Heu, oui, mon commandant, trois.
- Sûrement pas le même à chaque fois. Eh bien, messieurs, on dirait que les affaires repartent. Demain, à cinq heures trente au Poste, pour le briefing. Tous. Nous avons du pain sur la planche.
Il se renfonça dans son siège. Il aimait bien qu'on fasse appel à lui. Au moins, dans ce monde pourri, il avait vraiment l'impression de faire oeuvre utile.
SUITE ICITous droits réservés
copyright 943R3EB
-
Commentaires