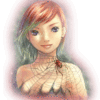-
chapitre neuf
Jeudi 3 avril (suite)
Le spectacle était terrifiant. L'angoisse sourde qui n'avait pas quitté Larcher depuis le début de ce qu'il appelait pudiquement "les événements", comme si de ne pas verbaliser l'horreur de la situation nouvelle pouvait en atténuer l'intensité, s'était amplifiée jusqu'à être présente physiquement en lui, oppression invincible qui, de temps à autre, le forçait à inspirer très profondément pour gagner un supplément d'air. Il tourna les yeux vers le 4X4 où il avait obligé Coralie à s'enfermer, vitres relevées. La voiture était bien en vue au milieu de la place, en compagnie des quelques véhicules abandonnés avec lesquels il se confondait. L'espace était assez dégagé et il paraissait impossible de s'en approcher sans se faire repérer. Larcher pouvait apercevoir la silhouette parfaitement immobile de la jeune femme. Satisfait, il revint à son observation du périphérique dont, essentiellement par acquis de conscience, il s'était résigné à apprécier l'état. Avec le faible, très faible espoir qu'il y aurait quand même moyen de l'emprunter, peut-être par la voie de dégagement ou bien en utilisant la chaussée à contre-sens. Mais, dès le premier regard porté par-dessus le parapet de pierre, il s'était rendu compte que cela était absolument impossible. La vision était terrifiante. En dépit de tout ce qu'ils avaient dû vivre, malgré toutes les rues, les avenues sinistres qu'ils venaient de sillonner, il n'avait pu retenir un frisson devant la scène lamentable, le spectacle d'apocalypse qui s'étalaient devant lui. Des milliers de véhicules, encore et toujours, immobilisés à jamais. Presque exclusivement des voitures particulières comme pour un immense départ en week-end que le temps aurait figé brutalement. Quelques camions dont les toits surnageaient de ci, de là, et même un ou deux autocars englués dans la fusion de métal et de verre qui scintillaient au soleil d'avril. Par endroits, de rares taches de bitume restaient visibles et donnaient à croire que certains bienheureux avaient réussi à s'extraire du magma pour gagner un futur indécis. Certaines voitures étaient arrêtées de travers ou chevauchaient maladroitement leurs voisines dans une dernière étreinte rageuse, d'autres étaient complètement renversées, leurs roues posées comme autant de mains dressées dans une supplique impuissante au ciel indifférent. Deux ou trois incendies avaient fusionné les carcasses de tôle en d'étranges sculptures surréalistes enfermant dans une prison de mort leur cargaison de douleur. Mais, au-delà du silence sépulcral et de l'absence absolue de mouvement, on savait que ce ne pouvait pas être un départ de week-end gigantesque. Il suffisait de porter les yeux sur l'amorce de l'autoroute dont tous les accès, toutes les voies débordaient de voitures toutes tournées dans la même direction, celle de la sortie de la ville, celle de la fuite, celle de l'espoir impossible.
Larcher secouait faiblement la tête de droite et de gauche, pour se convaincre que tout ce qu'il voyait ne sortait pas de l'esprit d'un malade ou d'un cauchemar fou. Il arrivait à reconstituer la genèse de ce carnage. Il imaginait le premier accident qui avait figé l'ensemble de la circulation, qui avait arrêté tous les autres gens, tous ceux qui derrière s'étaient retrouvés noyés dans le piège infernal. L'absence d'autorité légale efficace avait vraisemblablement précipité et amplifié l'immense panique, l'inexorable besoin de s'enfuir qui s'était emparé de tous, quitte à écraser les autres comme dans un cinéma lors d'un incendie. La plupart de ces malheureux devaient être déjà malades, incapables de réfléchir sainement, contraints par leur état à décharger leur trop plein d'agressivité sur leurs voisins, au milieu des injures, des vrombissements de moteurs, des hurlements de klaxons, des pleurs des enfants, des cris des plus faibles. Les plus chanceux avaient dû abandonner leur voiture paralysée et, encombrés de leurs bagages inutiles, avaient cherché à fuir cet enfer pour un ailleurs problématique. Il espérait que c'était le cas du plus grand nombre mais il n'en était pas convaincu. Quant aux autres, ils étaient encore là, enfouis au sein de ce cimetière géant. Il en voyait quelques corps, déjà presque momifiés, abandonnés au vent et à la pluie dans autant de positions grotesques. Pour la première fois, il comprit l'immense gâchis, la mort d'une entière civilisation, une mort plus inexorable que celle d'une guerre au cours de laquelle, si terrible soit elle, il reste toujours un souffle de vie, un espoir, parmi les décombres.
Seul être vivant dans tout ce silence, un chien furetait parmi les cadavres de métal, peut-être à la recherche de ses maîtres disparus ou plus simplement à flairer quelque denrée comestible. Larcher regarda avec attention celui qui était à présent pour lui un compagnon d'infortune. Le chien, un grand animal efflanqué, s'approcha du corps d'une femme à moitié basculée par la porte entrebâillée de sa voiture et le flaira longuement. Larcher, pris soudain d'un pressentiment affreux, détourna les yeux mais quand il regarda à nouveau, la bête s'était éloignée et, trottinant d'un pas allègre, se perdit bientôt parmi les épaves. Et dire que la porte de Bagnolet ne doit être qu'une image de ce qui s'est passé à toutes les sorties de Paris, et vraisemblablement des autres villes, pensa Larcher. Sans parler des autres pays pour ce que j'en sais. C'est à devenir fou. Par une sorte de masochisme morbide, il n'arrivait pas à détacher ses yeux de cette monstruosité. L'avertisseur puissant et brutal du Range le fit sursauter. Il se retourna mais tout semblait normal. Il pouvait toujours apercevoir l'ombre de sa compagne derrière la vitre. Il était incapable d'évaluer le temps qu'il avait passé à contempler, fasciné, l'hallucinant spectacle. La jeune femme devait tout simplement s'impatienter. Il se hâta vers le 4X4. En le voyant revenir, Coralie baissa sa vitre.
- Ben alors, qu'est-ce que tu fabriques ? T'as trouvé un chemin ou quoi ?
Il secoua négativement la tête, sans répondre. Quand il se fut installé près d'elle, il murmura d'une voix étrange :
- Rien à faire. Le périf est... bourré. Faut passer par la banlieue.
Elle comprit dans son regard toute l'horreur de sa vision et ne chercha pas à en savoir plus. Elle posa sa main sur la sienne et ils restèrent silencieux un moment.
- C'est quelle heure ? demanda enfin Larcher en regardant sa montre.
- Presque une heure de l'après midi, lui répondit Coralie.
- T'as faim ?
- Non, et toi ?
- Moi non plus. Allez, on y va. Plus vite on part, plus vite on sera arrivé.
Il tourna la clé de contact.
La peur. La peur l'étreignait en permanence, compagne détestée mais omniprésente, qui l'empêchait de réfléchir, de prendre les décisions indispensables. Elle sursautait au moindre bruit, s'épouvantait ensuite du silence. Perdue, abandonnée de tous, elle savait pourtant qu'elle n'était pas seule mais des Autres, de tous les Autres, ne pouvaient venir que la haine et la mort. Elle aurait tant voulu s'enfuir de ce cauchemar, se cacher derrière chaque objet, ne marcher que de nuit peut-être, mais s'enfuir. Partir pour n'importe où, plus loin, dans des lieux où le danger se serait fait moins pressant. Mais elle ne le pouvait pas. Rampant à moitié, sa lampe éteinte serrée dans sa main moite, elle s'approcha de la porte du petit appartement, se releva, introduisit ses clés. Trois serrures et trois clés différentes. Long à manœuvrer mais la rançon de la sécurité. La porte s'ouvrit avec un petit grincement qui la fit frissonner tant le bruit ridicule parut résonner dans le silence ambiant. Elle referma vivement la porte sans la claquer, s'empressa de pousser les verrous, défense dérisoire mais elle ne s'en doutait pas, et, s'appuyant contre le mur, elle passa une main imprécise dans ses cheveux sales. Sylvie s'approcha de la petite chambre faiblement éclairée et elle se fit la réflexion qu'il lui faudrait, une fois encore, changer les piles de la torche. Cela n'avait pas d'importance car elle avait pris la précaution de s'en faire une réserve. Sur le lit défait, l'enfant se tourna vers elle en l'entendant et, d'une toute petite voix, il interrogea :
- C'est toi, maman, c'est toi ?
- Oui, mon chéri, comment tu te sens ? Tu as toujours mal à la tête ?
- Un peu moins, maman, mais j'ai soif...
En lui rapportant un verre d'eau, elle se pencha sur son fils et posa sa main sur le front brûlant. Toujours la fièvre. Elle lui soutint la tête tandis qu'il buvait avec difficulté puis elle s'assit à côté de lui, impuissante. L'enfant s'était assoupi. Sylvie essaya de se raisonner, de se convaincre. Il lui fallait absolument des médicaments, ne serait-ce que pour faire tomber cette fièvre. Deux fois déjà, la peur avait été la plus forte et elle n'avait pu aller jusqu'à la pharmacie. En fait, elle n'avait même pas pu dépasser le coin de l'immeuble. Au début, elle n'avait pas pris toutes ces précautions. Au contraire, elle marchait sans crainte dans la petite ville, ne croisant que des silhouettes qui semblaient vouloir l'éviter ce qui la faisait sourire car, de toute façon, elle ne les aurait jamais laissé approcher. Elle s'était même amusée de la situation. Rentrer comme ça chez madame Bobanier, l'épicière, et se servir, choisir ce qui lui plaisait, au point d'être obligée de s'y reprendre à plusieurs fois tant elle avait d'objets à transporter. Pas tous utiles, les objets, bien sûr, mais comment résister au plaisir enfantin de ne plus compter, de ne plus être limitée par l'argent. Et puis, il y avait eu, il y avait eu... Elle avait formé le projet d'aller visiter le marchand de jouets, à trois pâtés de maisons de chez elle. Jérôme commençait à se plaindre de sa tête et de sa gorge. Elle avait décidé de lui rapporter une voiture miniature, un ou deux livres, des babioles pour lui faire prendre patience. Elle s'apprêtait à sortir du hall du petit immeuble quand elle avait entendu les cris, les bruits de lutte. La porte d'entrée avait été violemment repoussée et elle n'avait eu que le temps de se réfugier dans l'escalier qui conduisait aux caves. De là, hélas, elle pouvait tout voir. Les Autres. Trois hommes qu'elle ne connaissait pas venaient d'entrer en riant. Ils tiraient une jeune femme blonde qui les suppliait. Elle reconnut Florence Perthuis avec qui elle était allée en classe dans le temps. Sylvie était surprise car elle pensait que les Perthuis, comme une grande partie des gens de Provins, étaient partis avec la masse de ceux qui arrivaient des grandes villes pour s'enfoncer toujours plus loin dans la campagne. Le hurlement de la jeune femme blonde lui vrilla les tympans. Deux des hommes l'avaient jetée à terre et cherchaient à lui arracher ses vêtements. Sylvie ne pouvait rien faire. Elle avait trop peur. D'ailleurs, de quelle aide aurait-elle pu être, sans arme, seule, terrorisée ? Elle cacha son visage dans ses bras pour ne pas voir le viol immonde. Elle resta ce qui lui parut un temps infini, accroupie sur ses deux marches, à retenir des sanglots de honte et de peur. Puis, les cris de la femme lui avaient malgré tout fait relever la tête. Cette fois, deux des hommes maintenaient la malheureuse tandis que le troisième à califourchon sur elle faisait tourbillonner un rasoir qui scintillait dans la demi-clarté. Sylvie avait tourné les yeux, incapable d'assister à toute cette horreur. La séance de torture dura longtemps et, plusieurs fois, elle avait failli perdre connaissance en entendant les rires des hommes et les cris atroces de la femme. Quand celle-ci avait cessé de gémir, elle avait pu entendre les Autres se remettre à parler, calmement, comme s'ils échangeaient des phrases banales.
- Elle est tombée dans les pommes, cette conne.
- Karim, j't'avais bien dit de pas lui niquer les yeux tout de suite. J'te l'avais bien dit. Merde, j’te l’avais dit ! Comme ça, c'est moins marrant, sale con.
- Tu commences à me gonfler. Y a que ce que tu fais toi qu'est marrant, à t'entendre.
- Vos gueules, s'exclama une troisième voix. On va finir par se faire repérer avec vos conneries.
- Risque pas. Y a plus personne dans ce bled.
- On se casse, je vous dis.
- Personne se tire ! hurla le plus petit des trois qui semblait être le chef. On est aussi bien ici qu'ailleurs. Je vous ai dit que c'est ici qu'on attend Danny et Sainte-Rose, merde ! Personne se casse avant que je le dise.
Le silence retomba quelques instants.
- Bon, qu'est-ce qu'on en fait de la minette ? On la laisse crever ici ?
- Tu vois, mon pauvre Karim, ce qui est vraiment moche chez toi, c'est que t'as pas de cœur.
Sylvie vit un des hommes s'accroupir et introduire un revolver dans la bouche de sa victime. La détonation lui fit pousser un cri de terreur mais dans le vacarme, il passa heureusement inaperçu. Quand elle regarda à nouveau, elle était seule avec le corps inerte. Après avoir été prise de vomissements irrépressibles, elle attendit longtemps avant de réunir tout son courage pour remonter chez elle, faisant un grand détour pour ne pas s'approcher du cadavre. Elle pleura presque une heure dans son appartement, serrant contre elle son fils qui ne comprenait pas. Depuis, cette scène horrible, la peur, tenace, s'était emparée d'elle et ne l'avait plus quittée. Elle attendit le lendemain pour tenter une nouvelle sortie, en se jurant de ne pas regarder l'endroit où... Mais le corps n'était plus là et seule une grande tache sombre témoignait du fait qu'elle n'avait rien rêvé. Prise de faiblesse, elle était remontée chez elle sans même oser dépasser la porte d'entrée.
Sylvie ne comprenait pas très bien ce qui arrivait. Evidemment, comme tout le monde, elle avait entendu parler de l'épidémie qui rendait fou. C'était la raison pour laquelle elle ne laissait personne s'approcher d'elle et de son fils. Mais ce qu'elle ne comprenait pas c'était pourquoi les docteurs, la police ne venaient pas chercher ces malades, pourquoi on les laissait faire. Elle aurait voulu être un homme, une sorte de Rambo, et avec une mitrailleuse, elle aurait liquidé tout ça, malades ou pas. Il y a des moments, pensait-elle, où il ne sert plus à rien d'être gentil. Il faut agir, c'est tout. En attendant, elle était coincée avec Jérôme qu'elle ne savait pas soigner, le docteur Lacaze qui habitait juste en face avait disparu et l'hôpital était à quinze kilomètres. Il ne lui serait jamais venu à l'idée de voler une voiture. Elle avait bien pensé à dérober des antibiotiques à la pharmacie Méroux mais lesquels ? Elle n'était pas docteur et pas question de donner n'importe quoi à un enfant de 6 ans. De l'aspirine toutefois, un sirop... Elle se leva, indécise. Sortir ? Avec ces fous dehors qui attendaient leurs copains ? Elle s'approcha de Jérôme qui dormait tranquillement. La fièvre paraissait moins élevée mais ce n'était sans doute qu'un répit. Allez, c'est le moment ! Elle passa son manteau sans réfléchir davantage, courut de nouveau près du petit lit pour vérifier les couvertures et alla ouvrir sa porte. Elle prit la précaution de bien tout refermer à double tour et, deux minutes plus tard, elle se fondait dans la nuit noire.
Elle atteignit la pharmacie sans problème, procédant par successions de petits bonds, se cachant dans chaque recoin, derrière chaque arbre, chaque voiture. La porte du magasin avait été forcée et ce qui la rassura d'abord, l'inquiéta ensuite quand elle vit le capharnaüm à l'intérieur. Elle s'éclairait avec sa lampe électrique par de brefs éclairs au hasard mais elle avait du mal à s'orienter. Elle crut qu'elle n'y arriverait jamais. Elle marchait sur des boites de médicaments, bousculait des sacs, des paquets qui tombaient avec un bruit mou sur le sol jonché de débris. Elle tirait de longs tiroirs presque vides d'où elle ne sortait que des médicaments aux noms bizarres, inconnus. Pleurant à moitié, sentant la panique l'envahir, elle eut tout à coup l'idée de regarder par ordre alphabétique, se rappelant comment procédait le vieux père Méroux, avant. Elle cria de joie en voyant les boites bleues d'Aspégic enfants. Il y en avait trois, cela suffirait. Elle fourra maladroitement les médicaments dans la poche de son manteau, se pencha pour ramasser son marteau, seule arme qu'elle possédait, et se précipita vers la sortie. Les phares blancs d'une voiture que, dans sa hâte, elle n'avait pas entendu venir, balayèrent un dixième de seconde la devanture de la pharmacie. Sylvie se jeta de côté dans un renfoncement où on entreposait les livraisons avant inventaire. Elle vit la voiture effectuer un quart de tour et s'immobiliser de l'autre côté de la rue. Rien ne se passa pendant plusieurs minutes puis les portes du gros véhicule carré s'ouvrirent et les Autres descendirent. Deux. Un homme et une femme qui, sans se presser, s'approchèrent. Ils se dirigeaient droit sur elle. Elle se prépara à bondir, le marteau levé à mi-hauteur.
- Merde, merde et remerde, hurla Larcher en claquant le capot du 4X4.
Coralie se pencha par la portière.
- C'est grave ? demanda-t-elle.
- J'ai pas l'impression. Je crois que je l'ai noyée, c'est tout, lui répondit-il en se réinstallant derrière le volant. Quel con, non mais quel con ! poursuivit-il. A peine une borne que je reprends le volant et voilà que je noie le moteur...
- Si c'est que ça, c'est pas grave, Julien. Y a qu'à attendre. Et puis tu pouvais pas savoir qu'il y avait ce truc en béton sous les cartons...
- M'ouais. J'avais qu'à contourner.
- De toutes façons, un peu de repos nous fera du bien.
Après avoir quitté Paris, ils avaient eu beaucoup de mal à traverser la banlieue si peu sûre et encombrée de tant d'obstacles disparates. Ils avaient essuyé plusieurs jets de pierres, heureusement sans conséquence, avaient dû multiplier les détours pour éviter ce qui leur semblait être des pièges ou en tous cas des difficultés difficiles à surmonter, même pour leur véhicule tout-terrain. Une fois sortis de l'agglomération parisienne, les choses s'étaient un peu améliorées. Les espaces découverts s'étaient fait plus nombreux, la conduite moins hachée mais leur décision d'éviter systématiquement les villages les avait obligé à perdre encore du temps. Parfois, Larcher avait la sensation que ce voyage ne se terminerait jamais, que pour l'éternité ils seraient ainsi obligés de rouler, presque au hasard, à scruter sans fin la route à la recherche de l'écueil, du point noir qui les stopperaient définitivement. Sa compagne ne semblait pas en proie aux mêmes doutes et son attitude lui redonnait la détermination suffisante pour continuer.
Coralie se tourna vers l'arrière et escalada à moitié son siège pour s'emparer de leur panier à provisions. En mâchonnant son biscuit, une bouteille de Coca à la main, Larcher l'interrogea :
- On est encore loin ?
- En temps normal, non. Provins est à une dizaine de kilomètres ce qui fait donc une quarantaine pour Ste Hippolyte. Mais la nuit commence à tomber. On va devoir faire étape.
- Tu connais quelque chose par là ?
Elle le regarda comme s'il était devenu subitement fou.
- Je sais qu'il n'y a plus rien de sûr, évidemment, poursuivit-il en souriant, mais quand même...
- Ben, y a bien un petit hôtel à Provins où on réservait pour les amis quand il y avait trop de monde à la maison. Intéressant quand j'y pense car il y avait une sorte de cour intérieure où on pourrait garer la bagnole. Mais tu crois pas qu'on devrait plutôt dormir dans la caisse et repartir dès le petit jour ?
- Hmm, trop dangereux à mon avis.
La nuit était complètement tombée quand ils entrèrent dans la ville, tous leurs sens en éveil. Dans une des rues principales, heureusement dégagée étant donné leur état d'épuisement, Larcher repéra dans la lumière des phares l'enseigne d'une pharmacie.
- Tu as toujours mal à la gorge ? Y a une pharmacie juste devant nous.
- Pas au point de ne pas pouvoir me passer de médicaments.
- Des médicaments, justement on n'en a pas pris, je te ferai remarquer. C'est peut-être le moment. Et puis un sirop quelconque te ferait sûrement du bien. C'est pas le moment d'être malade, tu penses pas ?
Elle haussa les épaules sans répondre. Larcher arrêta la voiture. Le silence retomba. Il attendit quelques minutes puis fit signe à la jeune femme.
- C'est mieux qu'on y aille ensemble, d'accord ?
Coralie marchait à deux pas devant lui. La nuit sans lune donnait à la rue une apparence de tunnel obscur. Seule la lampe électrique de la jeune femme éclairait le paysage fantomatique, les murs lugubres. Tout à coup, à un mètre de l'entrée de la pharmacie, sortie de nulle part, une ombre qui paraissait immense se dressa et, le bras levé, se rua vers eux en poussant un hurlement dément. Les cheveux de Larcher se dressèrent sur sa tête. Coralie se jeta à terre sur le côté mais la silhouette était sur elle, brandissant une espèce de marteau. La jeune femme, dans un geste vain de défense, braqua sa lampe sur l'apparition qui hésita un dixième de seconde. C'était une femme en manteau noir, le visage déformé par la haine ou peut-être la peur. Larcher fit feu avant qu'elle ait pu abattre son arme de fortune et la femme bascula en arrière. Sans pouvoir se contrôler, il déchargea son revolver, ne s'arrêtant qu'en entendant le déclic du barillet vide. Il aida Coralie à se relever. Elle hoquetait de peur.
- Une Virale. C'était une Virale. Y en a partout, partout ! criait-elle sans pouvoir s'arrêter.
Larcher, encore tout secoué, ramassa la lampe électrique et prit la jeune femme dans ses bras en la serrant le plus fort qu'il put contre lui. Ils s'approchèrent du cadavre. Evitant d'éclairer son visage, il se pencha vers elle. La main gauche de la femme était toujours enfoncée dans la poche de son manteau. Larcher, avec une prudence extrême, saisit de deux doigts encore tremblants un bout du tissu de la manche et tira sur le bras. La main raidie de la femme laissa échapper un objet que Larcher éclaira de la lampe. C'étaient deux boites d'aspirine pour enfants.
Tous droits réservés
copyright 943R3EB
-
Commentaires