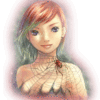-
Mardi 1er avril
Larcher avait passé une grande partie de la nuit dans des cauchemars atroces, à lutter contre des dizaines de Jude qui voulaient l'assassiner de mille façons différentes. Coralie ne faisait partie de ses rêves que sous la forme d'une présence floue, quelque part auprès de lui, qu'il n'arrivait pas à saisir. La seule fois où il avait réussi à l'approcher, à lui parler, il s'était aperçu qu'il s'agissait en réalité d'Élisabeth et une vague de nostalgie l'avait alors réveillé. Malgré tout, il se sentit reposé le lendemain matin quand il se leva. Il hésita à ouvrir les volets de la chambre par peur que ce geste, par sa répétition, ne finisse par attirer l'attention. Il s'immobilisa un instant pour bien marquer sa décision de ne pas oublier d'y réfléchir plus tard puis il enfila rapidement ses vêtements et sortit de la pièce. La jeune femme était déjà levée et s'était installée dans la cuisine. Elle lisait l'exemplaire chiffonné du Figaro qu'elle annotait avec un petit crayon doré. Elle lui fit un large sourire.
- Bonjour, Julien, bien dormi ?
- Plus ou moins et vous ?
- On se tutoyait pas, hier soir ? répondit-elle en continuant de sourire.
- Hmm, oui, c'est vrai.. Je ne sais pas pourquoi je... Excuse-moi. Alors, toi, t'as bien dormi ?
- Peu mais assez bien en définitive, merci.
Larcher s'empara d'une chaise et s'installa face à elle tandis qu'elle jouait pensivement avec le petit stylo. Elle releva les yeux et le regarda plonger la main dans le paquet de cookies.
- Dis-moi, Julien. Tu es toujours d'accord pour qu'on continue, enfin... pour qu'on essaie de faire un bout de chemin ensemble, comme on avait dit hier soir ? Je veux dire...
Il hocha la tête, le visage sérieux.
- Tout à fait. Tout à fait ! Si tu me fais confiance ! Si on se fait confiance... Je crois qu'à nous deux, on a bien plus de chances de s'en sortir. Ce serait vraiment con de pas essayer. Je sais que ça va être dur mais à deux je suis sûr qu'on y arrivera. On arrivera à sortir de toute cette pourriture. C'est le seul moyen. Et puis, on rencontrera sûrement d'autres gens comme nous. Y a pas de raison. Tu crois pas ?
Elle acquiesça en silence puis se redressant soudain :
- Heu, je suis désolée mais, comme tu sais, y a pas de café. Rien que du coca. A ce propos, justement... Tu vois, poursuivit-elle en sortant une feuille de papier de dessous le journal, j'ai fait une liste de ce qui me paraît indispensable si on veut pas crever de faim.
Larcher s'empara de la feuille et la parcourut rapidement.
- C'est à peu près ce que j'avais trouvé au magasin de la rue de Vaugirard quand les autres salauds m'ont intercepté, remarqua-t-il. Mais il faudrait ajouter deux-trois trucs auxquels j'ai pensé depuis, comme d'autres lampes, un réchaud à gaz - mais ça, je vois que tu l'as déjà marqué - ou des piles, des accumulateurs, des batteries, enfin des tas de trucs comme ça pour faire remarcher les petits appareils électriques. Ca doit être possible, non ?
Coralie avait repris le papier et le complétait au fur et à mesure tandis que Larcher grignotait ses gâteaux secs. La bouche pleine, il reprit :
- Je vois que t'as remis tes vêtements. T'as rien trouvé dans l'armoire d'Elisabeth ? Vous avez à peu près la même taille, non ?
- Si, deux ou trois trucs. Mais, en plus du fait que je préfère mettre mes affaires - à ce propos, il faut qu'on passe chez moi - je suis sale comme un peigne. Je vais d'ailleurs prendre la salle de bains si tu es d'accord. Quelque chose me dit qu'il faut profiter de ce que l'eau n'est pas encore coupée chez toi. Evidemment, se débarbouiller à l'eau froide n'est pas des plus réjouissants mais je peux t'assurer que c'est drôlement mieux que rien. Bon, j'y vais. Après on dresse notre plan de bataille, d’accord ?
Il la regarda partir et étira voluptueusement ses bras. Ils avaient du pain sur la planche et plutôt intérêt à bien choisir leurs interventions diverses, se dit-il. Il reprit à nouveau la liste et y rajoutait un récepteur à ondes courtes qui pourrait peut-être les aider à en savoir un peu plus sur l'état du reste du monde quand elle l'appela d'une voix étrangement contractée.
- Julien, viens voir.
Elle regardait par la fenêtre de la chambre d'amis qui donnait sur l'autre extrémité de la rue Duranton. Il s'approcha d'elle et regarda à son tour. A l'angle de la rue, environ deux cents mètres plus bas, un char manœuvrait. Le blindé semblait hésiter comme s'il cherchait à repérer quelque chose. Il s'arrêta en plein milieu de la chaussée, sa tourelle tournant dans un sens puis dans l'autre. A présent qu'il faisait attention, Larcher pouvait entendre, assourdis, le rugissement des puissants moteurs. Soudain, comme pris d'une inspiration subite, l'énorme véhicule recula brutalement, bousculant plusieurs voitures et écrasant un petit arbre, et s'élança à 180 degrés. Il disparut dans un panache de fumée bleue.
- Je me demande bien ce qu'ils cherchent, murmura Coralie.
- Je ne sais pas, lui répondit Larcher, mais tout ça n'est pas très engageant. On va avoir intérêt à faire gaffe avec le 4X4 parce que ces connards sont capables de nous allumer sans sommation.
- Tu crois ? Pourquoi nous ? Ils peuvent pas tirer sur tout ce qui bouge, non ?
- Mais les Gardes Mobiles, l'autre jour. Ceux que j'ai vu au carrefour en haut...
- Tu m'as dit qu'ils avaient tiré sur des pillards, non ?
- Et qu'est-ce qu'on va faire quand on ira se ravitailler ?
Elle ne répondit pas, fixant toujours l'endroit où le char avait disparu. Il la prit par les épaules et la serra contre lui. Il se rendit compte que c'était la première fois depuis des jours qu'il touchait un autre être humain et il en fut très ému.
- Allez, pas de découragement. Il n'y en a sûrement pas des milliers et puis, merde, on doit les entendre venir... De toute façon, on n'a pas le choix. On fera très attention, c'est tout. Mais, ça me conforte dans ce que je crois.
- C'est-à-dire ?
- Qu'il nous faudra assez rapidement quitter Paris. Peut-être plus vite que prévu. D'autant qu'avec tous ces morts, il va sûrement y avoir des épidémies. Et puis, cette racaille...
Elle s'écarta doucement de lui. Arrivée à la porte, elle se retourna.
- Julien, je crois que tu as raison. Faut pas s'éterniser ici, souffla-t-elle.
Larcher était repassé par l'armurerie pour y remplacer son fusil perdu. Il avait forcé Coralie à prendre, malgré sa réticence, un pistolet automatique dont il lui avait longuement expliqué le fonctionnement sans être tout à fait sûr qu'elle puisse s'en servir le cas échéant. Il n'avait pas voulu retourner dans le Monoprix, plus par superstition que par crainte véritable de s'y heurter à Jude qui devait de toute façon zoner dans les environs et qu'ils pouvaient rencontrer à n'importe quel coin de rue. Ils avaient repéré une supérette du côté de l'avenue Félix Faure et, après avoir garé leur véhicule à proximité, ils passèrent plus d'une heure à surveiller les environs, à moitié enfoncés dans leurs sièges, n'échangeant que de rares paroles. En fait, ces précautions auxquelles ils s'astreignaient étaient certainement illusoires. Qui pouvait garantir qu'on ne les guettait pas depuis un quelconque recoin, qu'une bande de Viraux n'attendait pas qu'ils se risquent à découvert pour leur fondre dessus ou même qu'un tireur embusqué ne les prenne subitement pour cible, pour rien, pour le simple plaisir de se défouler, dans cette ville livrée à l'arbitraire et aux prédateurs ? Mais leur prudence relative les rassurait. A bien observer, pourtant, dans ces rues abandonnées, une certaine vie continuait à se manifester. Une bande de chiens qui passaient en reniflant nonchalamment les arbres, des pigeons qui picoraient on se demandait bien quoi, des bruits de moteur à quelques rues de là, deux ou trois silhouettes apeurées dont ils n'aperçurent que les mouvements furtifs, les reflets à peine ébauchés, pauvres vies errantes vraisemblablement encore plus craintives qu'eux-mêmes, témoignaient du fait que la ville n'était pas encore tout à fait morte. A un moment, stupéfaits, ils aperçurent une femme tout en rouge qui descendait lentement l'avenue à bicyclette en tenant d'une main une grande ombrelle pour se protéger du soleil intermittent. Brusquement, la femme se mit à pédaler avec frénésie et disparut dans une rue adjacente. Une Virale, sans doute, murmura Coralie, elle n'ira pas loin. Larcher, enfin, se décida à approcher la voiture, moteur à bas régime, devant la porte béante de la supérette. Laissant l'engin tourner au ralenti, il descendit prudemment tandis que sa compagne s'installait au volant. Il entra lentement dans le magasin, méfiant. Malgré les prélèvements importants de ceux qui étaient passé avant eux, il réussit à trouver suffisamment de marchandises diverses pour remplir le Range-Rover à ras-bord. Larcher n'était pas étonné de voir que tant de monde semblait être venu se servir dans le petit établissement alors qu'il ne voyait - et c'était tant mieux - presque jamais personne dans les rues. Il poussa un soupir de soulagement quand la jeune femme relança le 4X4.
L'appartement de la rue Duranton ressemblait à présent à une boutique de receleur avec ses multiples caisses, boites, paquets et bouteilles, empilés en vrac dans l'attente de l'inventaire qu'ils s'étaient promis de faire. Et c'était d'ailleurs bien ce qu'il était, l'appartement, un véritable entrepôt de marchandises, remarqua Coralie, presque étonnée. S'ils avaient décidé de quitter la ville, ils n'avaient pas encore choisi le moment exact de leur départ. En revanche, leur destination était connue : la résidence secondaire de la jeune femme située à une centaine de kilomètres à l'est de Paris, où ils espéraient bien échapper aux miasmes mortels de la grande cité. Par peur d'avoir été repérés, rendus presque paranoïaques par l'environnement hostile, ils avaient décidé de transférer toutes leurs acquisitions dans l'appartement. Comme ça, si quelqu'un vient voler ou vandaliser le 4X4 dans son box, on n'aura pas tout perdu, avait conclu Larcher. Il le regretta presque par la suite tant le transfert de tous les objets au long des cinq étages l'avait épuisé. Il ne pouvait plus souffrir ces couloirs sinistres et, s'ils ne s'étaient pas décidés à partir, il aurait probablement proposé d'émigrer pour un logement moins haut situé, il y en avait sûrement des milliers de vacants à présent.
- J'ai peur, Julien, tu sais, je suis morte de trouille.
Larcher regarda la jeune femme qui s'était assise en face de lui sur le canapé du salon, les jambes repliées sous elle, une boite de tonic à la main.
- Ecoute, lui répondit-il, je sais que ce n'est pas parfait mais la porte d'entrée est blindée. Impossible d'entrer sans qu'on s'en aperçoive. D'ailleurs, depuis le début, je n'ai pas entendu une seule personne dans cet immeuble. En tous cas, à cet étage.
- Ce n'est pas ce que je veux dire, reprit-elle en le regardant droit dans les yeux. Ce qui me fait peur, c'est ce qui pourrait nous arriver, ce qui pourrait m'arriver. J'ai peur de tomber malade comme les autres. Peut-être sans m'en rendre compte. Ou en m'en fichant ce qui est encore pire. Tu les a vus, ces pauvres gens, ils ne savent même plus ce qu'ils font, ni qui ils sont. Ils se battent entre eux comme des bêtes. Ils n'ont plus rien d'humain. A la radio, enfin quand elle marchait encore, ils disaient qu'il y en a qui se suicident ou qui meurent par accident simplement parce qu'ils ne se rendent plus compte du danger, parce qu'ils sont en dehors de la réalité. Il y en a d'autres qui attaquent tout ce qui bouge... Pourquoi ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ?
En l'écoutant, Larcher se rendait compte qu'ils n'avaient jamais vraiment évoqué entre eux ces angoisses qui les taraudaient. Ils s'étaient lancés dans des actions de survie, des actions immédiates, évidemment indispensables, comme si cela avait été un moyen d'ignorer cette menace qui les entourait, comme si le quotidien permettait d'oublier la grande peur, leur fragilité, leur impuissance. Mais comment faire autrement pour accepter ce qui n'était peut-être qu'une parenthèse, un sursis ?
- Je ne sais pas, murmura-t-il. D'après ce qui a été dit, ce serait un nouveau virus, une mutation ou je ne sais quoi. Un truc qui attaque les neurones, les cellules nerveuses du cerveau. De l'homme, car les animaux semblent épargnés et...
- Je sais, je sais. Dans le journal, ils parlent d'un virus qui modifie les hormones du cerveau, qui rend les gens comme fous. Mais en disant ça, on n'a rien dit. Absolument rien. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi maintenant, pourquoi si brutalement ? Comment ça a pu arriver si vite ? Si vite qu'on a même pas eu le temps de s'organiser. Tout s'est effondré si rapidement, comme un château de cartes. Une civilisation entière ! Faut croire quand même que tout ça n'était pas si solide. Et ceux qui restent ne sont même pas sûrs... Tu comprends, dans une grande catastrophe, un tremblement de terre, la guerre, ceux qui survivent savent au moins qu'ils s'en sont sortis, qu'ils peuvent peut-être recommencer. Mais pas nous, pas nous, c'est ça qui me désespère !
- Allons, Coralie, pas de déprime. Le pire n'est jamais sûr, voyons. Tu sais qu'on dit aussi dans le journal qu'il y a peut-être des gens qui sont immunisés d'emblée à ce truc et que...
- Qu'est-ce qu'ils en savent, merde !
- Il y a quand même le fait que, toi et moi, depuis une semaine que nous sommes dans cette ville... Et que nous nous promenons sans précautions particulières...
- Mais sans rencontrer de Viraux. De près, je veux dire.
- Faux pour moi. Jude et les autres, je les ai vus de près et je peux te certifier que c'étaient bien des dingues ! Quoique… À y bien réfléchir… Je me demande si c’est vraiment des malades ou… de la simple racaille…
Coralie avala une longue gorgée de tonic, regarda autour d'elle puis revint à Larcher.
- Tu es croyant, Julien ?
- Heu, ça dépend mais, heu, oui, je crois qu'on peut dire que je suis croyant.
- Eh bien pas moi. Et c'est pas maintenant que... Mais si j'étais croyante, je veux dire, si je pensais qu'il y a une explication, une volonté, un but, quoi, je serais persuadée qu'il s'agit d'une espèce de vengeance divine, d'une malédiction. La main de Dieu sur ses ouailles. Et après un avertissement déjà car le SIDA, c'était bien aussi un virus, non ? Mais je crois pas à toutes ces foutaises. Je suis trop rationnelle, tu vois. Pour moi, tout ça, c'est un hasard malheureux, un accident de la nature. Et c'est bien de penser ça qui me désespère. De penser qu'avec un peu de chance rien n'aurait pu se produire. Au lieu de ça, toute une civilisation qui disparaît, ces siècles d'efforts, de luttes, de guerres, tous ces morts, pour rien. Rien. On va laisser nos monuments à des animaux qui ne les verront même pas... Quelle connerie, quel gâchis...
Elle s'était mise à pleurer silencieusement. Larcher se leva, s'assit à côté d'elle, la prit dans ses bras. La douleur de la jeune femme, sa propre angoisse, l'étranglaient. Il aurait voulu la consoler, trouver des mots, des phrases mais il ne pouvait que la serrer contre lui en la berçant et en lui caressant lentement les cheveux. Finalement, il réussit à lui parler doucement, comme à un enfant triste qu'on veut rassurer malgré la réalité qui blesse. Au delà de ses phrases incertaines, ce fut sa voix, sa présence qui arrivèrent à la calmer. Ils restèrent un long moment l'un contre l'autre sans prononcer une parole. Puis Coralie le repoussa gentiment et se leva d'un coup.
- Ca va mieux. Un coup de fatigue sans doute. Je vais aller me coucher, Julien, je suis vannée.
Il la rejoignit quand elle se fut enfoncée dans son lit. A la lueur tremblotante de la bougie, ses cheveux ressemblaient à une tâche de nuit sur l'oreiller et donnaient à son visage une allure de toute petite fille.
- Ça va ? chuchota-t-il.
- Ça va.
Il se pencha pour lui embrasser le front mais, comme il se relevait, elle arrêta son mouvement de la main.
- Julien, j'aimerais que tu dormes avec moi, cette nuit.
Comme il ne répondait pas, elle murmura en souriant.
- Si tu le veux bien, évidemment.
suite ICI
Tous droits réservés
copyright 943R3EB
 votre commentaire
votre commentaire
-
Jeudi 3 avril
Le jour se levait à peine. Un jour gris et terne, en plein accord avec ce monde délabré. Un vent froid faisait tourbillonner les dizaines de papiers et vieux journaux qui jonchaient le sol. Larcher conduisait lentement, prenant le temps de vérifier chaque obstacle avant de le contourner, prêt à faire marche arrière à la moindre alerte. Ils devaient traverser presque tout Paris pour se rendre porte de Bagnolet d'où ils espéraient quitter la ville après une étape rapide à l'appartement de la jeune femme. Elle désirait absolument emporter avec elle certains vêtements et probablement aussi quelques souvenirs, avait pensé Larcher. Ce dernier, après une soirée passée avec elle à compulser de multiples cartes routières, avait peu dormi, refaisant continuellement des itinéraires, cherchant à anticiper les problèmes qu'ils risquaient de rencontrer et surtout les réactions appropriées à y apporter. A présent qu'il se retrouvait dans l'action, il se sentait plus calme, soulagé. Il engagea la voiture dans la rue de la Convention, en direction de la place Victor Basch, plein est, bien décidé, si cela était possible, à suivre cet axe qui devait les amener là où ils le voulaient. Il caressa de sa main droite la coupure de son menton qui ne saignait plus. Malgré la répulsion qu'avait fini par lui inspirer sa salle de bains si pauvrement éclairée par une bougie puis par une lampe à gaz guère plus efficace, il avait tenu à se raser tous les jours, un peu à la manière de ces Anglais qui, oubliés sur une île déserte, mettent un point d'honneur à passer leurs smokings pour dîner, solitaires, sous les étoiles. Il se tourna vers sa compagne.
- Dis-moi, Coralie, est-ce que ta salle de bains de Ste Hippolyte est éclairée par le jour ? Parce que j'en ai ma claque de me couper tous les jours en me rasant...
Plongée dans son plan de Paris, elle ne lui répondit pas immédiatement.
- Hein ? Heu, oui. Tu verras, il y a plein de...
S'interrompant, elle lui saisit le bras.
- Je sais, j'ai vu, siffla-t-il entre ses dents.
Plantée en plein milieu de la rue d'Alésia qu'ils venaient d'emprunter, une femme les regardait venir, immobile, deux enfants à ses côtés. Larcher ralentit le 4X4 et chercha à les éviter par un lent mouvement tournant mais quand ils arrivèrent à leur hauteur, la femme vint à leur rencontre et frappa du plat de la main sur la vitre de Coralie qui, inconsciemment, se courba. La femme répétait toujours les mêmes mots : " Aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi ". Les yeux fixés sur la chaussée, Larcher accéléra. Quand elle comprit qu'ils ne s'arrêteraient pas, la femme poussa un véritable cri de désespoir et se lança après la voiture en martelant de ses poings le hayon arrière. Les enfants couraient après elle en pleurant. Distancée, elle s'immobilisa et se laissa tomber à même le sol. Larcher vit leurs silhouettes diminuer dans son rétroviseur. Leur voiture arrivait rue d'Alésia. Les véhicules de tous genres abandonnés un peu partout devenaient plus nombreux. Il se concentra sur sa conduite. Deux cadavres décomposés gisaient en travers du trottoir et il accéléra pour leur échapper. Coralie ne semblait pas les avoir vus bien qu'elle ne soit pas retournée à son plan. Sans le regarder, elle murmura :
- On pouvait pas les prendre. On pouvait pas. On pouvait pas.
- Je sais.
- On pouvait pas. C'était peut-être une Virale. Et puis, qu'est-ce qu'on aurait fait d'eux ? Les enfants... On peut rien faire. Rien d'autre que foutre le camp de toute cette misère.
Ils eurent du mal à franchir la place Victor Basch. Des carcasses de voitures brûlées, des caisses, des valises aux contenus éparpillés, des cadavres encore, des dizaines de cadavres de tous âges, témoignaient qu'à cet endroit des luttes féroces avaient opposé pour des motifs que l'on ne connaîtrait jamais toute une population en proie à une panique incoercible. Larcher dut faire preuve de beaucoup d'habileté pour franchir ces tristes épaves. Pour reprendre pied rue d'Alésia, de l'autre côté du carrefour, il fut obligé de faire monter le 4X4 sur le trottoir et de pousser avec son pare-choc une camionnette couchée en travers. Le moteur du puissant véhicule rugissait sous l'effort tandis que la camionnette s'écartait progressivement dans un sinistre raclement de tôle. Alors que la route était presque dégagée, une ombre soudain jaillit devant leur pare-brise, leur glaçant le sang, mais ce n'était qu'un chat qui détala en miaulant.
Le franchissement de l'avenue d'Italie leur posa moins de problèmes qu'ils auraient pu le craindre mais ce fut un peu plus loin qu'ils se heurtèrent à leur première difficulté réelle. Après quelques centaines de mètres, la rue de Tolbiac était barrée d'un côté à l'autre par une barricade faite de carcasses de voitures et d'objets disparates que, à moins d'avoir disposé d'un véhicule blindé, il était hors de question de franchir. Larcher arrêta la Range, passa au point mort et s'exclama :
- Bon, ben y a pas à tortiller, faut faire demi-tour et trouver un autre chemin. Il commençait la manœuvre quand Coralie hurla :
- Julien, regarde !
De la barricade, quelques silhouettes avaient émergé et s'était mises à courir vers eux. Mais ce n'était pas ce que lui désignait la jeune femme, il s'en rendit compte presque instantanément. Elle montrait du doigt un groupe d'hommes qui arrivait de l'autre côté, depuis l'avenue d'Italie. Il termina le cœur battant son demi-tour, marqua un temps d'arrêt puis, emballant le moteur, il hurla :
- Accroche-toi !
Le 4X4prit de la vitesse. En la voyant s'approcher, les individus s'écartèrent lentement, comme à contrecœur, à l'exception d'un seul, un grand barbu vêtu de cuir, aux longs cheveux noirs lui coulant sur les épaules, qui les attendait, bien campé sur ses deux jambes et serrant à deux mains un lourd piquet de métal. A deux mètres de la voiture, le barbu leva sa masse mais il n'eut pas le temps de l'abattre. La voiture le heurta avec une violence inouïe, le projetant sur le pare-brise qu'il étoila. Il bascula par dessus le toit dans une traînée de sang qui gicla sur la vitre de Coralie. La jeune femme put voir le corps désarticulé qui rebondissait comme un pantin sur la chaussée, le bruit mou de sa chute arrivant à couvrir le vrombissement du moteur. La dernière vision qu'elle eut de lui, ce fut son corps aplati dans une flaque de sang, la tête bizarrement tordue à quatre-vingt dix degrés. Les autres se mirent à les bombarder de projectiles divers mais leur auto était solide et seul les atteignit le bruit des objets s'écrasant sur la carrosserie. Ils entendirent peu après plusieurs détonations et deux fois l'impact de balles dans la tôle de leur voiture avant d'être hors de portée. Larcher repassa par le chemin qu'ils venaient d'emprunter, envoyant dinguer au passage les restes d'une moto. Il engagea sans attendre le 4X4 sur l'avenue d'Italie et ne se mit à ralentir qu'après plusieurs centaines de mètres. Personne ne les avait suivis. Coralie, pâle comme une morte, n'arrivait pas à trouver ses mots.
- Mais... T'as vu ? C'était quoi, ces types ? Des Viraux ? Des loubards ?
- Sais pas. Peut-être les deux...
- Merde, j'ai eu une de ces frousses. Tu vois pas si la voiture avait calé ?
- Ce genre de voiture, c'est rare.
- Ou s'ils avaient atteint les pneus ?
- L'essentiel c'est qu'on ait pu se tirer.
Il se disait que cela aurait été bien pire si les Viraux leur avaient jeté des cocktails Molotov mais il ne fit pas part de sa réflexion à sa compagne.
Ils firent un grand détour par le sud et se retrouvèrent sur les boulevards extérieurs qu'ils décidèrent de suivre jusqu'à la Seine. Larcher pensait que si la panique avait bien été ce qu'il imaginait, ces boulevards qui relient intérieurement les sorties de Paris seraient difficilement praticables d'où le choix de son premier itinéraire. Et de fait, un embouteillage monstre avait jonché d'automobiles enchevêtrées toute cette partie de la ville. Toutefois, les trottoirs étaient larges et relativement dégagés. En les empruntant de manière quasi-continue, il était possible d'avancer quand même. Le seul point noir demeurait les arrivées des grandes avenues venant du centre et ils durent déployer des trésors d'ingéniosité pour passer. Ils échangèrent plusieurs fois le volant tant la tension de la conduite était éprouvante à serpenter au milieu de toutes ces carcasses inertes. Ils n'hésitaient plus à se servir du Range comme d'un bulldozer, écartant parfois avec violence les épaves qui se présentaient devant eux. Larcher se surprit même à éprouver une sorte d'excitation à pousser avec son puissant véhicule les innombrables voitures dont certaines cédaient avec des craquements sinistres de verre brisé et de tôles froissées. Il commençait à s'habituer à cet univers d'acier immobile, à cette gigantesque partie de stock-cars. Le plus difficile, au début, avait été de croiser les quelques cadavres, heureusement peu nombreux, qui parsemaient parfois la chaussée. Il arrivait à présent à les regarder sans les voir, presque blasé, se contentant de détourner les yeux sans trop y penser. Ces images devaient quand même inconsciemment le marquer puisque certaines d'entre elles allaient revenir plus tard peupler ses cauchemars.
Quand elle ne conduisait pas, Coralie se tenait arcboutée de la main droite à son accoudoir, l'autre main crispée sur son revolver, fouillant des yeux les alentours à la recherche du moindre mouvement mais, en dehors d'eux, l'environnement était quasi-minéral. Ils auraient pu se croire les derniers vivants dans cette partie du monde. Dès qu'ils arrivèrent boulevard Masséna en direction du pont National, Larcher su qu'à moins d'efforts démesurés ils n'arriveraient pas à franchir le conglomérat métallique dont le serpent démentiel devait s'étendre jusqu'à l'entrée de l'autoroute de l'est à quelques kilomètres de là. Ils décidèrent donc de remonter vers le centre pour franchir la Seine au pont de Tolbiac un peu plus haut. A contre courant du flux immobile, ils se frayèrent un passage sur le quai de la Gare. Au fur et à mesure qu'ils s'éloignaient de la périphérie, la route devenait plus praticable. Larcher qui n'avait pas desserré les dents depuis un long moment se détendit progressivement.
- Eh bien, je crois qu'on a quand même fait le plus gros, lança-t-il à la jeune femme. Enfin, pour le moment parce que porte de Bagnolet, tout à l'heure, j'ai bien peur... Mais, chaque chose en son temps. Tu veux bien reprendre le volant parce que je suppose que tu connais mieux ce quartier que moi maintenant ?
Ils échangèrent leurs places une fois de plus. La rue de Wattignies était quasiment déserte et Coralie, poussant un long soupir de soulagement, gara la voiture devant un grand immeuble moderne dont la blancheur éblouissait les yeux sous les rayons du soleil réapparu comme pour des retrouvailles. Elle se retourna vers Larcher.
- C'est là. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu viens avec moi ou tu préfères garder la bagnole ? Note bien que j'en ai pas pour très longtemps : j'empile quelques trucs dans une valise et c'est tout.
- Le mieux, je crois, c'est que je reste dans l'entrée. Tu m'as bien dit que c'était au premier, non ? Alors, comme ça, je surveille la voiture mais tu m'appelles s'il y a quoi que ce soit. Avant de repartir, on nettoiera un peu, ajouta-t-il en désignant d'un signe de tête la traînée de sang coagulé qui maculait la vitre avant-droite de la voiture.
Au moment de pousser la porte qui donnait sur l'escalier, Coralie se retourna vers Larcher qui la regardait partir, appuyé contre la porte d'entrée de l'immeuble, et lui fit un petit signe de la main. Sans un regard pour l’ascenseur qui lui faisait face, immobile à jamais, elle monta rapidement les quelques marches et arriva sur le palier du premier étage. Elle fronça le nez en raison de la vague odeur de moisi qui y flottait. Une odeur de mort, pensa-t-elle en frissonnant. Elle introduisit ses clés dans sa porte d'entrée qui n'avait pas été forcée ce qui la réconforta un peu. Bien qu'elle fut sur le point de quitter sans doute définitivement l'endroit où elle avait vécu tant d'années, elle était soulagée de ne pas le retrouver vandalisé, de ne pas découvrir ses affaires dispersées ou volées. L'appartement était exactement dans l'état où elle l'avait laissé quatre jours plus tôt. Son regard erra lentement sur tous ces objets qu'elle avait choisis avec tant de soin, dans un temps qui lui parut infiniment lointain. Son sac à main était toujours en équilibre instable sur la table basse du living, dans la position précise où elle l'avait abandonné quand elle avait jugé qu'il serait certainement une gêne pour son expédition qui avait failli si mal tourner. Une fois de plus, elle repensa à son mari, se demanda ce qui avait bien pu lui arriver. A présent qu'elle quittait Paris, elle savait qu'elle ne le reverrait jamais. Elle secoua la tête et se précipita vers le placard aux valises, en choisit une de taille moyenne où elle empila quelques vêtements, plus pour leur aspect utilitaire que parce qu'elle les aimait vraiment, des sous-vêtements, des chaussures souples, son nécessaire de toilette, un flacon de parfum. Elle compléta avec deux ou trois photos, quelques lettres, sa réserve de contraceptifs oraux et, pour finir, ses papiers personnels qu'elle extirpa de son sac à main. La valise se referma avec un claquement sec. Elle y jeta en travers sa veste de fourrure à laquelle elle tenait tout particulièrement, seule entorse à ce qu'elle s'était promis d'emporter avec les bijoux qu'elle enfourna dans la poche intérieure de la grosse veste de laine que lui avait prêtée Larcher. Voilà, ici c'est fini, murmura-t-elle en contemplant une dernière fois l'appartement où elle n'avait pas été en définitive si malheureuse. Elle claqua la porte derrière elle, prit le temps, force de l'habitude, de donner un tour de clés puis balaya le couloir de sa lampe électrique. Elle poussa un cri étouffé en découvrant la silhouette d'un homme appuyé contre le mur, à deux mètres d'elle. Elle n'eut pas le temps d'appeler Larcher. Déjà, l'homme se jetait sur elle et lui bâillonnait la bouche avec sa main. En se débattant, folle de terreur, elle pouvait voir le faisceau de sa lampe projeté au hasard sur les murs et une silhouette se lever de devant la porte de l'appartement voisin. Le deuxième homme s'approcha lentement tandis que le premier arrivait, malgré ses coups de pied désordonnés, à l'immobiliser complètement. Haletante, elle abandonna sa lutte silencieuse. Elle se sentait épuisée et totalement abattue. Elle entendit l'homme qui la maintenait fermement par derrière lui murmurer :
- Là, là, c'est tout, ma belle. Faut être sage maintenant. Tu me comprends bien, hein ? Bon, alors, voilà ce que tu vas faire. Tu vas donner gentiment tes clés à mon copain et on va aller discuter tranquillement dans ton appart. Allez, exécution.
Comme elle ne bougeait pas, paralysée par la terreur, l'homme lui arracha les clés qu'elle avait encore dans sa main gauche puis s'empara doucement de sa lampe toujours allumée. Il jeta les clés au deuxième homme avec un petit rire satisfait et murmura :
- Allez, Fredo, ouvre donc la porte puisque la dame nous invite si gentiment...
Au moment où le deuxième homme enfonçait les clés dans la serrure, la voix de Larcher claqua comme un coup de tonnerre dans le silence.
- Bougez plus et toi, tu la lâches.
Coralie sentit l'homme tout contre elle qui raffermissait sa prise dans un sursaut de surprise tandis que Fredo se retournait lentement vers l'escalier, un rasoir à la main. Après, tout se passa si vite que Coralie ne put jamais par la suite distinguer exactement la séquence des événements. La lampe s'éteignit et elle entendit un choc, des cris, des grognements, le bruit d'une lutte. Son tortionnaire cria :
- Fredo, fais-lui la peau à ce con. Moi, je tiens la nana.
En disant cela, l'homme relâcha imperceptiblement son étreinte et Coralie en profita pour lui mordre le plus profondément possible la main. L'homme poussa un rugissement de douleur et laissa échapper la jeune femme. Une demi-seconde plus tard, il rallumait la torche mais Coralie avait sorti son revolver, relevé la sécurité et sans viser appuyé sur la gâchette. La détonation produisit une explosion gigantesque. L'homme s'effondra en lâchant la lampe dont le faisceau éclaira une brève seconde son visage déchiqueté. Coralie ne pouvait plus s'empêcher de crier. Elle entendit une seconde détonation au moment où la lampe de poche de Larcher balayait en ombre chinoise le deuxième homme qui s'écroulait sans un bruit en laissant une grande tâche sombre sur le mur du couloir. Secouée de sanglots incontrôlables, Coralie se jeta dans les bras de Larcher qui lui embrassa fébrilement le visage et les cheveux en hurlant :
- Tu es blessée, réponds-moi, tu es blessée ?
Au bord de l'évanouissement, elle n'arrivait pas à parler. L'odeur de cordite était omniprésente. Il la fit asseoir à distance des deux corps, lui laissa quelques minutes pour se reprendre, en la serrant fermement contre lui. Malgré elle, qui s'accrochait désespérément, il se releva.
- Allez, viens ma douce, faut pas moisir ici.
Il la saisit par un bras, fit quelques pas avec elle, puis, sans cesser de l'éclairer, revint en arrière pour s'emparer de la valise et du manteau. Coralie sanglotait toujours, son revolver à la main. Il la conduisit sans un mot dans l'escalier. Dehors, le soleil les accueillit comme dans un autre univers. Jetant furtivement des regards autour d'eux, Larcher l'installa avec précaution dans la voiture, jetant la valise et le manteau au hasard vers l'arrière. Quand ils quittèrent la rue de Wattignies, il se tourna vers elle.
- Alors, ça va mieux ?
Elle haussa les épaules sans lui répondre. Le visage blême, elle fixait le tableau de bord, les yeux dans le vague, prunelles écarquillées. Elle secoua la tête, le regarda en souriant faiblement et posa sa main au dessus de la sienne, sur le levier de vitesses.
- Comment t'as su ? souffla-t-elle.
- Trop long. C'était trop long. Quand je suis arrivé en haut de l'escalier, j'ai entendu parler à voix basse alors...
- Je suis désolée. J'aurais dû...
- Pas de ta faute. Mais tu t'es bien défendue. On en parlera plus tard si tu veux. Maintenant, ce qu'il faut, c'est quitter ce bled pourri.
Elle se serra contre lui un bref instant, la tête contre son épaule, puis se redressa et s'empara du revolver qui gisait sur ses genoux.
Tous droits réservés
copyright 943R3EB
 votre commentaire
votre commentaire
-
Jeudi 3 avril (suite)
Le spectacle était terrifiant. L'angoisse sourde qui n'avait pas quitté Larcher depuis le début de ce qu'il appelait pudiquement "les événements", comme si de ne pas verbaliser l'horreur de la situation nouvelle pouvait en atténuer l'intensité, s'était amplifiée jusqu'à être présente physiquement en lui, oppression invincible qui, de temps à autre, le forçait à inspirer très profondément pour gagner un supplément d'air. Il tourna les yeux vers le 4X4 où il avait obligé Coralie à s'enfermer, vitres relevées. La voiture était bien en vue au milieu de la place, en compagnie des quelques véhicules abandonnés avec lesquels il se confondait. L'espace était assez dégagé et il paraissait impossible de s'en approcher sans se faire repérer. Larcher pouvait apercevoir la silhouette parfaitement immobile de la jeune femme. Satisfait, il revint à son observation du périphérique dont, essentiellement par acquis de conscience, il s'était résigné à apprécier l'état. Avec le faible, très faible espoir qu'il y aurait quand même moyen de l'emprunter, peut-être par la voie de dégagement ou bien en utilisant la chaussée à contre-sens. Mais, dès le premier regard porté par-dessus le parapet de pierre, il s'était rendu compte que cela était absolument impossible. La vision était terrifiante. En dépit de tout ce qu'ils avaient dû vivre, malgré toutes les rues, les avenues sinistres qu'ils venaient de sillonner, il n'avait pu retenir un frisson devant la scène lamentable, le spectacle d'apocalypse qui s'étalaient devant lui. Des milliers de véhicules, encore et toujours, immobilisés à jamais. Presque exclusivement des voitures particulières comme pour un immense départ en week-end que le temps aurait figé brutalement. Quelques camions dont les toits surnageaient de ci, de là, et même un ou deux autocars englués dans la fusion de métal et de verre qui scintillaient au soleil d'avril. Par endroits, de rares taches de bitume restaient visibles et donnaient à croire que certains bienheureux avaient réussi à s'extraire du magma pour gagner un futur indécis. Certaines voitures étaient arrêtées de travers ou chevauchaient maladroitement leurs voisines dans une dernière étreinte rageuse, d'autres étaient complètement renversées, leurs roues posées comme autant de mains dressées dans une supplique impuissante au ciel indifférent. Deux ou trois incendies avaient fusionné les carcasses de tôle en d'étranges sculptures surréalistes enfermant dans une prison de mort leur cargaison de douleur. Mais, au-delà du silence sépulcral et de l'absence absolue de mouvement, on savait que ce ne pouvait pas être un départ de week-end gigantesque. Il suffisait de porter les yeux sur l'amorce de l'autoroute dont tous les accès, toutes les voies débordaient de voitures toutes tournées dans la même direction, celle de la sortie de la ville, celle de la fuite, celle de l'espoir impossible.
Larcher secouait faiblement la tête de droite et de gauche, pour se convaincre que tout ce qu'il voyait ne sortait pas de l'esprit d'un malade ou d'un cauchemar fou. Il arrivait à reconstituer la genèse de ce carnage. Il imaginait le premier accident qui avait figé l'ensemble de la circulation, qui avait arrêté tous les autres gens, tous ceux qui derrière s'étaient retrouvés noyés dans le piège infernal. L'absence d'autorité légale efficace avait vraisemblablement précipité et amplifié l'immense panique, l'inexorable besoin de s'enfuir qui s'était emparé de tous, quitte à écraser les autres comme dans un cinéma lors d'un incendie. La plupart de ces malheureux devaient être déjà malades, incapables de réfléchir sainement, contraints par leur état à décharger leur trop plein d'agressivité sur leurs voisins, au milieu des injures, des vrombissements de moteurs, des hurlements de klaxons, des pleurs des enfants, des cris des plus faibles. Les plus chanceux avaient dû abandonner leur voiture paralysée et, encombrés de leurs bagages inutiles, avaient cherché à fuir cet enfer pour un ailleurs problématique. Il espérait que c'était le cas du plus grand nombre mais il n'en était pas convaincu. Quant aux autres, ils étaient encore là, enfouis au sein de ce cimetière géant. Il en voyait quelques corps, déjà presque momifiés, abandonnés au vent et à la pluie dans autant de positions grotesques. Pour la première fois, il comprit l'immense gâchis, la mort d'une entière civilisation, une mort plus inexorable que celle d'une guerre au cours de laquelle, si terrible soit elle, il reste toujours un souffle de vie, un espoir, parmi les décombres.
Seul être vivant dans tout ce silence, un chien furetait parmi les cadavres de métal, peut-être à la recherche de ses maîtres disparus ou plus simplement à flairer quelque denrée comestible. Larcher regarda avec attention celui qui était à présent pour lui un compagnon d'infortune. Le chien, un grand animal efflanqué, s'approcha du corps d'une femme à moitié basculée par la porte entrebâillée de sa voiture et le flaira longuement. Larcher, pris soudain d'un pressentiment affreux, détourna les yeux mais quand il regarda à nouveau, la bête s'était éloignée et, trottinant d'un pas allègre, se perdit bientôt parmi les épaves. Et dire que la porte de Bagnolet ne doit être qu'une image de ce qui s'est passé à toutes les sorties de Paris, et vraisemblablement des autres villes, pensa Larcher. Sans parler des autres pays pour ce que j'en sais. C'est à devenir fou. Par une sorte de masochisme morbide, il n'arrivait pas à détacher ses yeux de cette monstruosité. L'avertisseur puissant et brutal du Range le fit sursauter. Il se retourna mais tout semblait normal. Il pouvait toujours apercevoir l'ombre de sa compagne derrière la vitre. Il était incapable d'évaluer le temps qu'il avait passé à contempler, fasciné, l'hallucinant spectacle. La jeune femme devait tout simplement s'impatienter. Il se hâta vers le 4X4. En le voyant revenir, Coralie baissa sa vitre.
- Ben alors, qu'est-ce que tu fabriques ? T'as trouvé un chemin ou quoi ?
Il secoua négativement la tête, sans répondre. Quand il se fut installé près d'elle, il murmura d'une voix étrange :
- Rien à faire. Le périf est... bourré. Faut passer par la banlieue.
Elle comprit dans son regard toute l'horreur de sa vision et ne chercha pas à en savoir plus. Elle posa sa main sur la sienne et ils restèrent silencieux un moment.
- C'est quelle heure ? demanda enfin Larcher en regardant sa montre.
- Presque une heure de l'après midi, lui répondit Coralie.
- T'as faim ?
- Non, et toi ?
- Moi non plus. Allez, on y va. Plus vite on part, plus vite on sera arrivé.
Il tourna la clé de contact.
La peur. La peur l'étreignait en permanence, compagne détestée mais omniprésente, qui l'empêchait de réfléchir, de prendre les décisions indispensables. Elle sursautait au moindre bruit, s'épouvantait ensuite du silence. Perdue, abandonnée de tous, elle savait pourtant qu'elle n'était pas seule mais des Autres, de tous les Autres, ne pouvaient venir que la haine et la mort. Elle aurait tant voulu s'enfuir de ce cauchemar, se cacher derrière chaque objet, ne marcher que de nuit peut-être, mais s'enfuir. Partir pour n'importe où, plus loin, dans des lieux où le danger se serait fait moins pressant. Mais elle ne le pouvait pas. Rampant à moitié, sa lampe éteinte serrée dans sa main moite, elle s'approcha de la porte du petit appartement, se releva, introduisit ses clés. Trois serrures et trois clés différentes. Long à manœuvrer mais la rançon de la sécurité. La porte s'ouvrit avec un petit grincement qui la fit frissonner tant le bruit ridicule parut résonner dans le silence ambiant. Elle referma vivement la porte sans la claquer, s'empressa de pousser les verrous, défense dérisoire mais elle ne s'en doutait pas, et, s'appuyant contre le mur, elle passa une main imprécise dans ses cheveux sales. Sylvie s'approcha de la petite chambre faiblement éclairée et elle se fit la réflexion qu'il lui faudrait, une fois encore, changer les piles de la torche. Cela n'avait pas d'importance car elle avait pris la précaution de s'en faire une réserve. Sur le lit défait, l'enfant se tourna vers elle en l'entendant et, d'une toute petite voix, il interrogea :
- C'est toi, maman, c'est toi ?
- Oui, mon chéri, comment tu te sens ? Tu as toujours mal à la tête ?
- Un peu moins, maman, mais j'ai soif...
En lui rapportant un verre d'eau, elle se pencha sur son fils et posa sa main sur le front brûlant. Toujours la fièvre. Elle lui soutint la tête tandis qu'il buvait avec difficulté puis elle s'assit à côté de lui, impuissante. L'enfant s'était assoupi. Sylvie essaya de se raisonner, de se convaincre. Il lui fallait absolument des médicaments, ne serait-ce que pour faire tomber cette fièvre. Deux fois déjà, la peur avait été la plus forte et elle n'avait pu aller jusqu'à la pharmacie. En fait, elle n'avait même pas pu dépasser le coin de l'immeuble. Au début, elle n'avait pas pris toutes ces précautions. Au contraire, elle marchait sans crainte dans la petite ville, ne croisant que des silhouettes qui semblaient vouloir l'éviter ce qui la faisait sourire car, de toute façon, elle ne les aurait jamais laissé approcher. Elle s'était même amusée de la situation. Rentrer comme ça chez madame Bobanier, l'épicière, et se servir, choisir ce qui lui plaisait, au point d'être obligée de s'y reprendre à plusieurs fois tant elle avait d'objets à transporter. Pas tous utiles, les objets, bien sûr, mais comment résister au plaisir enfantin de ne plus compter, de ne plus être limitée par l'argent. Et puis, il y avait eu, il y avait eu... Elle avait formé le projet d'aller visiter le marchand de jouets, à trois pâtés de maisons de chez elle. Jérôme commençait à se plaindre de sa tête et de sa gorge. Elle avait décidé de lui rapporter une voiture miniature, un ou deux livres, des babioles pour lui faire prendre patience. Elle s'apprêtait à sortir du hall du petit immeuble quand elle avait entendu les cris, les bruits de lutte. La porte d'entrée avait été violemment repoussée et elle n'avait eu que le temps de se réfugier dans l'escalier qui conduisait aux caves. De là, hélas, elle pouvait tout voir. Les Autres. Trois hommes qu'elle ne connaissait pas venaient d'entrer en riant. Ils tiraient une jeune femme blonde qui les suppliait. Elle reconnut Florence Perthuis avec qui elle était allée en classe dans le temps. Sylvie était surprise car elle pensait que les Perthuis, comme une grande partie des gens de Provins, étaient partis avec la masse de ceux qui arrivaient des grandes villes pour s'enfoncer toujours plus loin dans la campagne. Le hurlement de la jeune femme blonde lui vrilla les tympans. Deux des hommes l'avaient jetée à terre et cherchaient à lui arracher ses vêtements. Sylvie ne pouvait rien faire. Elle avait trop peur. D'ailleurs, de quelle aide aurait-elle pu être, sans arme, seule, terrorisée ? Elle cacha son visage dans ses bras pour ne pas voir le viol immonde. Elle resta ce qui lui parut un temps infini, accroupie sur ses deux marches, à retenir des sanglots de honte et de peur. Puis, les cris de la femme lui avaient malgré tout fait relever la tête. Cette fois, deux des hommes maintenaient la malheureuse tandis que le troisième à califourchon sur elle faisait tourbillonner un rasoir qui scintillait dans la demi-clarté. Sylvie avait tourné les yeux, incapable d'assister à toute cette horreur. La séance de torture dura longtemps et, plusieurs fois, elle avait failli perdre connaissance en entendant les rires des hommes et les cris atroces de la femme. Quand celle-ci avait cessé de gémir, elle avait pu entendre les Autres se remettre à parler, calmement, comme s'ils échangeaient des phrases banales.
- Elle est tombée dans les pommes, cette conne.
- Karim, j't'avais bien dit de pas lui niquer les yeux tout de suite. J'te l'avais bien dit. Merde, j’te l’avais dit ! Comme ça, c'est moins marrant, sale con.
- Tu commences à me gonfler. Y a que ce que tu fais toi qu'est marrant, à t'entendre.
- Vos gueules, s'exclama une troisième voix. On va finir par se faire repérer avec vos conneries.
- Risque pas. Y a plus personne dans ce bled.
- On se casse, je vous dis.
- Personne se tire ! hurla le plus petit des trois qui semblait être le chef. On est aussi bien ici qu'ailleurs. Je vous ai dit que c'est ici qu'on attend Danny et Sainte-Rose, merde ! Personne se casse avant que je le dise.
Le silence retomba quelques instants.
- Bon, qu'est-ce qu'on en fait de la minette ? On la laisse crever ici ?
- Tu vois, mon pauvre Karim, ce qui est vraiment moche chez toi, c'est que t'as pas de cœur.
Sylvie vit un des hommes s'accroupir et introduire un revolver dans la bouche de sa victime. La détonation lui fit pousser un cri de terreur mais dans le vacarme, il passa heureusement inaperçu. Quand elle regarda à nouveau, elle était seule avec le corps inerte. Après avoir été prise de vomissements irrépressibles, elle attendit longtemps avant de réunir tout son courage pour remonter chez elle, faisant un grand détour pour ne pas s'approcher du cadavre. Elle pleura presque une heure dans son appartement, serrant contre elle son fils qui ne comprenait pas. Depuis, cette scène horrible, la peur, tenace, s'était emparée d'elle et ne l'avait plus quittée. Elle attendit le lendemain pour tenter une nouvelle sortie, en se jurant de ne pas regarder l'endroit où... Mais le corps n'était plus là et seule une grande tache sombre témoignait du fait qu'elle n'avait rien rêvé. Prise de faiblesse, elle était remontée chez elle sans même oser dépasser la porte d'entrée.
Sylvie ne comprenait pas très bien ce qui arrivait. Evidemment, comme tout le monde, elle avait entendu parler de l'épidémie qui rendait fou. C'était la raison pour laquelle elle ne laissait personne s'approcher d'elle et de son fils. Mais ce qu'elle ne comprenait pas c'était pourquoi les docteurs, la police ne venaient pas chercher ces malades, pourquoi on les laissait faire. Elle aurait voulu être un homme, une sorte de Rambo, et avec une mitrailleuse, elle aurait liquidé tout ça, malades ou pas. Il y a des moments, pensait-elle, où il ne sert plus à rien d'être gentil. Il faut agir, c'est tout. En attendant, elle était coincée avec Jérôme qu'elle ne savait pas soigner, le docteur Lacaze qui habitait juste en face avait disparu et l'hôpital était à quinze kilomètres. Il ne lui serait jamais venu à l'idée de voler une voiture. Elle avait bien pensé à dérober des antibiotiques à la pharmacie Méroux mais lesquels ? Elle n'était pas docteur et pas question de donner n'importe quoi à un enfant de 6 ans. De l'aspirine toutefois, un sirop... Elle se leva, indécise. Sortir ? Avec ces fous dehors qui attendaient leurs copains ? Elle s'approcha de Jérôme qui dormait tranquillement. La fièvre paraissait moins élevée mais ce n'était sans doute qu'un répit. Allez, c'est le moment ! Elle passa son manteau sans réfléchir davantage, courut de nouveau près du petit lit pour vérifier les couvertures et alla ouvrir sa porte. Elle prit la précaution de bien tout refermer à double tour et, deux minutes plus tard, elle se fondait dans la nuit noire.
Elle atteignit la pharmacie sans problème, procédant par successions de petits bonds, se cachant dans chaque recoin, derrière chaque arbre, chaque voiture. La porte du magasin avait été forcée et ce qui la rassura d'abord, l'inquiéta ensuite quand elle vit le capharnaüm à l'intérieur. Elle s'éclairait avec sa lampe électrique par de brefs éclairs au hasard mais elle avait du mal à s'orienter. Elle crut qu'elle n'y arriverait jamais. Elle marchait sur des boites de médicaments, bousculait des sacs, des paquets qui tombaient avec un bruit mou sur le sol jonché de débris. Elle tirait de longs tiroirs presque vides d'où elle ne sortait que des médicaments aux noms bizarres, inconnus. Pleurant à moitié, sentant la panique l'envahir, elle eut tout à coup l'idée de regarder par ordre alphabétique, se rappelant comment procédait le vieux père Méroux, avant. Elle cria de joie en voyant les boites bleues d'Aspégic enfants. Il y en avait trois, cela suffirait. Elle fourra maladroitement les médicaments dans la poche de son manteau, se pencha pour ramasser son marteau, seule arme qu'elle possédait, et se précipita vers la sortie. Les phares blancs d'une voiture que, dans sa hâte, elle n'avait pas entendu venir, balayèrent un dixième de seconde la devanture de la pharmacie. Sylvie se jeta de côté dans un renfoncement où on entreposait les livraisons avant inventaire. Elle vit la voiture effectuer un quart de tour et s'immobiliser de l'autre côté de la rue. Rien ne se passa pendant plusieurs minutes puis les portes du gros véhicule carré s'ouvrirent et les Autres descendirent. Deux. Un homme et une femme qui, sans se presser, s'approchèrent. Ils se dirigeaient droit sur elle. Elle se prépara à bondir, le marteau levé à mi-hauteur.
- Merde, merde et remerde, hurla Larcher en claquant le capot du 4X4.
Coralie se pencha par la portière.
- C'est grave ? demanda-t-elle.
- J'ai pas l'impression. Je crois que je l'ai noyée, c'est tout, lui répondit-il en se réinstallant derrière le volant. Quel con, non mais quel con ! poursuivit-il. A peine une borne que je reprends le volant et voilà que je noie le moteur...
- Si c'est que ça, c'est pas grave, Julien. Y a qu'à attendre. Et puis tu pouvais pas savoir qu'il y avait ce truc en béton sous les cartons...
- M'ouais. J'avais qu'à contourner.
- De toutes façons, un peu de repos nous fera du bien.
Après avoir quitté Paris, ils avaient eu beaucoup de mal à traverser la banlieue si peu sûre et encombrée de tant d'obstacles disparates. Ils avaient essuyé plusieurs jets de pierres, heureusement sans conséquence, avaient dû multiplier les détours pour éviter ce qui leur semblait être des pièges ou en tous cas des difficultés difficiles à surmonter, même pour leur véhicule tout-terrain. Une fois sortis de l'agglomération parisienne, les choses s'étaient un peu améliorées. Les espaces découverts s'étaient fait plus nombreux, la conduite moins hachée mais leur décision d'éviter systématiquement les villages les avait obligé à perdre encore du temps. Parfois, Larcher avait la sensation que ce voyage ne se terminerait jamais, que pour l'éternité ils seraient ainsi obligés de rouler, presque au hasard, à scruter sans fin la route à la recherche de l'écueil, du point noir qui les stopperaient définitivement. Sa compagne ne semblait pas en proie aux mêmes doutes et son attitude lui redonnait la détermination suffisante pour continuer.
Coralie se tourna vers l'arrière et escalada à moitié son siège pour s'emparer de leur panier à provisions. En mâchonnant son biscuit, une bouteille de Coca à la main, Larcher l'interrogea :
- On est encore loin ?
- En temps normal, non. Provins est à une dizaine de kilomètres ce qui fait donc une quarantaine pour Ste Hippolyte. Mais la nuit commence à tomber. On va devoir faire étape.
- Tu connais quelque chose par là ?
Elle le regarda comme s'il était devenu subitement fou.
- Je sais qu'il n'y a plus rien de sûr, évidemment, poursuivit-il en souriant, mais quand même...
- Ben, y a bien un petit hôtel à Provins où on réservait pour les amis quand il y avait trop de monde à la maison. Intéressant quand j'y pense car il y avait une sorte de cour intérieure où on pourrait garer la bagnole. Mais tu crois pas qu'on devrait plutôt dormir dans la caisse et repartir dès le petit jour ?
- Hmm, trop dangereux à mon avis.
La nuit était complètement tombée quand ils entrèrent dans la ville, tous leurs sens en éveil. Dans une des rues principales, heureusement dégagée étant donné leur état d'épuisement, Larcher repéra dans la lumière des phares l'enseigne d'une pharmacie.
- Tu as toujours mal à la gorge ? Y a une pharmacie juste devant nous.
- Pas au point de ne pas pouvoir me passer de médicaments.
- Des médicaments, justement on n'en a pas pris, je te ferai remarquer. C'est peut-être le moment. Et puis un sirop quelconque te ferait sûrement du bien. C'est pas le moment d'être malade, tu penses pas ?
Elle haussa les épaules sans répondre. Larcher arrêta la voiture. Le silence retomba. Il attendit quelques minutes puis fit signe à la jeune femme.
- C'est mieux qu'on y aille ensemble, d'accord ?
Coralie marchait à deux pas devant lui. La nuit sans lune donnait à la rue une apparence de tunnel obscur. Seule la lampe électrique de la jeune femme éclairait le paysage fantomatique, les murs lugubres. Tout à coup, à un mètre de l'entrée de la pharmacie, sortie de nulle part, une ombre qui paraissait immense se dressa et, le bras levé, se rua vers eux en poussant un hurlement dément. Les cheveux de Larcher se dressèrent sur sa tête. Coralie se jeta à terre sur le côté mais la silhouette était sur elle, brandissant une espèce de marteau. La jeune femme, dans un geste vain de défense, braqua sa lampe sur l'apparition qui hésita un dixième de seconde. C'était une femme en manteau noir, le visage déformé par la haine ou peut-être la peur. Larcher fit feu avant qu'elle ait pu abattre son arme de fortune et la femme bascula en arrière. Sans pouvoir se contrôler, il déchargea son revolver, ne s'arrêtant qu'en entendant le déclic du barillet vide. Il aida Coralie à se relever. Elle hoquetait de peur.
- Une Virale. C'était une Virale. Y en a partout, partout ! criait-elle sans pouvoir s'arrêter.
Larcher, encore tout secoué, ramassa la lampe électrique et prit la jeune femme dans ses bras en la serrant le plus fort qu'il put contre lui. Ils s'approchèrent du cadavre. Evitant d'éclairer son visage, il se pencha vers elle. La main gauche de la femme était toujours enfoncée dans la poche de son manteau. Larcher, avec une prudence extrême, saisit de deux doigts encore tremblants un bout du tissu de la manche et tira sur le bras. La main raidie de la femme laissa échapper un objet que Larcher éclaira de la lampe. C'étaient deux boites d'aspirine pour enfants.
Tous droits réservés
copyright 943R3EB
 votre commentaire
votre commentaire
-
Vendredi 4 avril
Coralie engagea le 4X4 dans l'allée. Larcher pouvait entendre les graviers crisser légèrement sous les pneus. Elle arrêta le véhicule à une cinquantaine de mètres de l'entrée de la maison. Ils contemplèrent en silence le bâtiment. La résidence secondaire des Dabrowski se dressait sur une petite hauteur, un peu à l'écart du village à quelques centaines de mètres de là. Elle était entourée d'un petit parc - ou plutôt d'un grand jardin - bordé de haies de troènes et, sur un côté, d'un vieux mur de pierres moussues, seul vestige d'une construction antérieure. Aux yeux de Larcher, elle ne paraissait pas aussi grande que le lui avait décrit sa compagne mais peut-être n'était-ce qu'une illusion due à la configuration résolument moderne de la villa qui devait gagner en profondeur ce qu'elle n'avait pas en hauteur. Beaucoup de vitres et cela fit grimacer Larcher qui pensait avant tout aux moyens de la défendre contre toute intrusion malveillante. Il ne voyait pas la piscine, petite mais sympa lui avait précisé Coralie, qui devait se trouver quelque part derrière et qui, à présent, avait toutes les chances de rester définitivement vide. Dans le parc, de part et d'autre de l'allée qui conduisait au garage et où ils s'étaient arrêtés, se dressaient des arbres, principalement des sapins, dont la taille adulte laissait supposer qu'ils avaient préexisté à la maison, et quelques bouleaux. Les abords immédiats de la villa étaient heureusement dégagés et plantés en pelouses que les mauvaises herbes mangeaient déjà. Tout cela donnait à la fois une impression de vacances et d'abandon.
- Alors, qu'est-ce que t'en penses ? demanda Coralie.
Larcher prit le temps de répondre.
- Eh bien, ta maison me paraît très habitable mais il faudra voir à l'usage. En tous cas, j'espère qu'on va pouvoir se reposer un peu par ici, qu'on pourra voir venir, parce que je t'apprendrai rien si je te dis que j'en ai plein les bottes.
- Et moi donc ! J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais...
Elle sauta de la voiture puis se tourna vers lui.
- Tu viens avec moi pour voir si tout est normal ?
Il la suivit tranquillement. Etait-ce le fait de savoir qu'ils touchaient au terme de leur voyage ou bien avait-il été plus secoué qu'il l'aurait cru, Larcher n'en savait rien mais il se sentait exténué. Il n'avait qu'une envie : s'asseoir dans un fauteuil, un verre à la main, et ne plus penser à rien. Dormir, aussi, et le plus longtemps possible.
La nuit précédente, après l'effrayante rencontre avec la Virale, ils avaient été obligés de rouler un long moment dans la ville morte à la recherche de l'hôtel que, soit par fatigue, soit parce qu'elle était encore sous l'emprise du drame qu'ils venaient de vivre, Coralie n'arrivait plus à retrouver. Il avait été sur le point de proposer d'entrer dans n'importe quelle maison ou, pis encore, de dormir dans la voiture malgré tout ce qu'il avait dit, quand ils s'étaient enfin trouvés face à une auberge dont l'enseigne, battant au vent, réfléchissait faiblement la lumière de leurs phares. Il y avait bien une petite cour intérieure dans laquelle il avait introduit le Range mais Coralie ne reconnaissait pas les lieux. Elle n'avait pas voulu rester seule et ils s'étaient approchés ensemble de l'entrée principale de l'hôtel qu'ils avaient trouvé hermétiquement close. Larcher avait été obligé de briser un des carreaux de la porte avec son revolver pour lever le verrou. Il ne savait pas ce qu'il aurait fait s'il avait été confronté à une serrure de force. Face au comptoir de réception sur lequel trônait une bougie qu'il avait immédiatement allumée, s'ouvrait une salle de réception qui devait jadis faire office de salon de télévision. Il avait pu voir l'écran noir du poste qui reflétait la lumière vacillante de la bougie comme une luciole dans la nuit. Il avait appelé mais personne n'avait répondu. Après avoir installé la jeune femme sur le sofa du salon, malgré ses protestations, il avait exploré la bâtisse. Les pièces du rez-de-chaussée étaient désertes et bien rangées, comme si les propriétaires étaient partis pour quelques jours, pour une ou deux semaines de vacances, en laissant tout en ordre pour leur prochain retour. Cela prouvait au moins qu'aucun vandale n'avait depuis pénétré dans les lieux. Les chambres étaient toutes situées à l'étage. Ce n'était pas un hôtel important - une dizaine de chambres au plus - qui devait servir de halte aux représentants de commerce en semaine et à quelques voyageurs peu pressés le week-end. Dans l'avant-dernière pièce du haut, il avait eu un choc : le cadavre momifié d'un homme en pyjama était affalé en travers du lit. La fenêtre ouverte dont un des battants cognait doucement sous le vent expliquait l'absence d'odeur. Il avait rapidement refermé la porte et, après s'être assuré que la dernière chambre ne lui réservait pas semblable surprise, avait rejoint sa compagne. Elle l'attendait, sagement assise sur le divan, en jouant avec son revolver. Elle l'avait interrogé des yeux et, d'une voix faussement enjouée qu'elle n'avait pas relevée, il lui avait proposé de passer la nuit - ou ce qu'il en restait - dans le petit salon. Elle s'était endormie presque immédiatement, en dépit ou à cause de ses terreurs du jour, tandis qu'il s'était installé dans un fauteuil face à l'entrée, ses armes sur ses genoux. Lui, il n'était pas arrivé à dormir. Il avait marché un moment dans les pièces silencieuses, avait trouvé un paquet de biscottes qu'il avait mâchonnées sans s'en rendre compte. Il avait su très vite qu'il ne dormirait pas de la nuit. Trop de questions sans réponses. Trop d'horreur en trop peu de temps. Il avait repensé à la Virale qui n'était peut-être qu'une pauvre femme apeurée, il se rappelait son expression quand elle avait levé son marteau. Mais cela le tracassait moins qu’il aurait pu le croire. La France était devenue une jungle, un monde du chacun pour soi et tant pis pour les autres. Il s'était demandé combien de temps il arriverait à vivre dans ce monde-là. Coralie l'aidait. Sans elle, il aurait sans doute craqué depuis longtemps. Et il l'aidait aussi, elle, c'était sûr mais serait-ce suffisant ? Tout à l'heure, avec la Virale, il s'était fait peur. Il l'avait tuée sans remord, comme on se débarrasse d'un insecte gênant, une araignée qui vous a surpris et qu'on écrase sans plus y penser. A ce rythme là, qu'allait-il devenir ? Un autre salaud dans un monde de salauds ? Pouvait-on reconstruire quelque chose, et quoi ?, dans ces conditions ? Réellement trop de questions sans réponses. Il avait regardé l'aube s'éclaircir peu à peu à travers le carreau brisé de la porte. Un nouveau jour, pour quoi faire ? Il s'était rendu compte qu'il avançait doucement vers une espèce de dépression. Peut-être compréhensible mais ce n’était vraiment pas le moment. Il avait eu froid soudain et était retourné pour couvrir Coralie avec son plaid qui ne lui servait pas. Il était revenu à son poste d'observation, devant la porte, infiniment patient puisque le temps ne comptait plus.
Coralie sortit ses clés mais la porte n'était que repoussée. Elle regarda Larcher, surprise, préoccupée. Celui-ci l'écarta doucement, un doigt sur les lèvres, et s'avança dans la maison muette. Il tenait son fusil à pompe à hauteur d'homme. Il entendait le souffle léger de la jeune femme derrière lui. Quelqu'un était entré dans la maison et y avait séjourné, cela se voyait au petit désordre, à une fugitive impression de vie dans la villa en principe fermée depuis des semaines. Un fauteuil de travers, des bouteilles de bière vides sur la table de la cuisine, un restant de feu mal pris dans la cheminée du living. Un squatter, une âme errante en quête d'une halte provisoire mais qui n'avait rien vraiment dérangé. Ils explorèrent attentivement le rez-de-chaussée, en fait la partie véritablement habitable. A l'arrière, dans une des chambres, un ou deux tiroirs mal repoussées, l'empreinte d'un corps, une couverture froissée témoignaient de l'effraction.
- Voilà où roupillait notre visiteur, chuchota Larcher. On dirait qu'il est pas resté longtemps. Et aussi qu'il a dû partir sans avoir l'intention de revenir. Qu'est-ce qu'il y a en haut ?
Elle le guida en silence. Larcher était persuadé que leur hôte imprévu avait depuis longtemps décampé. Ils visitèrent néanmoins l'étage avec prudence, armes braquées. Il n'y avait là qu'une chambre d'amis avec une grande salle de bains attenante, une pièce immense qui devait servir de salle de jeux ou de bibliothèque mais qui n'avait jamais été aménagée, précisa Coralie, une buanderie et plusieurs autres pièces aux fonctions mal définies. Tout était désert. Ils redescendirent, soulagés.
Après avoir déchargé leur véhicule, Larcher s'empressa de le dissimuler dans le garage puis, pris de fatigue, il alla s'écrouler dans un des fauteuils du living, face à la cheminée éteinte qu'il fixa longuement tandis que la jeune femme essayait de remettre la villa en service ce qui n'était pas simple dans une maison où l'électricité dirigeait à peu près tout. Pour lui, les bûches à demi-calcinées qui semblaient le narguer dans le froid ambiant était comme l'illustration de l'avenir qui leur faisait face. Il devait s'être assoupi car il sursauta quand elle lui toucha le coude, un verre de whisky à la main.
- Je crois que j'ai un peu dormi, dit-il, les yeux encore flous.
- Tu sais que tu as l'air complètement crevé ?
- T'es pas fatiguée, toi ?
- Oh, moi, je dois reconnaître que j'ai assez bien dormi dans l'auberge, cette nuit. Après cette route dégueulasse et tous nos ennuis, j'avais l'impression d'être enfin à l'abri… d'être en sécurité.
- Je comprends ça, répondit-il en repensant au cadavre du premier étage.
Comme la jeune femme s'asseyait en se versant son whisky avec application, il étendit les bras avec un profond soupir et secoua la tête pour s'éclaircir l'esprit.
- Bon, c'est pas tout ça mais je crois qu'il faut aviser, reprit-il.
Elle avala voluptueusement une gorgée d'alcool puis, coinçant son verre entre ses jambes, elle le fixa attentivement.
- Julien, si tu veux bien, on fera le point demain. Ce soir, j'ai envie de passer une soirée tranquille, de plus penser à tout ça.
- Heu, oui, dans le fond, je crois que t'as raison, y a rien qui presse. Dis donc, à propos, reprit-il au bout d'un petit moment, tu m'as jamais dit ce que faisait ton mari. Il devait avoir du fric pour s'acheter une baraque comme ça, non ?
- Oui et non. En fait, il était architecte, enfin, il l'est encore, du moins je l'espère pour lui. Alors, quand des amis nous ont parlé d'un terrain à vendre par ici - c'était, heu, il y a à peu près trois ou quatre ans - il a sauté sur l'occasion. Je dois dire aussi que le coin me plaisait bien. Tu vois, y avait une vieille bâtisse ici, avant. Une espèce de vieille ferme. Oh, on aurait pu l'aménager. Encore qu'il y aurait certainement eu pas mal de frais. Mais c'était pas l'idée de Laurent. Avec son métier, tu comprends, il avait envie de construire du neuf. Bon, c'est vrai que c'est un peu grand. Surtout pour deux. Mais on s'était dit que plus tard... Bref, il a fait construire. Sur ses propres plans, bien sûr. Voilà toute l'histoire.
Larcher prit le temps d'apprécier son alcool, premier moment de vraie détente en trois jours. Coralie avait laissé aller sa nuque sur le dossier de son fauteuil et, les yeux ouverts, elle regardait le plafond sans le voir. Depuis leur arrivée, depuis qu'elle se retrouvait dans son univers familier, elle avait commencé à se détendre. Seul, son revolver, posé sur la table basse située entre eux, rappelait que les temps étaient changés, que tout danger n'était pas écarté. Pourtant, Larcher avait comme l'impression d'avoir vécu ce genre de scène tranquille des milliers de fois déjà. Il se serait presque cru en week-end avec Elisabeth, à profiter du temps qui passe, avec pour seule préoccupation d'organiser les loisirs des quelques heures à venir. Il se leva sans que sa compagne ne fasse le moindre mouvement et s'approcha de la grande baie vitrée, écarta le rideau. Dehors, la nuit commençait à tomber. Il avait dû dormir plus longtemps qu'il ne l'aurait cru. Deux merles sautillaient paisiblement sur le gazon, presque sous son nez, et s'envolèrent tout à coup dans un grand bruissement d'ailes silencieux. De l'autre côté de la route qu'on devinait légèrement en contre-bas, la masse noire de la maison voisine se détachait sur le ciel dégagé, sentinelle lointaine et inaccessible. Il se retourna.
- Il commence à faire noir. Je vais fermer tous les volets. Comme ça, on verra rien du dehors et tout sera comme avant qu'on arrive, t'es pas d'accord ?
Sans le regarder, elle répondit par un petit hochement de tête.
- Eh bien, je vais aller chercher les lampes.
- Tu veux que je t'aide ?
- Repose-toi plutôt, c'est trois fois rien.
Au moment où il allait quitter la pièce, elle le rappela :
- Oh, Julien !
- Oui ?
- Tu sais que je commence à cailler ici ?
- Moi aussi. Bon, je ramènerai également un radiateur et la batterie.
- Tu crois pas qu'on pourrait faire du feu ? Je veux dire allumer la cheminée.
- Alors ça, à mon avis, c'est pas une bonne idée. La moindre fumée risque de nous faire repérer, tu le sais bien.
Elle se retourna vers lui. Ses cheveux noirs faisaient ressortir la pâleur de son visage mais ses yeux scintillaient.
- Mon vieux, je vais te dire un truc. J'ai pas du tout l'intention de vivre comme une recluse, hein, à me cacher derrière mon ombre. Pas une seconde, t'entends ? D'ailleurs, ça changerait quoi ?
- Heu, peut-être un jour ou deux, on devrait...
- Pas question. Faire attention, c'est une chose. Vivre en se cachant en permanence, c'est complètement différent.
Il hésita deux à trois secondes puis se mit à sourire.
- Bien sûr que t'as raison. Allez, va pour la cheminée.
Le lendemain, Coralie les conduisit au supermarché local, sur la route d'Epernay. Ils passèrent par Ste Hippolyte qui paraissait complètement abandonnée. Larcher se demandait où étaient passés tous les gens et la jeune femme n'en avait bien entendu aucune idée. Ils finirent par se persuader que la majorité d'entre eux étaient morts, que la maladie était à la fois plus répandue qu'ils ne l'avaient d'abord pensé et surtout qu'elle devait finir, d'une manière ou d'une autre, par tuer ceux qu'elle touchait. Sinon comment justifier ce silence, cette absence de vie que les violences ne pouvaient complètement expliquer ? Pourtant une partie de la population devait se terrer chez elle, un embryon d'activité se suspendant peut-être avec le bruit de leur moteur. Dans ce climat de suspicion et d'insécurité, ils avaient hâte de revenir à la villa. A la sortie du village, ils se heurtèrent à deux voitures arrêtées côte à côte en plein milieu de la route. Le véhicule de droite avait ses vitres brisées, une porte arrière et le coffre ouverts. Coralie aborda le passage avec prudence puis accéléra en arrivant à la hauteur des voitures mais il s'agissait depuis longtemps d'épaves dont ils n'avaient plus rien à redouter. Larcher eut l'impression qu'elles n'étaient pas vides. Dans les champs quelques vaches, les pis gonflés, meuglaient désespérément et ils virent de loin un cheval qui trottait sur l'asphalte de la route et qui obliqua sur un chemin de traverse en les entendant approcher. Pour les animaux aussi, la misère était intense.
Le supermarché s'organisait autour d'une galerie marchande et, après avoir fait un plein raisonnable de provisions, Larcher décida d'aller fureter dans les magasins voisins. Il en fut récompensé par la découverte du récepteur Ondes Courtes qu'il recherchait depuis longtemps. Évidemment, à une époque où jusqu’à peu on communiquait à chaque instant grâce à des smartphones ultra-perfectionnés, cela lui paraissait une sorte de retour en arrière mais quel autre moyen ? Excité par sa trouvaille, il céda aux injonctions de sa compagne qui, au fur et à mesure que le temps s'écoulait, devenait de plus en plus nerveuse. Dans un dernier geste, alors que Coralie était revenue sur ses pas pour le héler impatiemment, il s'empara d'un carton de petites alarmes individuelles qui leur seraient bien utile en cas de visite inopportune. Il était persuadé qu'il finirait, lors d'une prochaine visite, par trouver le groupe électrogène avec lequel il se proposait de rendre à leur maison une atmosphère presque normale. A peine revenu à la villa, il se jeta sur le récepteur et, durant un long moment, il chercha à capter une quelconque émission qui leur aurait appris qu'ils n'étaient pas seuls, que la vie, quelque part, continuait. Malgré ses patients efforts, il ne put entendre que de rares parasites et quelques sifflements qui n'avaient à l'évidence aucune origine humaine. Il abandonna à contrecœur pour installer les alarmes. Les petits engins, qui fonctionnaient sur piles, étaient capables de déclencher des sirènes particulièrement performantes et même s'ils ne pouvaient rivaliser avec un véritable système intégré, ce que le mari de Coralie avait toujours refusé de faire installer par peur de déclenchements intempestifs, ils rassuraient un peu Larcher qui avait ainsi l'impression de pouvoir dormir dans une citadelle presque inviolable. Le soir, dans la chambre, sa hantise sécuritaire apaisée, il put pour la première fois depuis l'effondrement de son monde, réfléchir à l'avenir qui s'offrait à eux. La jeune femme fatiguée s'était endormie à ses côtés, la main sur son épaule, comme pour ne pas rompre le contact, comme pour rester accrochée à lui qui demeurait son seul lien avec le vivant. Ce geste d'abandon le réconfortait profondément. Avec elle, grâce à elle, il se sentait investi d'une responsabilité qui dépassait son seul instinct de survie. Il n'avait pas l'impression de l'aimer, du moins pas au sens qu'il donnait à ce terme dans le passé, au sens d'Elisabeth du début de leur union, mais les événements atroces qu'ils avaient vécus, la solitude qu'ils partageaient à présent, seul élément stable dans ce chaos, rendaient d'une certaine manière leur association infiniment plus forte, presque fusionnelle. Il se pencha vers elle et lui effleura doucement les cheveux du bout des lèvres. Il posa sur la moquette, près du lit, le livre qui racontait l'histoire d'un monde disparu et auquel il n'arrivait pas à s'intéresser et tourna le bouton de la lampe qui s'éteignit dans un chuintement d'agonie.
Tous droits réservés
copyright 943R3EB
 votre commentaire
votre commentaire
-
Dimanche 6 avril
Il se tenait parfaitement immobile, statue vivante que rien ne pouvait altérer. Autour de lui, la vie s'était organisée à nouveau. Les petits animaux avaient repris leur activité. Les oiseaux réoccupaient le bosquet derrière lequel il guettait. Un écureuil, après bien des tergiversations, s'était décidé à emprunter son chemin habituel qui frôlait les chaussures boueuses. Arrivé à leur hauteur, la petite bête avait accéléré comme si elle craignait que l'être étrange qu'elle côtoyait de si près cherche à la saisir mais elle n'avait rien à redouter. Il restait parfaitement immobile. La pluie qui s'était mise à tomber quelques minutes plus tôt dégoulinait de son étrange chapeau qui rappelait, en plus informe, les Bobs des marins américains que certaines mères obligent leurs gamins à porter sur la plage pour les protéger du soleil. L'eau ruisselait dans son cou, sur ses vêtements usés et sales, sur l'arête de son nez à l'extrémité duquel, goutte à goutte, elle se lançait dans le vide. Il s'en moquait totalement comme il se moquait du froid qu'il avait décidé de ne pas ressentir. A l'exception de quelques brefs battements de paupières, pas un mouvement ne l'animait. Même sa respiration n'était pas perceptible. Et pourtant, intérieurement, une vie puissante, farouche, l'habitait. Il sentait toute cette vie qui bouillonnait en lui, comme si elle voulait sortir à toute force, comme si ce trop-plein si longtemps contenu allait jaillir au grand jour, allait le faire exploser comme une bombe vivante. Des frémissements le parcouraient, des démangeaisons multiples l'agaçaient mais, lui, s'astreignait à ce que toute cette agitation reste confinée au plus profond de son être, ignorée de tous. Il s'admirait pour cette volonté immense, se félicitait de ce qu'il puisse résister à tant de pression, s'émerveillait de pouvoir rester ainsi concentré sur la seule chose qui avait de l'importance et à laquelle il devait tout sacrifier : sa mission.
Dans ce cadavre debout, un seul élément traduisait le fait qu'on avait bien affaire à quelqu'un de tout à fait vivant : ses yeux. Brillant sur le fond blafard de son visage mangé de barbe, ils étaient le seul point de son corps qui trahissait son intense fièvre intérieure. Exaltés, hallucinés par la haine, ses yeux ne quittaient pas un instant la maison qui se dressait, paisible, à quelques mètres. Ils scrutaient chaque détail, chaque coin de pierre, chaque goutte d'eau qui serpentait sur les vitres, comme pour s'en imprégner, comme pour faire corps avec la matière.
Parfois, la vision d'une silhouette floue et vite disparue à travers les baies vitrées lui faisait sourdre un grognement aussitôt réprimé, les grognements avortés d'un animal sauvage attentif à ne pas se livrer encore. Il attendait son heure, le moment où, tel un oiseau de proie, brutal et impitoyable, il pourrait se lancer à l'assaut de ses ennemis, ces ennemis haïs au point que la seule idée de leur existence manquait chaque fois le faire défaillir. C'était cette haine absolue qui le portait au-delà de son corps, qui faisait de lui ce monstre de patience imperturbable. C'était ce désir de vengeance avide et inhumain qui occupait chaque parcelle de son être, chaque seconde de son temps. Sans varier sa position d'un millimètre, sans même que le moindre muscle de sa figure ne tressaille, il entendit le claquement sec du cliquet que l'on désarmait et il regarda le volet descendre lentement. Longtemps, il continua à fixer la façade de la maison aveugle puis, arrachant difficilement ses chaussures à la glaise qui les enserrait, il fit demi-tour et s'éloigna à couvert, d'une démarche pesante et magnétique, en direction de sa cabane misérable, de l'autre côté de la route. Les heures qui allaient venir seraient douces pour lui puisqu'elles lui permettraient de se délecter, par une anticipation méchante et savoureuse, de l'instant sublime qu'il espérait de toute son âme.
- Ca y est, Bon Dieu, ça y est !
Coralie releva les yeux vers Larcher qui s'était dressé d'un bond. Elle retira calmement le casque de son lecteur MP3. Du récepteur ondes courtes que brandissait son ami sortait, presque inaudible, une voix indéniablement humaine qui s'exprimait dans une langue inconnue.
- T'entends, Coralie, t'entends ? hurlait-il, au comble de l'excitation.
- C'est quoi au juste ? De l'allemand ?
- De l'allemand ou du hollandais, je sais pas vraiment. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a quelqu'un qui parle, quelqu'un de vivant, ma vieille !
- Quelqu'un de vivant, tu parles d'une nouvelle ! Avec tous les Viraux qui se baladent dans le pays...
- Jamais des Viraux s'amuseraient à lancer des messages par radio, voyons.
- Ah oui, et pourquoi pas ? Et qui te dis que ce sont pas des Viraux, ou bien des loubards, en train de préparer une saloperie ?
- Ça a pas l'air de te faire plaisir de savoir qu'il y a des gens qui sont peut-être en train de s'organiser, qui sont peut-être à...
- Je dis qu'il ne faut surtout pas s'emballer, le coupa-t-elle. D'ailleurs, on comprend rien de ce qu'ils disent, tu le remarquais toi-même il y a une minute.
- Non, bien sûr mais tout de même...
Son air déçu, comme celui d'un enfant qui aurait rapporté chez lui un bon carnet de notes que ses parents auraient posé de côté pour parler d'autre chose, la fit sourire. Elle avait un peu honte de tempérer ainsi son enthousiasme mais l'irruption des voix inconnues dans l'univers tranquille qu'elle venait à peine de réintégrer, en lui rappelant par leur simple existence les dangers extérieurs, l'effrayait plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle se pencha vers lui et lui effleura la joue de sa main tendue.
- Là, là. Allons Julien, bien sûr que ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui cherchent à communiquer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être prudent, terriblement prudent. On en sort à peine. Il faut prendre son temps. J'ai été trop déprimée par... J'ai besoin de me refaire une santé, tu comprends ? Pour le moment, c'est de ça dont j'ai besoin. Oublier un peu, quoi.
Elle se leva, se serra contre lui et, le forçant à se rasseoir, s'installa sur ses genoux. Larcher l'embrassa doucement en lui caressant les cheveux, avant de reprendre :
- Je comprends ce que tu ressens. Et il n'est pas question de bouger d'ici avant un grand moment, on en a assez discuté. Mais ça n'empêche pas de se tenir au courant. Ce que je veux dire, c'est que si on capte des gens en allemand, un jour ou l'autre, on en aura d'autres en français. Et qui pourront nous dire ce qu'ils font, ce qu'ils savent, je sais pas, moi. Plein de trucs qui pourront nous servir. Tu crois pas ?
Pensive, elle hocha la tête.
- La prochaine fois qu'on ira faire les courses, continua Larcher, en plus de l'électrogène, j'essaierai de trouver un émetteur. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui écoute, on pourra discuter. Évidemment, avec un PC et Internet, ce serait sûrement plus facile mais…
Elle se redressa, piquée par une idée soudaine.
- Parce que tu comptes parler avec des mecs que tu connais pas ? Et leur dire où on est, pendant que tu y es ?
- Mais pas du tout. Absolument pas. Dis, tu me prends pour un abruti ou quoi ? Je veux seulement être au courant de ce qui se passe, c'est tout. Mais pas question de donner le moindre renseignement.
- Tu le jures ?
- Je te le jure. De toute façon, on est tous les deux dans la même galère, non ? Et je ferai jamais rien sans t'en parler et sans qu'on en discute d'abord, tu le sais bien. Dis, tu me crois, au moins ?
Elle se leva et s'approcha de la cheminée pour rajouter une bûche. En l’absence de réponse, Larcher était reparti dans la manipulation de son récepteur. Elle observa durant plusieurs minutes les langues de feu qui réapparaissaient progressivement puis se retourna vers lui.
- Julien ?
- Oui ?
- J'ai besoin de temps, tu sais.
Il l'observa en silence quelques secondes avant de répondre.
- Moi aussi, Coralie, moi aussi, j'ai besoin de temps.
Coralie marchait à pas lents dans la douceur du matin. Elle s'arrêta, plissant les yeux à demi en raison du soleil qui la taquinait, et jeta un regard circulaire sur le parc. C'est ici, murmura-t-elle pour elle même, c'est ici qu'il faut planter. Des quatre côtés de la maison, c'était celui-ci qui convenait. Elle n'avait pas réellement le choix. Impossible d'envisager la partie avant de la maison car trop exposée, trop visible de la route. Le côté gauche était envahi par les arbres qui s'implantaient pour certains jusqu'à moins de deux mètres du mur, leurs branches les plus hardies venant presque toucher la pierre. La partie arrière, la plus vaste, était occupée en son centre par la piscine qui multipliait les distances. Et puis, ce serait trop triste de passer dix fois par jour devant ce grand trou sinistre, témoin de la mort d'une partie de la maison. Elle avait bien songé à la combler mais, au delà du fait que le travail serait probablement titanesque, un reste de respect pour les temps anciens, pour ses souvenirs, la retenait de détruire cet endroit qu'elle avait tant apprécié. Au point de n'y aller à présent que le moins souvent possible. Non, conclut-elle, c'est ici. Elle tâta du pied le gazon et imagina les légumes, les fruits qu'elle ferait pousser sur cette terre riche. Il faudra du travail, des soins, du temps, beaucoup de temps. Mais la joie immense de manger autre chose que les sempiternelles conserves, les sachets deshydratés et autres plats préparés qui, d'ailleurs, allaient bien finir par se périmer, lui arracha un long sourire, presque enfantin. Elle croisa les bras, pencha légèrement la tête et resta immobile de longues minutes face à son potager imaginaire.
Les yeux n'avaient pas quitté un seul instant la jeune femme depuis qu'elle était apparue sur le seuil de la maison. Placés en retrait à l'angle du parc, à l'endroit où les arbres et les buissons de cette partie de la propriété rejoignaient le petit bois extérieur avec lequel ils se continuaient, les yeux n'avaient pas perdu un seul fragment de sa rêveuse promenade. Ils paraissaient englués à son image, reliés à la jeune femme par un pont invisible et pourtant presque palpable de haine absolue. Quand ils virent son sourire, un frémissement imperceptible parcourut l'ensemble du corps immobile. Des muscles, des tendons se nouèrent, des artères se mirent à battre, tout un lacis d'organes se prépara à l'assaut. Cela ne dura qu'un instant infinitésimal, le temps que, par un effort démentiel, le cerveau reprenne le contrôle de l'ensemble et réfrène cette pulsion de rage. Pas encore. Pas maintenant.
La porte de la maison s'ouvrit. Larcher avança de quelques pas et repéra sur sa gauche l'ombre de celle qu'il cherchait.
- Alors, on a son petit moment de nostalgie ? susurra-t-il en la rejoignant et en l'attirant contre lui.
Se libérant doucement, elle embrassa d'un mouvement de son bras droit la pelouse et lui expliqua ses projets. Il écouta avec attention, heureux de la voir si animée, si détendue. En revenant à pas lents vers la maison, d'un geste machinal, il effleura le revolver à sa ceinture. Coralie qui avait remarqué le mouvement lui saisit le bras.
- Impossible de croire dans tout ce calme, dans toute cette tranquillité, les horreurs et les saloperies que... Peut-être qu'il y a ailleurs des gens comme nous qui attendent... qui s'efforcent de vivre encore...
- Sûrement. Sûrement. J'en ai la preuve. C'est pour ça que je te cherchais. Je voulais te dire... Voilà. J'ai capté des gens qui parlent en français.
Coralie s'arrêta et ses yeux bleus, sérieux soudain, accrochèrent le regard de Larcher.
- Raconte.
- En tripotant le poste, j'ai entendu une voix en français. Tu parles d'un choc ! Après je l'ai perdue mais...
- Et ils racontaient quoi?
- Pas facile à dire. La fille - c'était une fille - parlait dans une espèce de code.
- Un code ? Comment ça un code ?
- Ben, tu vois, un peu comme les flics américains, tu sais, quand ils sont en patrouille...
- Non, je sais pas.
- Oh, ben ils disent des chiffres, tu vois. Tel crime, telle agression, c'est tel chiffre. Ce genre là, quoi.
- Ils parlent par chiffres ?
- Pas complètement. Par exemple, j'ai entendu un truc du genre : au 422, BS 2 a rencontré un 14.
- Mais c'est complètement dingue, ça. Ce sont des malades, mon vieux. Ce sont sûrement des Viraux, non ?
- Au début, j'ai réagi comme toi et puis, j'ai pensé... Réfléchis : si tu veux parler avec quelqu'un mais que tu es pas sûr de pas être écouté... Tu comprends, pour pas se trahir, pour pas dire qui tu es et ce que tu fais à n'importe qui, c'est un bon moyen...
- Hmm. Ca me paraît bizarre. T'es sûr que ce sont pas des Viraux ?
- Des Viraux mais dans quel but ? Pour quoi faire ?
- Ça... Avec des malades, on peut jamais savoir...
- En réalité, j'en sais rien. Faut continuer à écouter. Peut-être qu'ils en diront plus. En tous cas, des Viraux finiraient sûrement par se trahir, par finir par craquer, non ? Bon, j'ai laissé le truc en marche, tu viens écouter ? S'ils sont encore là, bien sûr.
- Là, je dois dire que je serais curieuse d'entendre ça !
Les yeux les regardèrent entrer. De les voir bavarder de loin si amicalement, de les savoir si proches l'un de l'autre, si complices, la colère et la haine de l'être s'étaient encore accrues si cela était possible. Il avait de plus en plus de mal à se contenir. Il fallait que le moment vienne. Vite. Très vite.
suite ICI
Tous droits réservés
copyright 943R3EB
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires