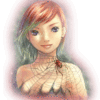-
Samedi 29 mars
Larcher se retournait sur son lit. Depuis un long moment déjà, il n'arrivait plus à dormir. Il se sentait nauséeux, comme au lendemain d'une nuit de libations. Il chercha à deviner les chiffres rouges de son radio-réveil mais la chambre était totalement obscure. Il lui fallut longtemps avant de se rendre compte que la panne de secteur était revenue. Il trébucha en se levant du lit, poussa un juron étouffé et réussit à se traîner jusqu'à la fenêtre. Le volet relevé, le soleil illuminait toute la chambre. La pièce sentait le renfermé, la maladie. Il ouvrit, respira avec délectation l'air frais de l'extérieur. Sa montre bracelet indiquait 8 heures 35. Après s'être aspergé le visage dans la salle de bains aveugle et sinistre, il se sentit un peu mieux. Dans le salon, le désordre était incroyable. Partout des objets divers, livres, clés USB, disques, cendriers débordant de mégots et surtout une armée de bouteilles vides, témoins muets de ces deux jours d'enfermement morose. Il s'affala dans un des fauteuils. On était donc samedi. Tant mieux : il n'aurait pas à supporter les mines apitoyées et les paroles de circonstance de ses collègues de la banque. Samedi. Cela voulait dire aussi qu'il avait un répit pour l'enterrement. Contemplant toutes ces bouteilles dont il ne gardait plus le souvenir, il se rendit compte qu'il avait faim. Il décida de pousser jusqu'à la boulangerie de la rue Lecourbe où ils avaient, Elisabeth et lui, leurs habitudes de week-end. Il enfila un jean à même la peau, attrapa au passage un tee-shirt et ses chaussures de jogging qui traînaient dans un coin et ouvrit la porte d'entrée. Tout à coup, cet appartement vide lui pesait affreusement. Le couloir de l'étage était totalement silencieux et plongé dans une obscurité angoissante. Il fit demi-tour pour prendre sa grosse Maglite qu'il mit plusieurs minutes à retrouver dans un tiroir de la commode près du lit. Ce contre-temps qui, en d'autres temps, l'aurait excédé, le laissa dans une indifférence surprenante. Il avait l'impression d'être hors du temps, presque insouciant, comme au sortir d'une situation de crise terrible dont on revient épuisé et détaché de tout. En bas, le hall d'entrée était désert et la lourde porte grillagée entrebâillée. Il s'avança sur le seuil, prit le temps de respirer le printemps qui venait à sa rencontre. Presque aussitôt, le silence le frappa. La rue Duranton était calme comme un samedi matin mais ce qui était surprenant, c'était la disparition du murmure habituel de la circulation dont l'absence lui perçait les oreilles. On se serait cru un 15 août. Aucun passant sur les trottoirs. Il avança à pas tranquilles vers le carrefour. Seul être animé, un petit chien blanc et noir, traversa la chaussée désertée pour venir à sa rencontre et renifler le bas de ses jeans. Mais dès qu'il se pencha pour la caresser, la petite bête recula vivement et reprit son trottinement. Relançant sa marche, Larcher aperçut une voiture bizarrement arrêtée de travers au feu rouge du carrefour et qui ne semblait pas vouloir reprendre sa route. Il se dirigeait vers elle mais ne pouvait pas encore en apercevoir le conducteur. Un vrombissement de moteur, d'autant plus sonore dans la quiétude du matin, le fit sursauter. Remontant la rue Lecourbe à contre-sens, un 4X4 jaune s'arrêta dans un grand crissement de pneus devant le magasin de Hi-Fi du carrefour. Trois hommes en sautèrent alors que l'engin n'était pas encore totalement arrêté. Sans vraiment savoir pourquoi, Larcher s'immobilisa contre le mur de coin. De ses deux bras déployés très haut au dessus de sa tête, un des hommes brandit une barre de fer et, de toutes ses forces, il l'abattit sur la vitrine de la boutique qui explosa en une myriade d'éclairs ensoleillés. Devant le geste totalement imprévisible, Larcher eut l'impression que son cœur s'arrêtait. Tétanisé, il regarda sans comprendre les trois hommes qui, silencieux, le geste rapide et efficace, commençaient à vider la devanture. La voix étouffée et pourtant parfaitement intelligible l'empêcha de se poser plus de questions.
- Police. On bouge plus, messieurs. Tous contre le mur. Vite.
Comme sortis du néant, trois Gardes Mobiles en tenue de combat venaient de passer le coin du carrefour. Ils avançaient lentement vers le 4X4. Leurs casques aux visières noires baissées, leurs masques à gaz, leurs fusils d'assaut les faisaient ressembler à d'étranges extra-terrestres, angoissants insectes bipèdes. L'un d'entre eux avait un mégaphone. Une automobile blindée les suivait sans bruit, sorte de scarabée maléfique à l'apparence étonnamment agressive. Sa couleur bleu-nuit contrastant avec la luminosité des alentours rehaussait l'improbabilité de la scène. Les trois hommes s'immobilisèrent, lâchèrent leur butin qui s'écrasa sur le trottoir dans un grand bruit de verre brisé et se mirent aussitôt à courir sans se retourner. Une rafale de mitraillette les stoppa net. Ils s'écroulèrent en même temps sur le sol qui déjà rougissait. Larcher, gémissant doucement sans s'en apercevoir, se laissa tomber un peu en arrière dans l'encoignure d'une porte cochère. Pour lui, soudain, tout avait basculé. Le monde était devenu fou. Ecrasé sur le porche, cherchant à se faire le plus petit qu'il le pouvait, presque en position fœtale, il se sentit la proie d'un tremblement incoercible. A chaque seconde, il s'attendait à recevoir lui-aussi une giclée de balles. Rien ne se produisant, il eut le courage de regarder par dessus son épaule. Les Gardes Mobiles tournaient silencieusement autour du 4X4, attentifs. Soudain, ils s'écartèrent brutalement d'un seul mouvement. L'un d'entre eux, de travers par rapport au véhicule, passa la main par la vitre ouverte et déchargea son revolver. Après quelques secondes d'immobilité, les gardes reprirent leur exploration nonchalante. Celui qui semblait être le chef, le porteur du mégaphone, s'approcha finalement des corps, les retourna du bout des bottes puis, semblant s'en désintéresser, fit signe aux autres de continuer leur chemin. Longtemps après la disparition de l'engin blindé, Larcher resta en boule sur son porche, incapable d'oser se lever, hypnotisé par les silhouettes désarticulées qui gisaient sur le macadam. Il devinait nettement les flaques sombres qui s'élargissaient et s'écoulaient lentement dans le caniveau. Les jambes flageolantes, il s'élança enfin vers son immeuble, à quelques dizaines de mètres de là. Il ne sortit la tête de ses épaules que lorsque la porte de son appartement claqua derrière lui. Il resta un long moment appuyé contre le chambranle, couvert de sueurs, le souffle court, encore tremblant de peur rétrospective. Il ne pouvait que se répéter : c'est la guerre civile, c'est la révolution ! Mon Dieu, que s'est-il donc passé durant ces deux jours ? Plus que le spectacle incroyable auquel il venait d'assister, remake en grandeur réelle de ces films policiers américains qu'il regardait parfois d'un oeil distrait à la télévision, c'était la sauvagerie, l'indifférence apparente des forces de l'ordre qui l'avait choqué au plus profond de lui-même.
Larcher essaya d'allumer la télévision mais le courant était toujours coupé. Pas de réseau pour son smartphone dont la batterie était pratiquement vide. Contre toute logique, il s'acharna sur son transistor dont il savait pourtant pertinemment que les piles étaient mortes depuis longtemps. Vaincu, il se laissa une nouvelle fois tomber dans son fauteuil. Il ne pensa que plus tard à ses voisins. Avec mille précautions, il s'aventura de nouveau dans les couloirs de l'immeuble. Mais personne ne répondait aux coups, d'abord hésitants puis de plus en plus violents, qu'il décochait sur les portes muettes. Les appartements paraissaient désertés. On aurait pu croire que la population entière avait fui, il ne savait ni pourquoi ni pour où. Au troisième étage pourtant, il crut entendre un bruissement furtif, signe de vie, présence humaine peut-être. Il insista, criant son nom avec rage pour s'identifier formellement. Quand on lui répondit enfin, il en aurait presque pleuré de soulagement.
- Oui ? Qu'est-ce que c'est ?
- C'est monsieur Larcher, votre voisin du cinquième. Ouvrez-moi. Vous me connaissez sûrement, voyons !
Il entendit un conciliabule, vague murmure à peine audible, comme si les occupants, les Guérin s'il se rappelait bien, se concertaient pour savoir quoi répondre. La voix se manifesta à nouveau derrière la porte.
- Rien à faire. Vous êtes peut-être devenu un Viral, vous aussi, et nous, on veut pas être contaminés.
- Hein ? Mais de quoi vous parlez ? Qu'est-ce que c'est que cette folie ? Qu'est-ce qui se passe donc dans cette ville ? Je viens d'assister à un truc incroyable, en bas, dans la rue.
- Dehors, c'est dangereux. Rentrez chez vous si vous êtes pas encore malade et enfermez-vous à double tour.
- Malade ? Malade de quoi ? Expliquez-vous, nom de Dieu. J'y comprends plus rien, moi !
Le silence dura cette fois un long moment. La voix reprit enfin :
- Vous voulez dire que vous êtes au courant de rien ? Vous ne savez pas ce qui se passe ?
- Mais non, rien, je vous jure. Expliquez-moi, je vous en prie. J'ai besoin de savoir. Si vous voulez pas que je rentre chez vous, venez chez moi. Je suis au cinquième, je vous dis.
- Non, non, pas question. Les Viraux, y paraît qu'ils ont plein de ruses pour faire sortir les normaux de chez eux. On vous connaît pas, nous. Et d'ailleurs même...
- Mais alors, qu'est-ce que je peux faire pour...
- Attendez. Y a peut-être un moyen. Vous partez deux minutes et je vous laisse le journal devant la porte. Y-z-en parlent dedans. Mais j'ouvre pas tant que vous êtes là, compris ?
Interloqué, Larcher se posta dans la cage d'escalier. Il avait éteint sa lampe. L'obscurité était oppressante. Quand il jugea le temps écoulé, il ralluma la torche et revint vers la porte des Guérin. Effectivement, ces derniers avaient jeté un exemplaire du Figaro sur leur paillasson. Il n'avait pas entendu la porte s'ouvrir. Il s'empara fébrilement du journal et courut se réfugier chez lui. A l'abri dans son vestibule, il le déplia. Il s'agissait en réalité d'un supplément de quatre pages qui, d'après la date, avait dû être distribué à la population la veille. Le titre, en grosses lettres noires, le frappa brutalement au visage : AVIS A LA POPULATION, mesures à prendre face à l'épidémie. Il s'avança dans la cuisine pour y voir mieux et c'est debout contre la table qu'il commença à comprendre, qu'il se rendit compte de l'étendue du désastre. Au travers des mots sibyllins, des phrases se voulant rassurantes, il décrypta une situation en fait des plus critiques. Il s'agissait d'un seul grand article, catalogue de recommandations diverses et probablement déjà obsolètes et d'un encart, exposé succinct en termes mesurés et dédramatisants d'un ponte de la médecine qui décrivait les principaux symptômes de la maladie. L'article concluait sur une note optimiste et l'affirmation péremptoire que les Autorités avaient la situation bien en main. S'il en jugeait par ce qu'il venait de voir, Larcher n'en était pas si sûr. Abasourdi, il s'avança vers la fenêtre pour réfléchir. Dehors, le temps était toujours aussi délicieux, le soleil radieux. On avait peine à croire que la civilisation s'était arrêtée, qu'elle était peut-être en train de s'effondrer. Dans le silence à présent expliqué, il entendait le pépiement des oiseaux. Il ouvrit la fenêtre, se pencha. En bas, tout semblait normal hormis l'absence de passants. Des voitures, plutôt moins que d'habitude, étaient normalement garées le long des trottoirs. Il ne pouvait apercevoir le carrefour Lecourbe de là où il se tenait. Il frissonna en repensant aux violences. Plus loin, les toits scintillaient sous la douce luminosité de la fin du mois de mars. Plus loin encore, un énorme panache de fumée noire qui s'élevait tout droit dans le ciel bleuté rappelait néanmoins que plus rien n'était comme avant. En soupirant, il regagna son salon. A l'évidence, il lui fallait à présent aviser sur son sort. Une explosion lointaine, suivie d'une série de détonations plus sourdes lui rappelèrent qu'il n'était pas seul, qu'il était probablement entouré d'individus dangereux. Mais comment les distinguer des autres ? Ces autres qui devaient bien continuer à exister quelque part, qui devaient, comme les Guérin - et comme lui à présent - se terrer chez eux ou s'être enfuis hors de la ville mais pour vraisemblablement retrouver ailleurs les mêmes problèmes, les mêmes peurs. Il n'alla pas à la fenêtre pour chercher à connaître l'origine des bruits, d'ailleurs probablement inidentifiable. Il s'empara d'une chaise, l'amena dans sa chambre, l'installa contre la grosse armoire et monta dessus. Il retira du haut du meuble un paquet de chiffons empoussiérés que, une fois redescendu, il déplia avec soin. Il en sortit un gros Lüger, prise de guerre de son père et dont il n'aurait jamais cru le récupérer dans de telles circonstances. L'acier sombre et méchant de l'arme le rassura un peu.
Tous droits réservés
copyright 943R3EB
 votre commentaire
votre commentaire
-
Lundi 31 mars
Carrefour Sèvres-Babylone, l'encombrement était intense et pourtant on ne pouvait distinguer aucun mouvement en dehors de ceux des feuilles naissantes des arbres qui frémissaient faiblement par instants ou d'un papier qui, de temps à autre, voltigeait erratiquement. Des dizaines de véhicules étaient entremêlés dans tous les sens sur la place et jusque sur les trottoirs du boulevard Raspail et de la rue de Sèvres. Des dizaines, des centaines de voitures, des camions, un autobus renversé en plein centre de la chaussée, mais rien ne bougeait. Emergeant du hall de l'hôtel Lutetia, un grand homme roux s'avança sur le trottoir et contempla avec jubilation le grotesque spectacle qui s'offrait à ses yeux. Il était grand, plus d'1 mètre 90. Sa taille paraissait encore plus élevée en raison de l'imperméable gris qui lui descendait presque jusqu'aux chevilles et qui rappelait ces cache-poussière qui avaient jadis fait la renommée de certains westerns-spaghettis. Il tenait à la main gauche un fusil à canon scié négligemment abaissé vers le sol. Il passa sa main droite dans ses cheveux longs et sales, resta plusieurs secondes songeur avant de se retourner vers le bâtiment.
- Alors, bordel de Dieu, vous vous amenez, oui ou merde ?
L'un après l'autre, quatre individus aussi sales que lui émergèrent de la pénombre et vinrent l'encadrer. Le plus gros d'entre eux, bizarrement coiffé d'une sorte de chapeau haut-de-forme à la couleur noirâtre délavée, cracha par terre. Le grand roux fit un écart, soudain furieux.
- Eh, Sammy, tu me cherches ou quoi ? hurla-t-il en regardant ses bottes poussiéreuses.
Les trois autres s'esclaffèrent.
- Y a pas d'offense, Jude. L'ai pas fait exprès, éructa le gros.
Le roux haussa les épaules, s'avança sur le boulevard et, sans presque prendre d'élan, il sauta sur le capot d'une 207 rouge qui se trouvait devant lui. Ses bottes imprimèrent profondément leurs traces sur la voiture et l'homme, en déséquilibre inattendu, faillit retomber en arrière. Sans bouger de sa place, le gros lui lança :
- Eh, Jude, mon pote, tu vas te péter la gueule. Fais gaffe.
Le roux ne chercha pas à lui répondre. Il reprit son élan et sauta sur la voiture voisine puis sur la suivante. Ses quatre acolytes applaudissaient en riant à chacun de ses sauts. De voiture en voiture, Jude se retrouva au milieu du boulevard Raspail, sur le capot d'une BMW bleue où il s'arrêta. Il se pencha pour observer le pare-brise de l'automobile. En son centre, on distinguait un trou parfaitement rond dans le verre. L'orifice d'entrée d'une balle perdue. Derrière le volant, il pouvait voir le cadavre raidi, déjà en voie de décomposition, d'une femme blonde dont le rictus semblait le narguer. Sur le siège de droite, un empilement de valises et de vêtements. Mais ce qui avait attiré le regard de Jude, c'était un mouvement à l'arrière du véhicule. Un chien. Un cocker, roux comme lui, qui l'observait avec des yeux fous. Jude leva son fusil puis le rabaissa, sauta sur l'asphalte, contourna la voiture et balança sa crosse dans la lunette arrière qui explosa. Une puanteur abjecte lui fit faire la grimace. Introduisant avec précaution sa main gantée par l'orifice, il fit sauter la condamnation et ouvrit la portière.
- Allez, mon pote. Sors de là. C'est mon jour de bonté.
Le chien hésita, renifla l'air frais puis, vif comme l'éclair, se rua à l'extérieur. Jude le regarda se faufiler sous les voitures voisines et se perdre au loin. Les autres s'étaient approchés en contournant les cercueils de taule.
- Ben lors, Jude, tu t'entraînes plus au tir ? s'exclama le plus jeune, un Noir tout en jeans.
- Ta gueule, le black, c'est mon jour de bonté que je te dis. Et puis, je vais pas gâcher une balle pour c'te merde. Allez, on s'arrache. On se fait chier ici.
Le petit groupe se dirigea vers le haut du boulevard Raspail au moment où les premières gouttes d'eau commençaient à tomber mais aucun des cinq hommes n'y prêta attention. Ils surveillaient uniquement d'éventuels mouvements, un bruit, une voix qui auraient trahi une présence humaine, l'ennemi. Plus on avançait, plus il y avait de voitures enchevêtrées. Et quelques cadavres pourrissants qui rappelaient qu'à cet endroit, quelques jours, plus tôt, il y avait eu de violentes émeutes.
- Ca schlingue, ici, merde ! murmura Sammy.
- T'as qu'à te boucher le pif, Ducon, répondit Jude en regardant ailleurs.
Jude était d'excellente humeur. Depuis une semaine, il avait enfin l'impression de vivre. Il se rappelait à peine son existence d'avant quand, brancardier à l'hôpital Lariboisière, il devait subir la loi des petits chefs, les vexations, la dictature des autres, lui, avec ses potentialités, son intelligence. Fini tout ça, se répétait-il sans cesse, maintenant, c'est moi qui commande. Dans ce monde pourri, c'est moi le chef. Parce que je suis le plus capable, le plus apte à survivre. Eh, oui, messieurs, mesdames, ce monde dégueulasse est mort, fini, enterré. Les règles ont changé. Tout a changé. Jusqu'à mon nom, Jude. Il ne se rappelait même plus où il l'avait trouvé, ce nom, ni qui le premier l'avait appelé ainsi. Nouveau nom, nouvelle identité pour un monde nouveau, qui appartenait à des mecs comme lui, les meilleurs. Il éclata de rire et bientôt les autres se joignirent à lui. Il s'arrêta de rire aussi vite qu'il avait commencé, regarda ses compagnons.
- Qu'est-ce que vous avez à vous gondoler, bande de ploucs ?
- Rien, rien, mon pote, murmura Sammy, on est content parce que t'es content, c'est tout. Puis voyant que la conversation prenait un tour dangereux et que Jude semblait sur le point de démarrer une de ses fréquentes crises de rage, il poursuivit : Dis, Jude, tu crois pas qu'on devrait ratonner une ou deux baraques par ici ? P't être qu'on trouverait une gonzesse comme l'autre jour, histoire de se marrer un peu, non ?
Jude s'était arrêté de marcher. Il fixa de petits yeux bleus et méchants sur son interlocuteur qui, mal à l'aise, se tortilla sur place. Un bruit de voix détourna leur attention. Un homme venait à leur rencontre en gesticulant et en criant. Jude se remit à sourire.
- Attendez, les mecs, y a p't être mieux à faire.
Durant ce premier week-end de crise, Larcher n'avait pas chômé. Au début, après avoir lu le journal, il était resté un long moment abattu, prostré, replongeant ainsi de quelques heures en arrière mais, cette fois, c'était son propre sort qui le préoccupait. Il avait eu beau retourner le problème dans tous les sens, il ne voyait pas comment il pouvait éviter d'être à son tour contaminé. Bien que n'ayant que peu de lumières en médecine - et singulièrement en infectiologie - il n'était pas assez fou pour espérer un seul instant passer au travers. Même en se calfeutrant dans un endroit isolé, même en fuyant toute présence humaine. D'ailleurs, il s'était demandé ce qu'une telle solution lui aurait apporté, à part cette même folie qu'il cherchait précisément à éviter. Larcher était un esprit raisonnable, c'est-à-dire, en définitive, plutôt optimiste. Déjà, par le passé, confronté à des situations sur lesquelles il n'avait pas prise, il avait fini par s'accommoder, par se faire une raison. Son existence présente était des plus menacées, il le savait bien, mais il était arrivé à se convaincre que se cacher la tête dans le sable ne changerait rien à l'affaire. Il avait donc décidé de prendre le maximum de précautions raisonnables pour vivre le plus longtemps mais le plus confortablement possible. Concernant le reste, on verrait bien. Sortant de sa méditation, sinon rassuré du moins renforcé dans sa détermination de ne pas renoncer, il avait mis sur pied un plan de bataille destiné à assurer sa survie immédiate. Il avait commencé par faire le compte des provisions laissées par sa femme. Toutes les denrées surgelées allaient être rapidement perdues en raison de l'absence d'électricité et il n'y avait que peu de conserves : il lui fallait donc se ravitailler. Pour cela, il devait se procurer un véhicule autre que sa voiture trop peu défendable et qu'il n'était d'ailleurs pas sûr de retrouver intacte.
Le samedi en fin de soirée, enveloppé dans sa parka sombre, le Lüger d'une main et la Maglite éteinte de l'autre, il s'était fondu dans la nuit froide. La ville plongée dans l'obscurité représentait un univers totalement nouveau pour lui. Il n'avait pas reconnu grand chose de ces lieux où il avait pourtant passé tant d'heures de sa vie. Heureusement, la lune qui éclairait par intermittence son chemin lui avait permis de progresser assez rapidement vers le but qu'il s'était fixé : le concessionnaire automobile de la rue Lecourbe. Malgré l'absence apparente de présence humaine, de multiples bruits l'avaient fait sursauter plus d'une fois. Toute une vie nocturne continuait, fantômes épars d'une civilisation qui s'éteignait : miaulements de chats, aboiements lointains, claquements de volets, sons inidentifiables et qu'il était arrivé progressivement à distinguer sinon à reconnaître. La chance l'avait servi. Arrivé en rasant les murs près du magasin, il s'était directement rendu dans la cour latérale où il savait que l'on entreposait les réserves de véhicules. Il jeta d'emblée son dévolu sur une Range Rover flambant neuve qui miroitait faiblement dans la nuit. Il ne lui était plus resté qu'à s'en procurer les clés. Il avait pu entrer sans difficulté dans le magasin dont la porte était grande ouverte, apparemment fracturée par quelque pillard qui avait eu une idée voisine de la sienne. Il avait dû chercher de longues minutes les clés de contact du véhicule et était tombé dessus par hasard, au moment où il se demandait si la prudence ne lui soufflait pas de renoncer provisoirement. Le 4X4 n'avait que peu d'essence, suffisamment néanmoins pour qu'il ait pu rapatrier sa prise jusqu'au garage souterrain de la rue Duranton. En chemin, mis en confiance par la réussite de ses opérations, il avait même fait un détour par l'armurerie de la rue Saint Lambert. Là, il avait eu plus de difficulté pour s'introduire dans l'établissement mais avait fini par y parvenir sans faire trop de bruit. Il en était ressorti chargé de deux revolvers, d'un fusil à pompe et de suffisamment de munitions pour soutenir un siège. Sur le chemin du retour, euphorique, il en était arrivé au point de ne plus se soucier du bruit du moteur dont le vacarme semblait porter à des kilomètres. Revenu à son domicile, enfermé à double tour et avant d'allumer la lampe à gaz qu'il avait également subtilisée chez l'armurier, il avait pris la précaution de clore le plus hermétiquement possible ses volets. Au cours de son périple, il avait en effet remarqué quelques rares lueurs de bougies dans certains immeubles et si ces témoignages de vie l'avait réconforté en lui prouvant qu'il n'était pas tout à fait seul dans sa situation, il ne pouvait que désapprouver ce qu'il considérait comme de véritables appels au meurtre, compte-tenu de la faune qui devait vraisemblablement errer aux alentours. Cette nuit-là, épuisé par toutes ses angoisses, il avait dormi tranquillement, uniquement réveillé au petit jour par le bruit d'une conversation animée suivi d'un cri de femme. Immédiatement attentif, il avait guetté mais, rien ne se produisant plus, il avait replongé dans un sommeil sans rêve.
Il avait passé son dimanche à mettre de l'ordre dans son appartement et à se familiariser avec le maniement de ses nouvelles armes. Il n'était sorti que quelques minutes pour aller vérifier que la Jeep était toujours intacte dans son box. Ayant enfin devant lui suffisamment de recul et de temps pour commencer à réfléchir, il était arrivé à la conclusion qu'il lui fallait quitter Paris, ville bien trop dangereuse et certainement sans avenir pour quelqu'un comme lui. Il se proposait toutefois de laisser passer quelques jours, pour voir comment la situation évoluerait. Au fond de lui, il se disait sans trop y croire qu'il était possible que les autorités, qui devaient bien encore exister quelque part, allaient peut-être trouver un moyen de redresser la situation. Sinon, il partirait mais sans savoir véritablement pour où. Dans l'intervalle, s'il ne voulait pas mourir de faim et de soif, il lui fallait faire des provisions. Il programma pour le lendemain une visite dans un quelconque supermarché.
Larcher se réjouissait d'avoir su se procurer le 4X4. Il l'avait bourrée de jerricans d'essence volés dans une station service près de la place Balard, au prix d'une forte suée à pomper manuellement le carburant dans les citernes paralysées. Remontant en direction du Monoprix de la rue de Vaugirard, il avait pu constater combien la circulation était difficile dans ces rues encombrées de véhicules abandonnés. Plus d'une fois, il avait dû manœuvrer sur les trottoirs pour éviter les divers obstacles éparpillés par la panique d'une fuite éperdue. Le Range répondait parfaitement bien à présent qu'il en dominait la conduite. Il avait croisé quelques rares silhouettes, un ou deux groupes, qu'il avait pris grand soin d'éviter du mieux qu'il pouvait. A la hauteur de la rue Leriche, il lui sembla apercevoir au loin, vers le carrefour Convention, un convoi d'allure militaire et il arrêta sa voiture en catastrophe, le cœur battant. Il fit le mort un bon quart d'heure avant de reprendre sa route lentement, les yeux aux aguets. Garant la Jeep le plus près possible du Monoprix aux vitrines éventrées, il attendit encore plusieurs minutes avant de s'aventurer dans la pénombre du magasin. Le désordre à l'intérieur était extrême mais il se rendit vite compte que la majorité des denrées était encore récupérable. Il s'empara d'un caddy abandonné et parcourut les rayons. A l'exception du clair-obscur oppressant, il aurait pu se croire en train de faire ses courses un après-midi comme les autres. Poussé par une angoisse sourde en raison de sa vulnérabilité, d'une main il entassait rapidement les produits, tenant de l'autre son fusil à pompe. Alors qu'il se penchait pour attraper des paquets de riz, il eut la sensation d'une présence, d'une odeur de sueur et de crasse. Avant qu'il ait pu réagir, un coup violent expédia son arme à plusieurs mètres tandis qu'un bras ferme lui enfonçait le canon d'un revolver dans les côtes.
- Salut, p'tite tête. Alors on fait ses courses ?
Sous la menace de l'arme, il se retourna lentement. Dans le contre-jour, il distinguait un homme corpulent et de petite taille, affublé d'un vieux chapeau haut de forme, qui hochait gentiment la tête. Il chercha du regard un moyen de s'échapper mais le gros recula d'un pas et lui désigna l'entrée du magasin avec son revolver.
- Te fatigue-pas, mon pote, on va aller se faire une p'tite ballade, toi et moi, s'exclama l'homme.
La lumière grise du jour le fit cligner des yeux tandis que, l'esprit en déroute, il ressortait sur le trottoir, l'individu dans son dos. La pluie qui s'était remise à tomber rehaussait le caractère misérable de sa situation.
- Jude, mon p'tit pote, vise un peu ce que je te ramène...
Un petit groupe s'avançait vers eux. En tête marchait un grand type en imperméable gris, une sucette à la bouche. Derrière lui, deux hommes en poussaient un troisième, un vieux en costume trois pièces maculé de boue, le visage ensanglanté et qui gémissait faiblement. Un jeune Noir en jeans les suivait, un énorme radio-cassettes comme il n’en avait pas vu depuis des années sur l'épaule, se dandinant au rythme d'une salsa. Orange Mécanique, merde, une caricature de film d'épouvante, se murmura Larcher, au comble du désespoir. Le grand type s'arrêta à quelques mètres de lui, cracha sa sucette et mit ses mains sur ses hanches.
- Voyez-vous ça, voyez-vous ça ! jeta-t-il. Mais c'est qu'tu deviens bon, mon vieux Sammy. J'vais finir par t'balancer une médaille, tu sais. Alors, adressa-t-il à Larcher, qu'ek tu fabriquais donc là-dedans ? T'étais pas un peu en train d'piquer des trucs, toi ? Mais tu sais pas que c'est illégal, ça ? Hmm ? Tu s'rais donc un p'tit salopard, toi aussi. Alors qu'y a déjà tant de malheurs dans c'te bas monde ! Pas bien, ça, pas bien du tout.
Jude ouvrit lentement son imperméable, en sortit son fusil à canon scié de la poche intérieure puis se tourna vers ses acolytes.
- Messieurs, il va falloir aviser. D'une certaine manière, nous représentons la Loi dans cette ville, vous savez. En attendant le retour des légitimes autorités, bien sûr. Et il y a certains... Hmm... débordements que nous ne pouvons pas tolérer.
- Mais on est tous dans le même... tenta de dire Larcher.
- Ta gueule, fleur de nave. On va tous aller faire un petit tour dans la cabine là-bas. En route !
Il désignait un abri-bus vers lequel le groupe se mit en marche. Il avait beau chercher, Larcher ne voyait pas comment se sortir de ce guêpier. Et pourtant, c'était urgent, l'attitude de ces malades ne lui laissait aucun doute là-dessus. Dans l'abribus, on les fit asseoir, lui et le vieux, sur le banc qui avait connu dans un passé récent des heures plus pacifiques. Jude se planta devant ses prisonniers, le fusil à demi levé, menaçant alternativement l'un et l'autre.
- Messieurs, comme vous le savez sans doute, commença-t-il, il est assez difficile en ces temps troublés de trouver un tribunal susceptible de statuer sur un cas comme le vôtre. Il nous faudra donc improviser. Mais commençons par le commencement. Toi, d'abord, adressa-t-il au vieux, qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense ? Trouble de l'ordre public à ce qu'il paraît. Tu sais que c'est ennuyeux, ça ? Hmm ? Alors, tu dis quoi ?
Le vieux regardait par terre en se contentant de gémir. De temps à autre, il passait faiblement une main sur son visage tuméfié, en apparence indifférent à ce qui pouvait lui arriver.
- Alors, tu sais rien, quoi. T'as rien vu. T'es pas au courant. L'est pas au courant ! s'exclama Jude en se tournant vers les autres qui se mirent à ricaner.
La détonation soudaine retentit comme un coup de canon. Le vieux fut projeté en arrière, dans un geyser de sang tandis que la vitre de l'abribus s'écroulait avec un grand fracas. Sans réfléchir, Larcher se jeta sur Jude qui, surpris, bascula en arrière, lâchant son fusil. Larcher s'en empara vivement, se retourna vers les autres qui n'avaient pas fait le moindre geste et, sans vérifier la sécurité de l'arme, appuya sur la gâchette. Le coup emporta la moitié de la tête de Sammy et le bras gauche du Noir. Comme dans un ralenti au cinéma, Larcher vit le haut-de-forme tournoyer tandis que le corps du gros homme s'affalait lourdement. Il se releva au moment où Jude, revenu de sa surprise, se jetait sur lui, le manquant d'un cheveu. Dérapant sur le sol mouillé, il réussit à recouvrer son équilibre et, lâchant le fusil, il se lança sans se retourner dans une fuite éperdue. Il entendait les cris de douleur du Noir qui hurlait sans discontinuer. Plusieurs détonations lui firent, dans un geste instinctif et absurde, rentrer la tête dans les épaules. Il courait droit devant lui, l'esprit vidé par une angoisse totale, n'évitant qu'au dernier moment des obstacles divers qu'il n'avait pas le temps d'identifier. La peur lui donnait des ailes. Il pouvait aisément discerner à quelques dizaines de mètres derrière lui les pas de ses poursuivants et la voix rauque de Jude qui criait :
- Attrapez-le, c't'ordure, bordel ! Le laissez pas foutre le camp, merde !
Larcher contourna plusieurs voitures emmêlées, remonta sur le trottoir du terre-plein central de la rue de la Convention au moment où une balle faisait éclater un pare-brise derrière lui. Volant littéralement, il s'engouffra dans la bouche de métro, sauta plusieurs marches d'un seul coup et s'écrasa contre la grille tirée. Heureusement, des squatters l'avaient déjà forcée et il put s'introduire dans le couloir. Il avança sans hésiter dans le noir absolu, se heurta peu après aux portillons tournants qu'il sauta, se reçut difficilement, descendit une nouvelle volée de marches et s'arrêta à bout de souffle. Il entendait les autres qui criaient plus haut. Il avait quelques secondes devant lui. Répugnant à s'enfoncer plus avant dans ce labyrinthe sinistre, il fouilla sa poche de jean et en sortit une boîte d'allumettes. Il se trouvait dans un couloir qui se coudait à quelques pas devant lui. Il repéra une porte de service sur la gauche et, comme les cris se rapprochaient, il s'avança vers elle. La porte n'était pas fermée. Il entra.suite ICI
Tous droits réservés
copyright 943R3EB
 votre commentaire
votre commentaire
-
Lundi 31 mars (suite)
Larcher se laissa tomber contre la porte. Les cris se faisaient plus pressants. Il reconnut la voix de Jude qui devait être tout proche quand, à bout de souffle, il hurla d'une voix suraiguë :
- Mais, bordel de merde, vous avez vu ce qu'il a fait à Sammy, c’te espèce d'enculé ? Hein, vous avez vu ? Et dire que ce connard donnait l'impression de péter de trouille. Tout gentil, tout calme, le salaud. Merde, on s'est fait avoir comme des bleus. Et c'est lequel de vous deux qu’aurait bougé, hein ? Lequel ?
- T'excites pas, Jude, on finira bien par le coincer, c'te salope, murmura un de ses hommes.
- Ouais, ben j'te dis pas ce que je lui ferai à cette ordure quand je l'aurai à ma pogne, reprit Jude. Ta lampe, bordel, éclaire dans le fond, là, et puis non, tiens, passe-la-moi plutôt. Décidément vous êtes rien que des connards.
Larcher avait posé à tâtons la main sur une sorte de barre de fer qu'il se contentait de caresser sans oser la tirer vers lui de peur de faire du bruit. Mais si Jude et ses hommes ouvraient la porte, il se promettait de défendre chèrement sa peau. Les voix pourtant diminuaient de volume. Les tueurs avaient probablement décidé de poursuivre plus avant leur exploration mais ce n'était sûrement pas le moment d'aller vérifier. Larcher les entendit revenir longtemps après, balançant de grands coups de bottes dans les murs du couloir, de colère et de frustration. Il laissa encore s'écouler de longues, longues minutes avant de se lever avec précaution, bien décidé à réemprunter le chemin par lequel il était venu. Il ne se voyait pas explorer ce métro de tous les dangers avec une simple boite d'allumettes. A présent, il distinguait parfaitement le cadran lumineux de sa montre bracelet et décida qu'il était temps de sortir. Avant d'ouvrir la porte de la pièce, il se pencha pour récupérer dans l'obscurité épaisse la barre de fer, défense rudimentaire sans doute, mais en tout cas certainement plus performante que ses seules mains nues. Le métal racla douloureusement le sol carrelé. La lumière violente d'une torche électrique projetée tout à coup en plein milieu de son visage le frappa plus fort qu'une agression physique réelle. Sur le moment, il eut l'impression de devenir fou tant sa surprise fut intense. Il poussa un gémissement de frayeur. Il n'était pas seul. Pas un instant, il n'avait été seul et il n'avait rien deviné, rien entendu. La voix calme et mesurée était pleine de violence contenue. C'était une voix de femme.
- Laissez tomber votre barre. Vite. Et tournez-vous, mains en l'air appuyées contre le mur. Tout de suite.
Il s'exécuta, totalement dépassé. Le silence se réinstalla. Il hasarda :
- Mais vous êtes qui, bon Dieu ? Et qu'est-ce que vous me voulez ?
- Chut, moins fort. J'ai pas envie de connaître vos copains de trop près.
- Ce ne sont pas mes copains.
- J'ai cru deviner.
Nouvelle silence. Larcher, qui se remettait à peine, chercha à savoir.
- Qu'est-ce que vous fabriquez ici ?
- Pas vos oignons. Pour le moment, vous me racontez votre histoire. Et tachez d'être convaincant, hein ? Non, on ne bouge pas. On reste contre le mur. Et n'ayez pas de faux espoirs : ma torche a des piles neuves et mon revolver est bien chargé. Allez, go !
D'abord hésitant, puis de plus en plus rapidement, il raconta. Sa femme. La violence de la police. Jude et ses comparses. Il ne passa sous silence que les armes chez lui et le 4X4 devant le Monoprix qu'il n'avait pas renoncé à récupérer. Quand il s'arrêta, la voix ne lui demanda rien. Il reprit :
- Écoutez, je vous ai tout dit. Vous savez tout de moi et moi rien de vous.
- Normal, c'est moi qui tiens le revolver.
- Bon, d'accord, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait ? On va pas passer la nuit ici, non ? Ecoutez, vous me laissez partir et on en reste là, vous voulez bien ?
- C'est ça, pour que vous me sautiez dessus dès que moi je sortirai.
- Mais non, je vais pas... Bon Dieu, c'est complètement con. Vous croyez pas que j'ai suffisamment d'ennuis comme ça ? Hein ? Pourquoi vous dites rien ? Bon, puisque c'est comme ça, je m'assieds. Je suis crevé. Doucement, gentiment, je vais m'asseoir. Vous avez rien à craindre. Je ne vous veux aucun mal.
Larcher attendit quelques secondes et, devant l'absence de réponse de son interlocutrice, il se retourna et se laissa glisser le long du mur, les mains bien en évidence. Le faisceau de la torche le suivit jusqu'au sol. Autant pour échapper à la lumière aveuglante que pour reprendre ses esprits, il cacha son visage entre ses mains. Il ne pouvait pas voir la femme, ni même l'entendre respirer. Au dessus d'eux, il percevait le chuintement d'un tuyau ou d'une fuite d'eau, des craquements parfois. Des rats, peut-être. Il était fatigué et, en même temps, extraordinairement vigilant. Par dessus tout, il en avait assez de cet univers absurde où tout basculait à chaque instant, où les menaces étaient permanentes. La voix le fit sursauter.
- Bon, j'ai décidé de vous faire confiance. Enfin, partiellement.
Larcher releva la tête au moment où la torche l'abandonnait pour se fixer sur la porte avant de s'éteindre. Il perçut le mouvement de la femme, plus par un frôlement, un déplacement d'air que par le bruit. Elle était tout près de lui quand elle chuchota mais il n'avait plus peur.
- On va sortir. Ensemble. On se quitte en dehors de la station. Mais pas de blague, hein, je vous tiens à l’œil et n'oubliez pas que...
- …vous avez le revolver. Je sais.
Dans le couloir, elle allumait sa lampe par intermittence, quelques fractions de seconde, pour leur ouvrir le chemin, prête à se fondre dans les ténèbres à la moindre alerte. Il la devinait derrière lui, attentive. Ils émergèrent prudemment de la station Convention. La nuit, à nouveau, mais avec une luminosité diffuse qui tranchait avec la noirceur profonde du métro. Les tueurs avaient disparu. En haut de l'escalier, il se tourna vers elle qui le suivait, arme braquée. Jeune et mince, vêtue d'un pantalon et d'un chandail sombres, c'est tout ce qu'il pouvait en dire. Interprétant son regard, elle murmura :
- C'est ici que nos chemins se séparent, monsieur le fugitif. Je vous souhaite bonne chance.
Mais elle ne partait pas, prudente. Il hasarda :
- Et si on faisait encore un bout de route ensemble ? Vous savez, vous me semblez être la première personne normale que je rencontre depuis... Qu'est-ce que vous en dites ?
- Et si j'étais quand même une Virale, hein, monsieur le malin ?
- Ben, heu... Je sais pas. Je crois pas. Et moi alors ?
- Pas l'air. Et, vous savez, j'ai appris à les reconnaître, ceux-là. Non, je pense pas que vous soyez un Viral. Enfin, pas encore.
- Alors ?
Elle resta quelques instants pensive puis haussa les épaules sans répondre. Larcher tâta ses clés dans le fond de sa poche et reprit :
- Hmm... Faut que je vous dise. J'ai une voiture plus bas, dans la rue de Vaugirard. C'est justement là que... mais je vous raconterai ça plus tard si vous voulez. Un 4X4. On peut aller partout avec ce genre de truc. On essaie de le récupérer et après on avise, qu'est-ce que vous en dites ?
Pour la première fois, elle ébaucha un sourire. Dans la clarté diffuse de la lune nuageuse, il avait pu discerner la blancheur de ses dents. D'un signe de tête, elle désigna la rue.
- C'est trop dangereux ici. On y va.
A vrai dire, il n'avait pas prévu de récupérer si vite le Range Rover. Les événements de l'après-midi étaient encore bien trop présents à son esprit. Cependant, maintenant, il ne pouvait plus reculer. D'ailleurs, à deux, l'entreprise serait plus facile. Le 4X4 était toujours au même endroit, intact. La rue paraissait déserte. L'abribus dressait sa masse sombre de l'autre côté de la chaussée mais il ne s'attarda pas à vérifier si les corps étaient toujours là. Procédant par petits bonds successifs, plaqué contre les murs des immeubles, la femme quelques mètres derrière lui, il s'approcha à couvert le plus près possible du puissant véhicule, marqua un temps d'arrêt puis s'élança, les clés déjà prêtes dans la main. Tout en manipulant fébrilement le contact, il entrebâilla l'autre portière pour la femme qui monta sans hésitation. Une minute plus tard, la voiture démarrait sans heurt, son moteur rugissant dans le calme de la nuit. Un bref instant, Larcher avait envisagé d'aller récupérer son fusil abandonné dans le Monoprix mais il avait jugé plus sage de ne pas tenter le sort. Ils roulèrent au hasard quelques minutes. La lumière blanche des phares éclairait un paysage fantomatique de voitures abandonnées qu'ils devaient contourner avec précaution. Sans regarder sa compagne, il interrogea :
- Qu'est-ce qu'on fait ? Vous voulez que je vous ramène chez vous ? Si vous me dites où vous habitez, bien sûr.
- J'habite du côté de la porte de Bercy mais...
Sa réserve était perceptible. Larcher, sans quitter la rue des yeux, reprit :
- Vous voulez… venir prendre un verre et discuter un peu chez moi ? Après, je vous dépose où vous voulez, je vous le promets ! Vous savez, il est encore tôt, à peine 9 heures du soir (Il se mit à rire). C'est marrant parce que j'ai l'impression de chercher des raisons pour pas qu'on se sépare déjà. Comme avant toute cette merde. Et puis, c'est vrai que j'ai envie de parler avec quelqu'un, de faire le point, de savoir ce que vous pensez de tout ça. Alors ?
- Alors pourquoi pas ? répondit-elle enfin. Mais, je vous préviens, j'ai eu récemment quelques expériences malheureuses et je suis devenue très, très méfiante. Au moindre geste suspect, je mets les voiles.
- OK, OK, je vous jure que je n'ai aucune mauvaise intention.
La rue Duranton était sinistre mais vide. Aucune lumière apparente dans son immeuble. Cage d'escalier déserte. Il voulut s'effacer pour la laisser entrer dans l'appartement mais, avec sa lampe électrique, elle lui fit signe d'ouvrir le chemin. Hochant la tête, il jeta sa parka au hasard, se dirigea droit dans le salon, alluma la lampe à gaz et se tourna vers elle. Il l'avait entendu claquer la porte d'entrée mais elle n'avançait pas. Il pouvait la voir, debout dans l'entrée, immobile à explorer les murs avec sa torche, hésitante encore. Il fouilla dans le bar, réussit à retrouver une bouteille de Vodka rescapée.
- Vodka, ça vous va ? C'est apparemment tout ce qui me reste.
- Un doigt, merci.
Elle s'avança en scrutant les lieux avec attention. De taille moyenne, la trentaine, elle était brune avec des yeux clairs et un visage très pâle. Il devinait qu'elle aussi avait dû passer par des moments difficiles et il se sentit tout à coup très proche d'elle. Larcher la trouvait très attirante malgré son pantalon et son pull bleus souillés de poussière. Après toute cette crasse des jours précédents, elle lui redonnait une impression de civilisation et il se dit que, rien que pour cela, il avait de la chance. Pour la mettre à l'aise, il lui fit visiter l'appartement. Peu après, il la faisait asseoir sur le canapé du salon avant de s'installer dans le fauteuil en vis-à-vis. Alors que, silencieusement, elle faisait tourner entre ses doigts, sans le boire, son petit verre d'alcool, il lui raconta à nouveau son existence des jours précédents et essaya d'avancer quelques hypothèses sur l'avenir de leur monde en déroute. Elle ne répondait à ses phrases que par monosyllabes mais elle paraissait se détendre. Il ne voulait surtout pas la brusquer.
- Vous savez, poursuivit-il après un silence, j'ai deux questions qui... Mais, à propos, vous connaissez mon nom, vous le connaissez même depuis le début, mais moi je...
- Coralie.
- Coralie. Ah, c'est joli.
Il regretta immédiatement la banalité de sa remarque et chercha à enchaîner sa phrase le plus rapidement possible.
- Eh bien, Coralie, je vous disais... Oui, il y a deux questions que j'aimerais vous poser, vous voulez bien ?
- Dites toujours.
- Voilà. D'abord, je voudrais bien savoir pourquoi vous ne m'avez pas laissé tout simplement partir, tout à l'heure, dans le métro. J'ignorais complètement que vous étiez là. Je me serais jamais douté...
- Oh, c'est facile à expliquer. Je ne pouvais pas être sûre que vous ne m'aviez pas repérée et quand vous avez saisi cette barre de fer, j'ai préféré prendre les devants, voilà tout. Et l'autre question ?
- Ben, si j'ai bien compris, vous habitez dans l'est de Paris alors je me demandais...
- ...ce que je faisais si loin de chez moi et cachée dans le métro ? Là aussi, c'est facile à expliquer. J'ai des amis qui n’habitent pas très loin d'ici et, samedi, quand le téléphone marchait encore, on avait discuté de tout ce qui se passait. Ils semblaient eux aussi en bonne santé. Ils devaient me rappeler mais, bien sûr, ils n'ont pas pu le faire alors comme j'en avais marre d'être toute seule... Seulement, voilà, il n'y avait personne chez eux. Enfin, disons plutôt qu'ils n'ont pas répondu quand j'ai sonné...
- Vous pensez qu'ils n'ont pas voulu vous ouvrir ?
- Ca, j'en sais rien. Toujours est-il qu'en ressortant de leur immeuble, il y avait une bande de types et de filles autour de ma voiture. Je ne me suis pas vraiment méfiée - et pourtant Dieu sait si je fais attention depuis trois jours - mais quand ils m'ont vue, ils se sont mis à crier et à me courir après. Alors, j'ai fait comme vous. Le métro. Seulement moi, j'avais tellement peur que je suis allée plus bas, jusqu'au quai et alors là... C'était affreux. Des tas de gens par terre, morts... des enfants... Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas... Je suis remontée comme une folle, j'ai vu la porte dans le mur du couloir. Je suis entrée. Je suis restée un long moment à attendre dans le noir. J’peux pas dire combien de temps… Et puis je savais plus quoi faire… et alors il y a eu ces cris... J'ai d'abord pensé que c'étaient ceux de cette bande, enfin ceux qui étaient après moi... Quand vous êtes rentré, j'ai cru que j'allais m'évanouir !
- Comme moi quand vous m'avez braqué avec votre lampe. Au fait, vous m'auriez tiré dessus ?
- J'aurais pu si...
Elle sortit un petit revolver de la poche de son pantalon.
- C'est celui de Laurent, mon mari. Je l'ai pris avec moi pour me donner du courage mais je ne sais pas m'en servir. Vous voyez que je ne vous cache rien.
- Vous êtes mariée ?
- Je l'étais la semaine dernière. Maintenant, je ne sais plus. Mon mari est parti presque au début des... événements et je ne l'ai plus revu. Il a disparu. Comme des milliers d'autres gens, j'imagine.
Elle haussa les épaules et parut se perdre dans ses pensées. Larcher la laissa à ses réflexions un petit moment puis, terminant d'un coup sa Vodka, il se leva et lui demanda :
- Vous n'avez pas faim ?
Elle le regarda en souriant et se leva à son tour.
- Qu'est-ce que vous avez à manger ?
Elle le suivit dans la cuisine. Le réfrigérateur était une infection mais, en fouillant dans le placard, il réussit à trouver un paquet de spaghettis et une boite de sauce tomate, des gâteaux secs, de la confiture. Il versa de l'eau dans une casserole. Elle le regardait faire avec curiosité.
- Vous avez encore de l'eau ? remarqua-t-elle. Vous savez que vous avez de la chance. C'est coupé chez moi depuis deux jours...
A la fin du repas, elle lui demanda des cigarettes. Il finit par retrouver un vieux paquet de Camel sur lequel elle se jeta avec avidité. La soirée, la première acceptable depuis une semaine pour Larcher, passa à la vitesse de l'éclair. A présent, comme des amis de longue date, ils pouvaient échanger leurs impressions, leurs interrogations et se transmettre leurs peurs de l'avenir incertain. Larcher ne sut pas vraiment qui le premier tutoya l'autre. Il avait l'impression de la connaître depuis toujours et cela lui fit comprendre combien il avait souffert de sa solitude, combien lui avait manqué la possibilité de pouvoir partager son incertitude. Elle lui parla de ses propres inquiétudes : elle se faisait un sang d’encre – c’était son expression – pour ses parents et sa sœur restés à Saint Etienne d’où elle était originaire. Larcher qui, avec la disparition de sa femme, n’avait plus aucun proche, comprenait toute l’angoisse à laquelle il avait échappé. Il essaya de la réconforter par les paroles ordinaires que l’on pense être obligé de produire en pareil cas mais il n’y croyait vraiment pas et son malaise devait certainement être perceptible. Ce fut elle qui vint à son secours en changeant le sujet de leur conversation. Ils avaient allumé un maximum de bougies qui produisaient une lumière qui parut à Larcher presqu’aussi intense que celle de l’électricité dont ils apprenaient à se défaire. En début de soirée, il avait parlé de la raccompagner chez elle mais elle accepta immédiatement quand il lui proposa la chambre d'amis. Elle exigea de venir avec lui garer le 4X4 dans le box du sous-sol. Quand il lui souhaita bonne nuit, elle lui tendit la joue tout naturellement. Avant de s'endormir, épuisé, il se félicita de cette rencontre, première lueur de réconfort dans le marasme de sa vie nouvelle. Il n'était plus seul.
suite ICI
Tous droits réservés
copyright 943R3EB
 votre commentaire
votre commentaire
-
Mardi 1er avril
Larcher avait passé une grande partie de la nuit dans des cauchemars atroces, à lutter contre des dizaines de Jude qui voulaient l'assassiner de mille façons différentes. Coralie ne faisait partie de ses rêves que sous la forme d'une présence floue, quelque part auprès de lui, qu'il n'arrivait pas à saisir. La seule fois où il avait réussi à l'approcher, à lui parler, il s'était aperçu qu'il s'agissait en réalité d'Élisabeth et une vague de nostalgie l'avait alors réveillé. Malgré tout, il se sentit reposé le lendemain matin quand il se leva. Il hésita à ouvrir les volets de la chambre par peur que ce geste, par sa répétition, ne finisse par attirer l'attention. Il s'immobilisa un instant pour bien marquer sa décision de ne pas oublier d'y réfléchir plus tard puis il enfila rapidement ses vêtements et sortit de la pièce. La jeune femme était déjà levée et s'était installée dans la cuisine. Elle lisait l'exemplaire chiffonné du Figaro qu'elle annotait avec un petit crayon doré. Elle lui fit un large sourire.
- Bonjour, Julien, bien dormi ?
- Plus ou moins et vous ?
- On se tutoyait pas, hier soir ? répondit-elle en continuant de sourire.
- Hmm, oui, c'est vrai.. Je ne sais pas pourquoi je... Excuse-moi. Alors, toi, t'as bien dormi ?
- Peu mais assez bien en définitive, merci.
Larcher s'empara d'une chaise et s'installa face à elle tandis qu'elle jouait pensivement avec le petit stylo. Elle releva les yeux et le regarda plonger la main dans le paquet de cookies.
- Dis-moi, Julien. Tu es toujours d'accord pour qu'on continue, enfin... pour qu'on essaie de faire un bout de chemin ensemble, comme on avait dit hier soir ? Je veux dire...
Il hocha la tête, le visage sérieux.
- Tout à fait. Tout à fait ! Si tu me fais confiance ! Si on se fait confiance... Je crois qu'à nous deux, on a bien plus de chances de s'en sortir. Ce serait vraiment con de pas essayer. Je sais que ça va être dur mais à deux je suis sûr qu'on y arrivera. On arrivera à sortir de toute cette pourriture. C'est le seul moyen. Et puis, on rencontrera sûrement d'autres gens comme nous. Y a pas de raison. Tu crois pas ?
Elle acquiesça en silence puis se redressant soudain :
- Heu, je suis désolée mais, comme tu sais, y a pas de café. Rien que du coca. A ce propos, justement... Tu vois, poursuivit-elle en sortant une feuille de papier de dessous le journal, j'ai fait une liste de ce qui me paraît indispensable si on veut pas crever de faim.
Larcher s'empara de la feuille et la parcourut rapidement.
- C'est à peu près ce que j'avais trouvé au magasin de la rue de Vaugirard quand les autres salauds m'ont intercepté, remarqua-t-il. Mais il faudrait ajouter deux-trois trucs auxquels j'ai pensé depuis, comme d'autres lampes, un réchaud à gaz - mais ça, je vois que tu l'as déjà marqué - ou des piles, des accumulateurs, des batteries, enfin des tas de trucs comme ça pour faire remarcher les petits appareils électriques. Ca doit être possible, non ?
Coralie avait repris le papier et le complétait au fur et à mesure tandis que Larcher grignotait ses gâteaux secs. La bouche pleine, il reprit :
- Je vois que t'as remis tes vêtements. T'as rien trouvé dans l'armoire d'Elisabeth ? Vous avez à peu près la même taille, non ?
- Si, deux ou trois trucs. Mais, en plus du fait que je préfère mettre mes affaires - à ce propos, il faut qu'on passe chez moi - je suis sale comme un peigne. Je vais d'ailleurs prendre la salle de bains si tu es d'accord. Quelque chose me dit qu'il faut profiter de ce que l'eau n'est pas encore coupée chez toi. Evidemment, se débarbouiller à l'eau froide n'est pas des plus réjouissants mais je peux t'assurer que c'est drôlement mieux que rien. Bon, j'y vais. Après on dresse notre plan de bataille, d’accord ?
Il la regarda partir et étira voluptueusement ses bras. Ils avaient du pain sur la planche et plutôt intérêt à bien choisir leurs interventions diverses, se dit-il. Il reprit à nouveau la liste et y rajoutait un récepteur à ondes courtes qui pourrait peut-être les aider à en savoir un peu plus sur l'état du reste du monde quand elle l'appela d'une voix étrangement contractée.
- Julien, viens voir.
Elle regardait par la fenêtre de la chambre d'amis qui donnait sur l'autre extrémité de la rue Duranton. Il s'approcha d'elle et regarda à son tour. A l'angle de la rue, environ deux cents mètres plus bas, un char manœuvrait. Le blindé semblait hésiter comme s'il cherchait à repérer quelque chose. Il s'arrêta en plein milieu de la chaussée, sa tourelle tournant dans un sens puis dans l'autre. A présent qu'il faisait attention, Larcher pouvait entendre, assourdis, le rugissement des puissants moteurs. Soudain, comme pris d'une inspiration subite, l'énorme véhicule recula brutalement, bousculant plusieurs voitures et écrasant un petit arbre, et s'élança à 180 degrés. Il disparut dans un panache de fumée bleue.
- Je me demande bien ce qu'ils cherchent, murmura Coralie.
- Je ne sais pas, lui répondit Larcher, mais tout ça n'est pas très engageant. On va avoir intérêt à faire gaffe avec le 4X4 parce que ces connards sont capables de nous allumer sans sommation.
- Tu crois ? Pourquoi nous ? Ils peuvent pas tirer sur tout ce qui bouge, non ?
- Mais les Gardes Mobiles, l'autre jour. Ceux que j'ai vu au carrefour en haut...
- Tu m'as dit qu'ils avaient tiré sur des pillards, non ?
- Et qu'est-ce qu'on va faire quand on ira se ravitailler ?
Elle ne répondit pas, fixant toujours l'endroit où le char avait disparu. Il la prit par les épaules et la serra contre lui. Il se rendit compte que c'était la première fois depuis des jours qu'il touchait un autre être humain et il en fut très ému.
- Allez, pas de découragement. Il n'y en a sûrement pas des milliers et puis, merde, on doit les entendre venir... De toute façon, on n'a pas le choix. On fera très attention, c'est tout. Mais, ça me conforte dans ce que je crois.
- C'est-à-dire ?
- Qu'il nous faudra assez rapidement quitter Paris. Peut-être plus vite que prévu. D'autant qu'avec tous ces morts, il va sûrement y avoir des épidémies. Et puis, cette racaille...
Elle s'écarta doucement de lui. Arrivée à la porte, elle se retourna.
- Julien, je crois que tu as raison. Faut pas s'éterniser ici, souffla-t-elle.
Larcher était repassé par l'armurerie pour y remplacer son fusil perdu. Il avait forcé Coralie à prendre, malgré sa réticence, un pistolet automatique dont il lui avait longuement expliqué le fonctionnement sans être tout à fait sûr qu'elle puisse s'en servir le cas échéant. Il n'avait pas voulu retourner dans le Monoprix, plus par superstition que par crainte véritable de s'y heurter à Jude qui devait de toute façon zoner dans les environs et qu'ils pouvaient rencontrer à n'importe quel coin de rue. Ils avaient repéré une supérette du côté de l'avenue Félix Faure et, après avoir garé leur véhicule à proximité, ils passèrent plus d'une heure à surveiller les environs, à moitié enfoncés dans leurs sièges, n'échangeant que de rares paroles. En fait, ces précautions auxquelles ils s'astreignaient étaient certainement illusoires. Qui pouvait garantir qu'on ne les guettait pas depuis un quelconque recoin, qu'une bande de Viraux n'attendait pas qu'ils se risquent à découvert pour leur fondre dessus ou même qu'un tireur embusqué ne les prenne subitement pour cible, pour rien, pour le simple plaisir de se défouler, dans cette ville livrée à l'arbitraire et aux prédateurs ? Mais leur prudence relative les rassurait. A bien observer, pourtant, dans ces rues abandonnées, une certaine vie continuait à se manifester. Une bande de chiens qui passaient en reniflant nonchalamment les arbres, des pigeons qui picoraient on se demandait bien quoi, des bruits de moteur à quelques rues de là, deux ou trois silhouettes apeurées dont ils n'aperçurent que les mouvements furtifs, les reflets à peine ébauchés, pauvres vies errantes vraisemblablement encore plus craintives qu'eux-mêmes, témoignaient du fait que la ville n'était pas encore tout à fait morte. A un moment, stupéfaits, ils aperçurent une femme tout en rouge qui descendait lentement l'avenue à bicyclette en tenant d'une main une grande ombrelle pour se protéger du soleil intermittent. Brusquement, la femme se mit à pédaler avec frénésie et disparut dans une rue adjacente. Une Virale, sans doute, murmura Coralie, elle n'ira pas loin. Larcher, enfin, se décida à approcher la voiture, moteur à bas régime, devant la porte béante de la supérette. Laissant l'engin tourner au ralenti, il descendit prudemment tandis que sa compagne s'installait au volant. Il entra lentement dans le magasin, méfiant. Malgré les prélèvements importants de ceux qui étaient passé avant eux, il réussit à trouver suffisamment de marchandises diverses pour remplir le Range-Rover à ras-bord. Larcher n'était pas étonné de voir que tant de monde semblait être venu se servir dans le petit établissement alors qu'il ne voyait - et c'était tant mieux - presque jamais personne dans les rues. Il poussa un soupir de soulagement quand la jeune femme relança le 4X4.
L'appartement de la rue Duranton ressemblait à présent à une boutique de receleur avec ses multiples caisses, boites, paquets et bouteilles, empilés en vrac dans l'attente de l'inventaire qu'ils s'étaient promis de faire. Et c'était d'ailleurs bien ce qu'il était, l'appartement, un véritable entrepôt de marchandises, remarqua Coralie, presque étonnée. S'ils avaient décidé de quitter la ville, ils n'avaient pas encore choisi le moment exact de leur départ. En revanche, leur destination était connue : la résidence secondaire de la jeune femme située à une centaine de kilomètres à l'est de Paris, où ils espéraient bien échapper aux miasmes mortels de la grande cité. Par peur d'avoir été repérés, rendus presque paranoïaques par l'environnement hostile, ils avaient décidé de transférer toutes leurs acquisitions dans l'appartement. Comme ça, si quelqu'un vient voler ou vandaliser le 4X4 dans son box, on n'aura pas tout perdu, avait conclu Larcher. Il le regretta presque par la suite tant le transfert de tous les objets au long des cinq étages l'avait épuisé. Il ne pouvait plus souffrir ces couloirs sinistres et, s'ils ne s'étaient pas décidés à partir, il aurait probablement proposé d'émigrer pour un logement moins haut situé, il y en avait sûrement des milliers de vacants à présent.
- J'ai peur, Julien, tu sais, je suis morte de trouille.
Larcher regarda la jeune femme qui s'était assise en face de lui sur le canapé du salon, les jambes repliées sous elle, une boite de tonic à la main.
- Ecoute, lui répondit-il, je sais que ce n'est pas parfait mais la porte d'entrée est blindée. Impossible d'entrer sans qu'on s'en aperçoive. D'ailleurs, depuis le début, je n'ai pas entendu une seule personne dans cet immeuble. En tous cas, à cet étage.
- Ce n'est pas ce que je veux dire, reprit-elle en le regardant droit dans les yeux. Ce qui me fait peur, c'est ce qui pourrait nous arriver, ce qui pourrait m'arriver. J'ai peur de tomber malade comme les autres. Peut-être sans m'en rendre compte. Ou en m'en fichant ce qui est encore pire. Tu les a vus, ces pauvres gens, ils ne savent même plus ce qu'ils font, ni qui ils sont. Ils se battent entre eux comme des bêtes. Ils n'ont plus rien d'humain. A la radio, enfin quand elle marchait encore, ils disaient qu'il y en a qui se suicident ou qui meurent par accident simplement parce qu'ils ne se rendent plus compte du danger, parce qu'ils sont en dehors de la réalité. Il y en a d'autres qui attaquent tout ce qui bouge... Pourquoi ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ?
En l'écoutant, Larcher se rendait compte qu'ils n'avaient jamais vraiment évoqué entre eux ces angoisses qui les taraudaient. Ils s'étaient lancés dans des actions de survie, des actions immédiates, évidemment indispensables, comme si cela avait été un moyen d'ignorer cette menace qui les entourait, comme si le quotidien permettait d'oublier la grande peur, leur fragilité, leur impuissance. Mais comment faire autrement pour accepter ce qui n'était peut-être qu'une parenthèse, un sursis ?
- Je ne sais pas, murmura-t-il. D'après ce qui a été dit, ce serait un nouveau virus, une mutation ou je ne sais quoi. Un truc qui attaque les neurones, les cellules nerveuses du cerveau. De l'homme, car les animaux semblent épargnés et...
- Je sais, je sais. Dans le journal, ils parlent d'un virus qui modifie les hormones du cerveau, qui rend les gens comme fous. Mais en disant ça, on n'a rien dit. Absolument rien. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi maintenant, pourquoi si brutalement ? Comment ça a pu arriver si vite ? Si vite qu'on a même pas eu le temps de s'organiser. Tout s'est effondré si rapidement, comme un château de cartes. Une civilisation entière ! Faut croire quand même que tout ça n'était pas si solide. Et ceux qui restent ne sont même pas sûrs... Tu comprends, dans une grande catastrophe, un tremblement de terre, la guerre, ceux qui survivent savent au moins qu'ils s'en sont sortis, qu'ils peuvent peut-être recommencer. Mais pas nous, pas nous, c'est ça qui me désespère !
- Allons, Coralie, pas de déprime. Le pire n'est jamais sûr, voyons. Tu sais qu'on dit aussi dans le journal qu'il y a peut-être des gens qui sont immunisés d'emblée à ce truc et que...
- Qu'est-ce qu'ils en savent, merde !
- Il y a quand même le fait que, toi et moi, depuis une semaine que nous sommes dans cette ville... Et que nous nous promenons sans précautions particulières...
- Mais sans rencontrer de Viraux. De près, je veux dire.
- Faux pour moi. Jude et les autres, je les ai vus de près et je peux te certifier que c'étaient bien des dingues ! Quoique… À y bien réfléchir… Je me demande si c’est vraiment des malades ou… de la simple racaille…
Coralie avala une longue gorgée de tonic, regarda autour d'elle puis revint à Larcher.
- Tu es croyant, Julien ?
- Heu, ça dépend mais, heu, oui, je crois qu'on peut dire que je suis croyant.
- Eh bien pas moi. Et c'est pas maintenant que... Mais si j'étais croyante, je veux dire, si je pensais qu'il y a une explication, une volonté, un but, quoi, je serais persuadée qu'il s'agit d'une espèce de vengeance divine, d'une malédiction. La main de Dieu sur ses ouailles. Et après un avertissement déjà car le SIDA, c'était bien aussi un virus, non ? Mais je crois pas à toutes ces foutaises. Je suis trop rationnelle, tu vois. Pour moi, tout ça, c'est un hasard malheureux, un accident de la nature. Et c'est bien de penser ça qui me désespère. De penser qu'avec un peu de chance rien n'aurait pu se produire. Au lieu de ça, toute une civilisation qui disparaît, ces siècles d'efforts, de luttes, de guerres, tous ces morts, pour rien. Rien. On va laisser nos monuments à des animaux qui ne les verront même pas... Quelle connerie, quel gâchis...
Elle s'était mise à pleurer silencieusement. Larcher se leva, s'assit à côté d'elle, la prit dans ses bras. La douleur de la jeune femme, sa propre angoisse, l'étranglaient. Il aurait voulu la consoler, trouver des mots, des phrases mais il ne pouvait que la serrer contre lui en la berçant et en lui caressant lentement les cheveux. Finalement, il réussit à lui parler doucement, comme à un enfant triste qu'on veut rassurer malgré la réalité qui blesse. Au delà de ses phrases incertaines, ce fut sa voix, sa présence qui arrivèrent à la calmer. Ils restèrent un long moment l'un contre l'autre sans prononcer une parole. Puis Coralie le repoussa gentiment et se leva d'un coup.
- Ca va mieux. Un coup de fatigue sans doute. Je vais aller me coucher, Julien, je suis vannée.
Il la rejoignit quand elle se fut enfoncée dans son lit. A la lueur tremblotante de la bougie, ses cheveux ressemblaient à une tâche de nuit sur l'oreiller et donnaient à son visage une allure de toute petite fille.
- Ça va ? chuchota-t-il.
- Ça va.
Il se pencha pour lui embrasser le front mais, comme il se relevait, elle arrêta son mouvement de la main.
- Julien, j'aimerais que tu dormes avec moi, cette nuit.
Comme il ne répondait pas, elle murmura en souriant.
- Si tu le veux bien, évidemment.
suite ICI
Tous droits réservés
copyright 943R3EB
 votre commentaire
votre commentaire
-
Jeudi 3 avril
Le jour se levait à peine. Un jour gris et terne, en plein accord avec ce monde délabré. Un vent froid faisait tourbillonner les dizaines de papiers et vieux journaux qui jonchaient le sol. Larcher conduisait lentement, prenant le temps de vérifier chaque obstacle avant de le contourner, prêt à faire marche arrière à la moindre alerte. Ils devaient traverser presque tout Paris pour se rendre porte de Bagnolet d'où ils espéraient quitter la ville après une étape rapide à l'appartement de la jeune femme. Elle désirait absolument emporter avec elle certains vêtements et probablement aussi quelques souvenirs, avait pensé Larcher. Ce dernier, après une soirée passée avec elle à compulser de multiples cartes routières, avait peu dormi, refaisant continuellement des itinéraires, cherchant à anticiper les problèmes qu'ils risquaient de rencontrer et surtout les réactions appropriées à y apporter. A présent qu'il se retrouvait dans l'action, il se sentait plus calme, soulagé. Il engagea la voiture dans la rue de la Convention, en direction de la place Victor Basch, plein est, bien décidé, si cela était possible, à suivre cet axe qui devait les amener là où ils le voulaient. Il caressa de sa main droite la coupure de son menton qui ne saignait plus. Malgré la répulsion qu'avait fini par lui inspirer sa salle de bains si pauvrement éclairée par une bougie puis par une lampe à gaz guère plus efficace, il avait tenu à se raser tous les jours, un peu à la manière de ces Anglais qui, oubliés sur une île déserte, mettent un point d'honneur à passer leurs smokings pour dîner, solitaires, sous les étoiles. Il se tourna vers sa compagne.
- Dis-moi, Coralie, est-ce que ta salle de bains de Ste Hippolyte est éclairée par le jour ? Parce que j'en ai ma claque de me couper tous les jours en me rasant...
Plongée dans son plan de Paris, elle ne lui répondit pas immédiatement.
- Hein ? Heu, oui. Tu verras, il y a plein de...
S'interrompant, elle lui saisit le bras.
- Je sais, j'ai vu, siffla-t-il entre ses dents.
Plantée en plein milieu de la rue d'Alésia qu'ils venaient d'emprunter, une femme les regardait venir, immobile, deux enfants à ses côtés. Larcher ralentit le 4X4 et chercha à les éviter par un lent mouvement tournant mais quand ils arrivèrent à leur hauteur, la femme vint à leur rencontre et frappa du plat de la main sur la vitre de Coralie qui, inconsciemment, se courba. La femme répétait toujours les mêmes mots : " Aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi ". Les yeux fixés sur la chaussée, Larcher accéléra. Quand elle comprit qu'ils ne s'arrêteraient pas, la femme poussa un véritable cri de désespoir et se lança après la voiture en martelant de ses poings le hayon arrière. Les enfants couraient après elle en pleurant. Distancée, elle s'immobilisa et se laissa tomber à même le sol. Larcher vit leurs silhouettes diminuer dans son rétroviseur. Leur voiture arrivait rue d'Alésia. Les véhicules de tous genres abandonnés un peu partout devenaient plus nombreux. Il se concentra sur sa conduite. Deux cadavres décomposés gisaient en travers du trottoir et il accéléra pour leur échapper. Coralie ne semblait pas les avoir vus bien qu'elle ne soit pas retournée à son plan. Sans le regarder, elle murmura :
- On pouvait pas les prendre. On pouvait pas. On pouvait pas.
- Je sais.
- On pouvait pas. C'était peut-être une Virale. Et puis, qu'est-ce qu'on aurait fait d'eux ? Les enfants... On peut rien faire. Rien d'autre que foutre le camp de toute cette misère.
Ils eurent du mal à franchir la place Victor Basch. Des carcasses de voitures brûlées, des caisses, des valises aux contenus éparpillés, des cadavres encore, des dizaines de cadavres de tous âges, témoignaient qu'à cet endroit des luttes féroces avaient opposé pour des motifs que l'on ne connaîtrait jamais toute une population en proie à une panique incoercible. Larcher dut faire preuve de beaucoup d'habileté pour franchir ces tristes épaves. Pour reprendre pied rue d'Alésia, de l'autre côté du carrefour, il fut obligé de faire monter le 4X4 sur le trottoir et de pousser avec son pare-choc une camionnette couchée en travers. Le moteur du puissant véhicule rugissait sous l'effort tandis que la camionnette s'écartait progressivement dans un sinistre raclement de tôle. Alors que la route était presque dégagée, une ombre soudain jaillit devant leur pare-brise, leur glaçant le sang, mais ce n'était qu'un chat qui détala en miaulant.
Le franchissement de l'avenue d'Italie leur posa moins de problèmes qu'ils auraient pu le craindre mais ce fut un peu plus loin qu'ils se heurtèrent à leur première difficulté réelle. Après quelques centaines de mètres, la rue de Tolbiac était barrée d'un côté à l'autre par une barricade faite de carcasses de voitures et d'objets disparates que, à moins d'avoir disposé d'un véhicule blindé, il était hors de question de franchir. Larcher arrêta la Range, passa au point mort et s'exclama :
- Bon, ben y a pas à tortiller, faut faire demi-tour et trouver un autre chemin. Il commençait la manœuvre quand Coralie hurla :
- Julien, regarde !
De la barricade, quelques silhouettes avaient émergé et s'était mises à courir vers eux. Mais ce n'était pas ce que lui désignait la jeune femme, il s'en rendit compte presque instantanément. Elle montrait du doigt un groupe d'hommes qui arrivait de l'autre côté, depuis l'avenue d'Italie. Il termina le cœur battant son demi-tour, marqua un temps d'arrêt puis, emballant le moteur, il hurla :
- Accroche-toi !
Le 4X4prit de la vitesse. En la voyant s'approcher, les individus s'écartèrent lentement, comme à contrecœur, à l'exception d'un seul, un grand barbu vêtu de cuir, aux longs cheveux noirs lui coulant sur les épaules, qui les attendait, bien campé sur ses deux jambes et serrant à deux mains un lourd piquet de métal. A deux mètres de la voiture, le barbu leva sa masse mais il n'eut pas le temps de l'abattre. La voiture le heurta avec une violence inouïe, le projetant sur le pare-brise qu'il étoila. Il bascula par dessus le toit dans une traînée de sang qui gicla sur la vitre de Coralie. La jeune femme put voir le corps désarticulé qui rebondissait comme un pantin sur la chaussée, le bruit mou de sa chute arrivant à couvrir le vrombissement du moteur. La dernière vision qu'elle eut de lui, ce fut son corps aplati dans une flaque de sang, la tête bizarrement tordue à quatre-vingt dix degrés. Les autres se mirent à les bombarder de projectiles divers mais leur auto était solide et seul les atteignit le bruit des objets s'écrasant sur la carrosserie. Ils entendirent peu après plusieurs détonations et deux fois l'impact de balles dans la tôle de leur voiture avant d'être hors de portée. Larcher repassa par le chemin qu'ils venaient d'emprunter, envoyant dinguer au passage les restes d'une moto. Il engagea sans attendre le 4X4 sur l'avenue d'Italie et ne se mit à ralentir qu'après plusieurs centaines de mètres. Personne ne les avait suivis. Coralie, pâle comme une morte, n'arrivait pas à trouver ses mots.
- Mais... T'as vu ? C'était quoi, ces types ? Des Viraux ? Des loubards ?
- Sais pas. Peut-être les deux...
- Merde, j'ai eu une de ces frousses. Tu vois pas si la voiture avait calé ?
- Ce genre de voiture, c'est rare.
- Ou s'ils avaient atteint les pneus ?
- L'essentiel c'est qu'on ait pu se tirer.
Il se disait que cela aurait été bien pire si les Viraux leur avaient jeté des cocktails Molotov mais il ne fit pas part de sa réflexion à sa compagne.
Ils firent un grand détour par le sud et se retrouvèrent sur les boulevards extérieurs qu'ils décidèrent de suivre jusqu'à la Seine. Larcher pensait que si la panique avait bien été ce qu'il imaginait, ces boulevards qui relient intérieurement les sorties de Paris seraient difficilement praticables d'où le choix de son premier itinéraire. Et de fait, un embouteillage monstre avait jonché d'automobiles enchevêtrées toute cette partie de la ville. Toutefois, les trottoirs étaient larges et relativement dégagés. En les empruntant de manière quasi-continue, il était possible d'avancer quand même. Le seul point noir demeurait les arrivées des grandes avenues venant du centre et ils durent déployer des trésors d'ingéniosité pour passer. Ils échangèrent plusieurs fois le volant tant la tension de la conduite était éprouvante à serpenter au milieu de toutes ces carcasses inertes. Ils n'hésitaient plus à se servir du Range comme d'un bulldozer, écartant parfois avec violence les épaves qui se présentaient devant eux. Larcher se surprit même à éprouver une sorte d'excitation à pousser avec son puissant véhicule les innombrables voitures dont certaines cédaient avec des craquements sinistres de verre brisé et de tôles froissées. Il commençait à s'habituer à cet univers d'acier immobile, à cette gigantesque partie de stock-cars. Le plus difficile, au début, avait été de croiser les quelques cadavres, heureusement peu nombreux, qui parsemaient parfois la chaussée. Il arrivait à présent à les regarder sans les voir, presque blasé, se contentant de détourner les yeux sans trop y penser. Ces images devaient quand même inconsciemment le marquer puisque certaines d'entre elles allaient revenir plus tard peupler ses cauchemars.
Quand elle ne conduisait pas, Coralie se tenait arcboutée de la main droite à son accoudoir, l'autre main crispée sur son revolver, fouillant des yeux les alentours à la recherche du moindre mouvement mais, en dehors d'eux, l'environnement était quasi-minéral. Ils auraient pu se croire les derniers vivants dans cette partie du monde. Dès qu'ils arrivèrent boulevard Masséna en direction du pont National, Larcher su qu'à moins d'efforts démesurés ils n'arriveraient pas à franchir le conglomérat métallique dont le serpent démentiel devait s'étendre jusqu'à l'entrée de l'autoroute de l'est à quelques kilomètres de là. Ils décidèrent donc de remonter vers le centre pour franchir la Seine au pont de Tolbiac un peu plus haut. A contre courant du flux immobile, ils se frayèrent un passage sur le quai de la Gare. Au fur et à mesure qu'ils s'éloignaient de la périphérie, la route devenait plus praticable. Larcher qui n'avait pas desserré les dents depuis un long moment se détendit progressivement.
- Eh bien, je crois qu'on a quand même fait le plus gros, lança-t-il à la jeune femme. Enfin, pour le moment parce que porte de Bagnolet, tout à l'heure, j'ai bien peur... Mais, chaque chose en son temps. Tu veux bien reprendre le volant parce que je suppose que tu connais mieux ce quartier que moi maintenant ?
Ils échangèrent leurs places une fois de plus. La rue de Wattignies était quasiment déserte et Coralie, poussant un long soupir de soulagement, gara la voiture devant un grand immeuble moderne dont la blancheur éblouissait les yeux sous les rayons du soleil réapparu comme pour des retrouvailles. Elle se retourna vers Larcher.
- C'est là. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu viens avec moi ou tu préfères garder la bagnole ? Note bien que j'en ai pas pour très longtemps : j'empile quelques trucs dans une valise et c'est tout.
- Le mieux, je crois, c'est que je reste dans l'entrée. Tu m'as bien dit que c'était au premier, non ? Alors, comme ça, je surveille la voiture mais tu m'appelles s'il y a quoi que ce soit. Avant de repartir, on nettoiera un peu, ajouta-t-il en désignant d'un signe de tête la traînée de sang coagulé qui maculait la vitre avant-droite de la voiture.
Au moment de pousser la porte qui donnait sur l'escalier, Coralie se retourna vers Larcher qui la regardait partir, appuyé contre la porte d'entrée de l'immeuble, et lui fit un petit signe de la main. Sans un regard pour l’ascenseur qui lui faisait face, immobile à jamais, elle monta rapidement les quelques marches et arriva sur le palier du premier étage. Elle fronça le nez en raison de la vague odeur de moisi qui y flottait. Une odeur de mort, pensa-t-elle en frissonnant. Elle introduisit ses clés dans sa porte d'entrée qui n'avait pas été forcée ce qui la réconforta un peu. Bien qu'elle fut sur le point de quitter sans doute définitivement l'endroit où elle avait vécu tant d'années, elle était soulagée de ne pas le retrouver vandalisé, de ne pas découvrir ses affaires dispersées ou volées. L'appartement était exactement dans l'état où elle l'avait laissé quatre jours plus tôt. Son regard erra lentement sur tous ces objets qu'elle avait choisis avec tant de soin, dans un temps qui lui parut infiniment lointain. Son sac à main était toujours en équilibre instable sur la table basse du living, dans la position précise où elle l'avait abandonné quand elle avait jugé qu'il serait certainement une gêne pour son expédition qui avait failli si mal tourner. Une fois de plus, elle repensa à son mari, se demanda ce qui avait bien pu lui arriver. A présent qu'elle quittait Paris, elle savait qu'elle ne le reverrait jamais. Elle secoua la tête et se précipita vers le placard aux valises, en choisit une de taille moyenne où elle empila quelques vêtements, plus pour leur aspect utilitaire que parce qu'elle les aimait vraiment, des sous-vêtements, des chaussures souples, son nécessaire de toilette, un flacon de parfum. Elle compléta avec deux ou trois photos, quelques lettres, sa réserve de contraceptifs oraux et, pour finir, ses papiers personnels qu'elle extirpa de son sac à main. La valise se referma avec un claquement sec. Elle y jeta en travers sa veste de fourrure à laquelle elle tenait tout particulièrement, seule entorse à ce qu'elle s'était promis d'emporter avec les bijoux qu'elle enfourna dans la poche intérieure de la grosse veste de laine que lui avait prêtée Larcher. Voilà, ici c'est fini, murmura-t-elle en contemplant une dernière fois l'appartement où elle n'avait pas été en définitive si malheureuse. Elle claqua la porte derrière elle, prit le temps, force de l'habitude, de donner un tour de clés puis balaya le couloir de sa lampe électrique. Elle poussa un cri étouffé en découvrant la silhouette d'un homme appuyé contre le mur, à deux mètres d'elle. Elle n'eut pas le temps d'appeler Larcher. Déjà, l'homme se jetait sur elle et lui bâillonnait la bouche avec sa main. En se débattant, folle de terreur, elle pouvait voir le faisceau de sa lampe projeté au hasard sur les murs et une silhouette se lever de devant la porte de l'appartement voisin. Le deuxième homme s'approcha lentement tandis que le premier arrivait, malgré ses coups de pied désordonnés, à l'immobiliser complètement. Haletante, elle abandonna sa lutte silencieuse. Elle se sentait épuisée et totalement abattue. Elle entendit l'homme qui la maintenait fermement par derrière lui murmurer :
- Là, là, c'est tout, ma belle. Faut être sage maintenant. Tu me comprends bien, hein ? Bon, alors, voilà ce que tu vas faire. Tu vas donner gentiment tes clés à mon copain et on va aller discuter tranquillement dans ton appart. Allez, exécution.
Comme elle ne bougeait pas, paralysée par la terreur, l'homme lui arracha les clés qu'elle avait encore dans sa main gauche puis s'empara doucement de sa lampe toujours allumée. Il jeta les clés au deuxième homme avec un petit rire satisfait et murmura :
- Allez, Fredo, ouvre donc la porte puisque la dame nous invite si gentiment...
Au moment où le deuxième homme enfonçait les clés dans la serrure, la voix de Larcher claqua comme un coup de tonnerre dans le silence.
- Bougez plus et toi, tu la lâches.
Coralie sentit l'homme tout contre elle qui raffermissait sa prise dans un sursaut de surprise tandis que Fredo se retournait lentement vers l'escalier, un rasoir à la main. Après, tout se passa si vite que Coralie ne put jamais par la suite distinguer exactement la séquence des événements. La lampe s'éteignit et elle entendit un choc, des cris, des grognements, le bruit d'une lutte. Son tortionnaire cria :
- Fredo, fais-lui la peau à ce con. Moi, je tiens la nana.
En disant cela, l'homme relâcha imperceptiblement son étreinte et Coralie en profita pour lui mordre le plus profondément possible la main. L'homme poussa un rugissement de douleur et laissa échapper la jeune femme. Une demi-seconde plus tard, il rallumait la torche mais Coralie avait sorti son revolver, relevé la sécurité et sans viser appuyé sur la gâchette. La détonation produisit une explosion gigantesque. L'homme s'effondra en lâchant la lampe dont le faisceau éclaira une brève seconde son visage déchiqueté. Coralie ne pouvait plus s'empêcher de crier. Elle entendit une seconde détonation au moment où la lampe de poche de Larcher balayait en ombre chinoise le deuxième homme qui s'écroulait sans un bruit en laissant une grande tâche sombre sur le mur du couloir. Secouée de sanglots incontrôlables, Coralie se jeta dans les bras de Larcher qui lui embrassa fébrilement le visage et les cheveux en hurlant :
- Tu es blessée, réponds-moi, tu es blessée ?
Au bord de l'évanouissement, elle n'arrivait pas à parler. L'odeur de cordite était omniprésente. Il la fit asseoir à distance des deux corps, lui laissa quelques minutes pour se reprendre, en la serrant fermement contre lui. Malgré elle, qui s'accrochait désespérément, il se releva.
- Allez, viens ma douce, faut pas moisir ici.
Il la saisit par un bras, fit quelques pas avec elle, puis, sans cesser de l'éclairer, revint en arrière pour s'emparer de la valise et du manteau. Coralie sanglotait toujours, son revolver à la main. Il la conduisit sans un mot dans l'escalier. Dehors, le soleil les accueillit comme dans un autre univers. Jetant furtivement des regards autour d'eux, Larcher l'installa avec précaution dans la voiture, jetant la valise et le manteau au hasard vers l'arrière. Quand ils quittèrent la rue de Wattignies, il se tourna vers elle.
- Alors, ça va mieux ?
Elle haussa les épaules sans lui répondre. Le visage blême, elle fixait le tableau de bord, les yeux dans le vague, prunelles écarquillées. Elle secoua la tête, le regarda en souriant faiblement et posa sa main au dessus de la sienne, sur le levier de vitesses.
- Comment t'as su ? souffla-t-elle.
- Trop long. C'était trop long. Quand je suis arrivé en haut de l'escalier, j'ai entendu parler à voix basse alors...
- Je suis désolée. J'aurais dû...
- Pas de ta faute. Mais tu t'es bien défendue. On en parlera plus tard si tu veux. Maintenant, ce qu'il faut, c'est quitter ce bled pourri.
Elle se serra contre lui un bref instant, la tête contre son épaule, puis se redressa et s'empara du revolver qui gisait sur ses genoux.
Tous droits réservés
copyright 943R3EB
 votre commentaire
votre commentaire