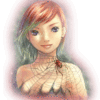-
On trouvera ci-après une table des matières permettant l'accès direct aux différents chapitres
(cliquer sur le titre du haut "viralité" pour retrouver l'accueil général)
(tous les textes sont protégés par copyright)
accueil
 6 commentaires
6 commentaires
-
VIRUS : plus petit micro-organisme vivant. Dépourvu de noyau, il est essentiellement composé de matériel génétique lui permettant de se reproduire au détriment des cellules plus évoluées qu'il infecte et détruit. Il est sujet à de fréquentes et imprévisibles mutations qui rendent son éradication difficile. Il en existe de multiples sous-groupes. Le virus de découverte la plus récente est le rétrovirus VIH du SIDA.
suite ICI
 1 commentaire
1 commentaire
-
Mardi 25 mars
L'homme s'avançait en titubant imperceptiblement comme s'il était très légèrement ivre puis il s'arrêta brutalement, pris d'une soudaine inspiration, et se mit à se parler à lui-même avec force hochements de tête. Un couple arrivait à sa hauteur et sans lever son regard il chercha d'un mouvement brusque à attraper la femme par la taille. Celle-ci fit un bond de côté et accéléra le pas tandis que son compagnon la tirait vers lui en haussant les épaules.
Assise à la terrasse du petit café, Annie s'était redressée, soudain intéressée, et se pencha vers son amie.
- Dis-donc, Pat, t'as vu le mec là-bas ? Il en tient une bonne, on dirait !
L'homme avait relevé les yeux et, s'apercevant de l'intérêt qu'il suscitait, se dirigea vers la terrasse mais sa marche était étrange. Il n'oscillait plus mais semblait danser à présent et il se mit bientôt à faire de grands mouvements des bras, regardant fixement les deux amies, avant de se diriger vers elles.
- Ben voilà, t'as gagné. Bravo, ma vieille, murmura Pat..
Les deux jeunes filles détournèrent leurs regards tandis que l'homme se plantait devant leur table. Il était grand et très maigre, avec un début de barbe qui, avec ses vêtements fripés, lui donnait un air négligé. Pourtant, il ne ressemblait pas à un clochard. Il apostropha les deux amies d'une voix tonitruante.
- Alors, mes minettes, comment qu'ça va ? Vous venez faire un petit tour avec moi ? Deux, c'est presque pas assez pour moi, v'savez ? Ou bien vous m'offrez une bière ? Allez, c'est moi qui invite. Ben quoi, vous répondez pas ? J'vous plais pas, p't être bien ?
Les jeunes filles avaient baissé les yeux et cherchaient à se faire les plus petites possible. Une dizaine de secondes s'écoula dans le silence relatif des discussions tout à coup assourdies, seulement troublé par la pétarade d'une mobylette de l'autre côté de l'avenue. Aux tables voisines, on observait la scène avec curiosité mais toutes les conversations cessèrent brutalement quand l'homme, d'un ample mouvement du bras droit, balaya les consommations des deux amies. Incrédules, les jeunes filles regardèrent verres et bouteilles exploser sur le trottoir dans un fracas qui leur parut énorme. Annie s'était à moitié levée mais déjà le serveur s'approchait et accrocha l'homme par le bras.
- Allez, mon vieux, dégage et sans histoire, hein. T'as du bol que je te demande pas de payer la casse !
- De quoi ? Qu'ek tu veux, toi ?
Le serveur chercha à écarter l'homme de la table mais celui-ci se tourna vers lui, un étrange sourire aux lèvres. Il sortit un objet de sa poche et, avant que quiconque ait pu réaliser, il porta sa main au cou du serveur qui recula vivement en émettant un borborygme étouffé tandis qu'un flot de sang s'échappait de sa carotide sectionnée et venait gicler sur sa chemise et son gilet. Il s'écroula en renversant une table, sous les hurlements des clients. L'homme, sans cesser de sourire, se retourna vers les deux amies pétrifiées, incapables de prononcer le moindre son.
- Z'avez vu ? Faut pas jouer au plus malin avec moi !
Puis, il se retourna, jeta un regard amusé sur le malheureux garçon qui agonisait entouré de quelques clients effarés et s'éloigna rapidement de sa démarche dansante. Avant de perdre connaissance, Pat entendit la voix suraiguë d'une femme qui criait : "Arrêtez-le, c'est un fou". Annie, terrorisée, restait immobile, tétanisée, incapable de s'empêcher de trembler de tous ses membres.
Quand Police-Secours arriva quelques minutes plus tard, le malheureux serveur était mort et on dut surtout s'occuper d'Annie, de Pat et des clients, tous épouvantablement choqués par cette scène insensée. L'homme fut rattrapé quelques minutes plus tard. Il ne cherchait apparemment pas à se cacher mais les policiers furent obligés de s'y mettre à quatre pour l'immobiliser tant sa fureur était intense.
Ce soir-là, quand Annie regagna son petit logement de banlieue, après ce qui lui avait paru être des heures de déposition au commissariat et des tentatives assez infructueuses pour tenter d'oublier au cinéma et dans les magasins la violence de l'après midi, elle se sentait dans un état d'esprit étrange. Elle avait par moments la curieuse impression de se dédoubler, qu'une partie d'elle-même flottait autour d'elle. Contrairement à ce qu'elle avait espéré, cette sensation ne s'estompa pas tandis que la soirée avançait. Elle mit sur le compte du choc terrible qu'elle venait de subir cet état inhabituel. Parmi les témoins du drame, beaucoup eurent cette même sensation.
Comme tous les soirs, le quartier de la Concorde était noir de monde. Des files ininterrompues de voitures s'enchevêtraient. Après le soleil du début d'après-midi, une petite pluie fine s'était mise à tomber sur la ville et ralentissait d'autant le trafic intense. Les rares agents de police présents paraissaient totalement débordés. On n'entendait que les vrombissements impuissants des moteurs, dominés de temps à autre par les hurlements tout aussi inefficaces des klaxons. Rue Saint Honoré, une grosse limousine noire cherchait à manœuvrer pour s'extirper du magma. Son conducteur avait réussi, en empiétant sur le trottoir, à se rapprocher à quelques dizaines de mètres d'un feu tricolore bien inutile. Au cours de sa manœuvre, il érafla le flanc d'une petite Fiat qui le précédait. Au lieu d'arrêter son véhicule, le conducteur de la limousine écrasa sa pédale d'accélération et projeta la petite voiture contre sa voisine, malgré les cris de la conductrice qui cherchait désespérément à ouvrir sa portière. Apercevant une partie de trottoir relativement dégagée, la limousine accéléra contre toute logique au moment précis où une jeune femme poussant une voiture d'enfant s'engageait. Malgré la vitesse réduite, le choc fut très violent. La jeune femme se trouva projetée contre la vitrine d'une boulangerie qu'elle heurta avec un claquement sec qui couvrit tous les autres bruits tandis que la limousine continuait sa route entraînant sous ses roues la voiture d'enfant qui ne contenait déjà plus qu'un corps sans vie. La limousine termina sa course folle contre un enchevêtrement de poubelles qu'elle éventra. Déjà sa portière s'ouvrait et le conducteur, un homme ventripotent d'une cinquantaine d'années, jaillissait du véhicule fumant et se mettait péniblement à courir droit devant lui, hurlant des imprécations incompréhensibles. Après un moment de flottement, un petit groupe de témoins de l'accident se lança à sa poursuite. L'homme avait une trentaine de mètres d'avance mais un cycliste qui avait vu le drame se dérouler pratiquement sous ses yeux lui expédia son vélo dans les jambes et l'homme s'écroula de tout son long. Il fut immédiatement rejoint par la meute. Quand les policiers arrivèrent quelques minutes plus tard, à pied en raison de l'embouteillage, ils ne trouvèrent qu'un cadavre méconnaissable, piétiné et désarticulé, étalé dans une mare de sang et de boue. Les principaux témoins avaient disparu. Le brigadier de police qui en avait pourtant vu d'autres, perplexe, fit la remarque à ses subordonnés que, dans sa longue carrière, il avait rarement été confronté à une telle sauvagerie.
Le jeune pompier se pencha par la fenêtre et, de la voix la plus persuasive qu'il trouva, interpella la jeune femme :
- Madame, allons, madame, soyez raisonnable. Tout ça ne sert à rien. Tout va s'arranger. Donnez-moi la main, madame, s'il vous plait...
La jeune femme tourna les yeux vers lui. Elle devait avoir une trentaine d'années, brune, mince, assez jolie. Elle fit une grimace bizarre au pompier et son regard revint à la cour, neuf étages plus bas, où de minuscules silhouettes se bousculaient au hasard, impuissantes. Sans regarder son interlocuteur, elle se mit à hurler :
- Non, rien à en foutre ! Marre de cette putain de vie !
Elle était très agitée, oscillant d'avant en arrière, presque en rupture d'équilibre, ses pieds menaçant à tout moment de glisser de l'étroit rebord où elle s'était réfugiée. Le pompier la héla à nouveau. On lui avait appris qu'en pareil cas il fallait parler, discuter avec les désespérés, dire n'importe quoi mais ne surtout jamais laisser s'installer cette fraction de silence qui leur permettait parfois de réunir le courage suffisant pour passer à l'acte.
- Madame, madame, écoutez-moi. Je suis là pour vous aider. Laissez-moi vous aider. Tendez-moi la main. On va discuter de vos problèmes. Je suis sûr qu'il y a moyen de vous aider. Faites-moi confiance, je vous en prie.
La jeune femme le regarda. Ses yeux étaient lumineux, brillant d'une lueur presque hallucinée. Elle prononçait à mi-voix des phrases que le pompier n'arrivait pas à saisir. Un mince filet de bave coulait de la commissure de ses lèvres. Elle voulait lui dire quelque chose mais n'arrivait pas à trouver ses mots. Elle se mit tout à coup à hurler, ses paroles bien distinctes dans le silence de la nuit tranquille.
- Je vous reconnais. Vous êtes le général de l'autre jour ! Laissez-moi tranquille, vous ne m'aurez pas vivante.
Son regard ne quittait plus son interlocuteur mais elle ne semblait pas vouloir sauter.
- Madame, voyons, vous faites erreur. Je ne suis pas ce que vous dites. Absolument pas. Je suis là pour vous aider, seulement pour vous aider...
Au bout de quelques secondes, elle hocha la tête, comme si elle se rendait compte de son erreur. Elle était toujours fébrile, anxieuse, et tremblait de tout son être mais ses mouvements étaient moins incontrôlés, moins saccadés. Le pompier continua à lui parler à voix basse, calme en apparence malgré la peur qui l'étreignait. Peu à peu, la jeune femme parut se détendre. Après plusieurs minutes d'hésitation bien perceptible, elle entreprit de se rapprocher de la fenêtre, glissant ses pieds millimètre par millimètre, attentive à ne pas trébucher, à ne pas déraper sur la pierre rendue glissante par la pluie de l'après-midi. Dans la petite pièce, derrière le pompier, chacun retenait son souffle. L'affaire paraissait en bonne voie mais chacun sentait bien qu'il aurait suffi d'un geste maladroit, d'un bruit inhabituel, pour que le drame éclate. Le sauveteur se pencha encore plus, frôla à plusieurs reprises la main glacée. Enfin la jeune femme saisit la main secourable, assura sa prise puis, dans un grand cri, elle sauta. Le pompier ne dût son salut qu'à son involontaire mouvement de recul et aux prises solides de ceux qui le retenaient. Sans y croire, il vit le corps de la femme tournoyer, comme dans un film au ralenti, avant de s'écraser avec un bruit mat sur le sol de la cour. Tout le monde se précipita à la fenêtre. Dans la semi-pénombre, en contre-bas, on ne distinguait qu'une pauvre tache sombre qui s'agrandissait et autour de laquelle déjà des silhouettes s'affairaient. Le jeune pompier, tremblant et couvert de sueur, se laissa tomber contre le mur de la chambre. Ses collègues cherchèrent à le réconforter mais il les repoussa machinalement et, d'une voix blanche, chevrotante, regardant chacun l'un après l'autre, il chuchota :
- La salope, elle voulait m'emmener avec elle.
- Allez, mes enfants, si vous voulez vous amuser, mettez-vous en rang pour sortir. Fouad, Arnaud, je vous ordonne de cesser de vous disputer immédiatement ou je vous garde avec moi...
Madame Pasquier examina son petit groupe, jugea que l'ordre qu'elle venait de donner était approximativement respecté et frappa par deux fois dans ses mains. Les enfants s'égayèrent en hurlant dans la cour de récréation. La maîtresse d'école se dirigea à leur suite, sans se presser, dans la direction du gigantesque platane qui projetait sa masse apaisante en plein milieu de la cour, endroit rêvé d'où elle pouvait surveiller ses petits protégés. Elle soupira en arrivant à la hauteur de sa collègue responsable des touts petits qui l'avait précédée et s'exclama :
- Michèle, tu sais, j'en ai plein les bottes aujourd'hui ! Ils m'ont complètement vannée, ces petits anges.
La maîtresse des petites classes, une toute jeune femme blonde qui paraissait encore moins que son âge, soupira à son tour.
- Moi aussi, Fabienne, moi aussi. Je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui mais j'ai bien du mal à les tenir.
- Et encore , reprit madame Pasquier, toi, et sans vouloir diminuer ton mérite en quoi que ce soit, ils n'ont pas cinq ans. Tandis que les miens, ils ont deux ans de plus en moyenne et je te dis pas la galère. Tu sais qu'il y en a certains qui commencent à me tenir tête... Comme ceux des grandes classes... Je ne sais plus quoi faire... Arnaud, lâche Delphine tout de suite ou tu vas être puni ! Mais il est insupportable celui-là, aujourd'hui !
Certains enfants se poursuivaient en hurlant, se rattrapaient, se jetaient dans la poussière malgré les interdictions répétées. D'autres, des filles en majorité, tournoyaient autour d'un dessin de marelle grossièrement ébauché sur le sol. D'autres encore se bousculaient autour du petit toboggan de plastique jaune qui trônait dans un des coins de la cour. L'attention de madame Pasquier fut attirée par ce dernier groupe où il semblait qu'un début de dispute se produisait. Elle hésita puis décida de ne pas intervenir, jugeant que sa présence ne ferait qu'envenimer les choses. Souvent, en laissant les enfants se débrouiller entre eux, ces sortes de petits problèmes se résolvaient d'eux-mêmes. Elle se retourna vers sa collègue et s'apprêtait à faire une remarque quand un hurlement atroce lui glaça le sang. Immédiatement, elle sut que quelque chose de grave s'était produit. Les deux femmes se précipitèrent vers le toboggan d'où les enfants s'enfuyaient comme une volée de moineaux. Près de l'échelle minuscule, le corps d'une petite fille était étendu, agité de convulsions. L'enfant ne criait plus mais émettait une espèce de vagissement ininterrompu, certainement bien plus impressionnant, qui lui venait du plus profond d'elle-même. Sans réfléchir, madame Pasquier se saisit du petit corps et faillit le relâcher quand elle réalisa que l’œil gauche de l'enfant n'était plus qu'une plaie rougeâtre d'où sourdait un liquide vaguement sanguinolent. Tournoyant sur elle-même sans savoir quoi faire, au bord de l'évanouissement, incapable de se rendre compte qu'elle aussi, comme sa collègue, hurlait sans pouvoir s'arrêter, elle finit par se ruer vers la petite infirmerie. Le gardien, arrivé presque aussitôt, eut la présence d'esprit d'appeler le SAMU.
Quelques minutes plus tard, dès que l'ambulance eut quitté l'école toutes sirènes hurlantes, elle rassembla les enfants en présence du directeur pâle comme un mort. Madame Pasquier était encore très secouée mais elle reprenait rapidement le dessus et, du ton le plus détaché dont elle fut capable, elle chercha à savoir ce qui s'était passé. La plupart des enfants, encore sous le choc, sanglotaient et elle les serra contre elle, pleurant à moitié elle aussi.
- Allez, dites moi. Que... Comment...
- C'est Sylvain, madame...
- Il s'est battu avec Audrey...
- Il voulait lui faire du mal...
- Oui, parce qu'elle voulait pas donner sa place au toboggan...
- Sylvain, mais... Comment... Et où est-ce qu'il est Sylvain à présent ?
On le chercha. L'enfant était sagement assis, seul, à l'autre bout de la cour, près de la porte de sa classe. Repoussant les autres enfants en arrière, elle s'approcha doucement de lui. Le petit garçon jouait avec une règle dont une des extrémités était encore maculée de sang et de poussière. Quand il entendit s'approcher la maîtresse, l'enfant releva ses yeux très bleus, fixa la femme interloquée et lui adressa un sourire angélique.
En cette fin d'après-midi du 25 mars, des centaines d'incidents violents se produisirent ainsi à Paris et dans sa banlieue. Très vite, les policiers, les pompiers, les hôpitaux furent débordés. Le CPOA, l'Infirmerie du Dépôt, les services d'urgence, notamment de psychiatrie, des hôpitaux résonnaient des cris de rage et de fureur de centaines d'individus qu'on avait bien du mal à contenir. Les journalistes, toujours à l'affût, n'étaient pas encore présents mais tout le monde savait que cela ne durerait pas. Vers une heure du matin, une "cellule de réflexion" fut réunie à la Préfecture de Police. Devant l'avalanche de rapports provenant des commissariats de quartiers et des hôpitaux, face à la multiplication des appels téléphoniques et des courriels d’alerte, une heure plus tard, le Préfet de Police en personne faisait son apparition. C'était un homme très discipliné qui, immédiatement, au vu de l'ampleur de la crise en perspective et ce d'autant que la situation paraissait se dégrader d'heure en heure, décida de prévenir le Directeur de Cabinet du Ministre. Bientôt, une foule de fonctionnaires représentant toutes sortes d'autorités se pressait à la Préfecture. Le Préfet décida de siéger en comité restreint. Une longue nuit commençait.
Tous droits réservés
copyright 943R3EB
 3 commentaires
3 commentaires
-
Jeudi 27 mars
Larcher passa la tête par la porte de son bureau, l'air visiblement excédé.
- Monsieur Deville n'est pas encore arrivé ?
Isabelle Maurin-Mézeret, la jeune femme blonde qui occupait l'immense bureau d'angle de l'antichambre sursauta, brutalement arrachée à son écran d'ordinateur. Elle releva vivement les yeux vers son patron, soupira avant de répondre :
- Monsieur Larcher, vous m'avez déjà posé la question il y a à peine cinq minutes...
- Donc, il est pas arrivé ?
- Pas à ma connaissance, non.
- Eh bien, il suffisait de le dire, quoi !
La porte claqua. Pensivement, la jeune femme la contempla deux à trois secondes puis revint à son ordinateur mais, presque aussitôt, elle haussa les épaules, se laissa tomber contre le dossier de son siège et, attrapant au passage son paquet de cigarettes, se prépara à sortir. Depuis presque quatre ans qu'elle était la secrétaire de Julien Larcher, sous-directeur de la Banque Populaire de Crédit, elle s'était habituée au caractère emporté de son patron. Elle s'en accommodait d'ailleurs parfaitement, affichant un calme serein en toutes circonstances ce qui était vraisemblablement l'explication de leur relative bonne entente. En fait, elle l'aimait bien, Larcher, et même, quand elle allait plus loin dans l'analyse de leurs rapports toujours strictement professionnels, elle s'avouait parfois en être vaguement amoureuse, phantasme flou dont l'évocation la faisait sourire. Ce qu'elle appréciait par-dessus tout chez lui, c'était cette vitalité, parfois un peu pesante évidemment, qui lui donnait l'impression de participer réellement à la vie de la banque. Suspendant provisoirement sa décision d’aller fumer une cigarette hors du bureau, elle tourna doucement son fauteuil vers la grande fenêtre qui donnait sur le jardin, sur les arbres, sur la vie en somme. Amoureuse n'est pas vraiment le mot adéquat, pensa-t-elle. Disons plutôt que j'aime surtout travailler avec lui. Même quand, comme ce matin, il donnait l'impression de ne pas tenir en place. D'ailleurs, ce matin, tout allait de travers. Un vent bizarre soufflait, presque un vent de panique. Les rares clients étaient odieux, la matinée avait commencé par une panne de l'ordinateur central et ça allait jusqu'à monsieur Deville, le Directeur, lui toujours si ponctuel, au point que c'en était devenu une légende, qui était en retard. De plus de deux heures et sans aucune explication ! Et puis, ces nouvelles à la radio qu'elle avait bien été obligée d'écouter puisqu'on ne parlait que de ça : une vague de suicides, pas moins ! Les journalistes ne savent plus quoi inventer de nos jours, avait-elle conclu avant de penser à autre chose. Dans un nouveau soupir, elle serra inconsciemment paquet de cigarettes et briquet contre sa poitrine. Des suicides. Ca ne risquait pas de lui arriver à elle. Trop calme. Trop raisonnable. Le téléphone de son bureau se mit à sonner. Un coup puis plus rien. Arrachée à son petit moment de rêverie, elle retourna le fauteuil vers l'ordinateur qui clignotait impatiemment.
Dans son bureau, Larcher tournait en rond, incapable de se concentrer. Pour lui aussi, tout semblait aller mal. La réunion prévue à neuf heures avait déjà deux heures de retard. Et pourtant, c'était Deville lui-même qui, avec des airs mystérieux qui lui allaient fort mal, avait insisté. Hier, on aurait pu croire que l'avenir de la société dépendait de cette entrevue sur le sujet de laquelle l'autre était resté obstinément évasif. Et aujourd'hui, l'absence, le silence. Larcher trouvait cette manière d'agir détestable. Lui, il avait horreur de l'imprévu. Il aimait que les choses soient franches, qu'elles aillent vite. Pour la quatrième fois en moins de cinq minutes, il regarda sa montre, conscient de la stupidité de l'acte, de son état d'énervement. Il arracha le combiné de son socle, composa presque fébrilement le numéro de la secrétaire du Directeur, tapota nerveusement le coin de sa table. De guerre lasse, il s'apprêtait à raccrocher quand il entendit enfin la voix de madame Clément, comme essoufflée.
- Secrétariat de Monsieur Deville.
- Madame Clément, c'est Larcher.
- Oui, monsieur Larcher. Non, il n'est pas encore là.
- Mais enfin, j'avais rendez-vous avec lui à neuf heures. Il ne vous a rien dit ?
- Non. Oui, comme je vous l'ai déjà dit, je savais qu'il devait vous voir. Je ne comprends pas. Ce n'est pas dans ses habitudes. Oui, oui. Je vous préviens dès qu'il arrive. Vous pouvez compter sur moi.
Elle avait déjà raccroché. Larcher resta un moment, perplexe, avec le combiné dans la main. Il le jeta plus qu'il ne le reposa. D'abord, on se calme, s'exclama-t-il à haute voix. Il s'assit derrière son bureau, s'empara du dossier sur lequel il travaillait depuis la veille mais n'arriva pas à en lire la première ligne. En réalité, bien plus que l'absence du Directeur, il devait reconnaître que c'était le comportement d'Elisabeth, sa femme, qui le préoccupait. Il n'y comprenait rien. Elle, qui était toujours d'humeur à peu près égale, lui présentait à présent une figure incroyable. Depuis deux jours, ce n'était que mutisme, abattement et pleurs. Brutalement, sans raison apparente. Il avait tout tenté pour savoir ce qui l'affectait de la sorte. Il avait passé deux soirées d'enfer, face à sa femme muette, incapable d'accomplir la moindre tache habituelle et qui semblait ne plus s'intéresser à rien. Au début, il avait attendu que ça lui passe puis ne voyant rien venir, il avait tempêté, hurlé, sans plus de résultat. Il avait alors essayé la persuasion, la gentillesse. Il s'était assis des heures près d'elle, à la serrer contre lui en tentant de la faire parler. Mais elle était restée immobile, un bloc de marbre, avec sur le visage cette expression d'ennui, presque de douleur. Incompréhensible. Le premier jour, furieux, il avait quitté l'appartement en claquant la porte mais, ce matin, cela avait été encore pire, après une nuit entière pendant laquelle il l'avait entendue pleurer. S'il n'avait pas lui-même pris les choses en mains, elle ne se serait probablement jamais levée. Il l'avait difficilement traînée jusqu'à la table de la cuisine puis avait préparé, mal, un café qu'elle n'avait pas touché. Cette situation était tellement inattendue, tellement inhabituelle qu'il avait songé à appeler le docteur Grimberg, l'idée lui en revint soudain. Il reprit le téléphone mais le médecin n'était pas à son cabinet. Oui, c'était bien son jour de consultations mais il avait été appelé pour une urgence. Il ne put que laisser ses coordonnées.
Pour se changer les idées, il décida d'aller à la Comptabilité. Dans les couloirs, l'activité paraissait réduite, le personnel rare. Surpris, il resta un instant à observer autour de lui, sans pouvoir se faire une idée. Avisant le coursier qui passait, les bras chargés de volumineux dossiers, il l'arrêta.
- Eh bien, mon bon Chapuis, qu'est ce qui se passe aujourd'hui ? On travaille pas ?
Le coursier, vieux bonhomme grisonnant proche de la retraite, s'arrêta à sa hauteur.
- Ben, je sais pas, Monsieur Larcher. On dirait bien que certains se sont mis en vacances.
- Quoi, y a une grève des transports ?
- Moi, j'ai rien entendu de ce genre. J'peux pas vous dire. Ecoutez, Monsieur Larcher, il faut m'excuser mais...
- Oui, faites, mon vieux, allez y.
Ce fut à la Comptabilité que sa secrétaire le trouva. Elle avait certainement dû faire tous les services car il ne l'avait pas prévenue de cette visite. Alors qu'il sirotait le café qu'on venait de lui offrir, un aide-comptable s'approcha pour lui apprendre que sa secrétaire le cherchait partout, qu'elle n'avait rien voulu dire par téléphone. Intrigué, il avala son fond de tasse et redescendit vers son bureau. La jeune femme l'attendait près de l'escalier et se précipita vers lui dès qu'elle l'aperçut.
- Monsieur Larcher, vite, il faut rentrer chez vous.
Comme il approchait rapidement, inquiet déjà, elle baissa la voix.
- Votre épouse...
- Quoi, mon épouse ?
- Elle a eu un accident.
- Un accident ? Mais... Que... Comment vous... Qui vous a prévenue ?
- Un homme au téléphone. Un agent de police d'après ce que j'ai...
- La police ! Nom de Dieu de bordel ! Mais qu'est ce qui se...
Plantant la jeune femme, il se rua vers la sortie.
Larcher dut abandonner sa voiture à trois pâtés de maison de son domicile en raison d'un énorme embouteillage tout à fait inhabituel en pareil lieu et à ce moment de la journée. Taraudé par une inquiétude extrême, il ne se posa pas de question et gara le véhicule comme il le put, sur l'emplacement d'une station de taxis heureusement libre. Il s'empara sans y penser de son imperméable et de sa serviette et se dirigea vers son immeuble, courant à moitié. Malgré sa préoccupation, il se rendit compte que, autour de lui, quelque chose n'allait pas. Les chaussées étaient encombrées de voitures, moteurs hurlants mais immobilisées. A l'inverse, les trottoirs étaient presque vides et les rares passants qu'il croisa semblaient tous se hâter vers on ne sait où. Sur le chemin, il entendit plusieurs fois des cris, des bruits d'altercations mais il ne chercha pas à en savoir plus. Une seule idée l'habitait : Elisabeth, que lui est-il arrivé ? Qu'est-ce qu’il s'est passé, nom de Dieu ? Il s'engouffra dans le hall de son immeuble, se dirigea vers l'ascenseur et appuyait sur le bouton d'appel quand la gardienne se matérialisa à ses côtés, le visage ravagé et se tordant les mains.
- Monsieur Larcher, mon Dieu, monsieur Larcher...
- Mais madame Suarez, qu'est ce qui se passe, enfin ? On m'a dit...
- C'est votre femme. Elle a sauté par la fenêtre de votre appartement...
Larcher sentit tout son sang se retirer de son corps. Soudain, un grand calme l'envahit, comme si une brusque tension venait de le quitter. Il se rendit compte que, sans vouloir se l'avouer, depuis le coup de téléphone de sa secrétaire, il avait pressenti quelque chose de ce genre. Il regarda les murs du hall, les yeux embués de larmes. La gardienne lui prit le bras, le serra contre elle.
- Monsieur Larcher, mon pauvre monsieur Larcher, c'est affreux. Je ne sais pas quoi dire. Il faut être courageux.
- Mais elle est... Elle est...
La gardienne hocha la tête en pleurant avant d'ajouter :
- La Police est venue. Ils ne pouvaient pas rester. Ils ont laissé un papier à la loge. Cette pauvre madame Larcher, ils l'ont emmenée à Broussais.
- Mais enfin, comment ça a pu se produire ? Un accident ?
La gardienne secoua la tête négativement.
- Non, on l'a vue hésiter longtemps avant de... Mais le temps qu'on intervienne, c'était trop tard.
- Mais c'est pas possible. C'est pas possible ! Elisabeth, merde, c'est pas vrai...
Plus que la nouvelle elle-même peut-être, c'était la réalisation soudaine de cet acte volontaire qui crucifiait Larcher. Il n'arrivait pas à réaliser. Comment était-ce possible ? Et lui ? Et lui ? Avait-elle pensé à lui ? Pourquoi ne l'avait elle pas attendu ? Comment...
Madame Suarez le saisit par le bras, l'entraîna vers sa loge.
- Venez, monsieur Larcher. Je vais vous donner un petit alcool. Ca vous fera du bien, vous verrez. Venez.
La police avait laissé une espèce de procès-verbal d'où il ressortait qu'il devait se rendre à l'hôpital pour reconnaître le corps. Le corps d'Elisabeth. Tout cela était donc vrai. Ce n'était pas un cauchemar. Il resta prostré sur une chaise inconfortable, dans la petite salle à manger des gardiens, incapable de seulement porter le verre de liqueur à ses lèvres, incapable de se concentrer sur les paroles de réconfort de la femme. Soudain, il secoua la tête, comme pour sortir d'un songe atroce, et, sans dire un mot à la pauvre gardienne qui ne savait plus quoi faire, il sortit de l'immeuble, marcha au hasard. Il s'était mis à trembler sans pouvoir se contrôler, indifférent pourtant au vent méchant de cette journée si grise. Il s'arrêta devant l'entrée de l'hôpital sans savoir comment il avait pu arriver là. Un employé débordé le conduisit dans une pièce en sous-sol, désigna une table de la tête avant d'ajouter :
- Je suis désolé, Monsieur, mais je ne peux pas rester avec vous. Ce matin, on m'appelle de partout. S'il vous plait, repassez à la Réception en partant pour l'identification.
C’était plus qu’étrange pour cet endroit si particulier où les professionnels s’évertuaient au contraire à toujours accompagner les visiteurs dans le difficile processus de l’identification d’un proche mais, si l’idée effleura Larcher une fraction de seconde, son angoisse et son chagrin étaient tellement intenses qu’il se concentra sur le chariot que venait de lui indiquer l’employé. Il s'approcha le cœur battant d'un corps allongé sur lequel on avait jeté une sorte de drap. Il resta un long moment près de la table, incapable de soulever le linge. Juste à côté, il entendait les chuchotements, les pleurs de gens comme lui qui se pressaient autour des tables voisines. Enfin, il tendit un bras. C'était bien Élisabeth. Il toucha l'épaule de sa femme. Déjà presque froide. Il retira vivement sa main et détourna le regard, essuya une larme d'un revers de manche, laissa passer deux ou trois minutes, les yeux fixés sur le carrelage usé de la salle avant de les relever enfin. Élisabeth semblait dormir, détendue, intacte. Il haussa les épaules à cette réflexion banale, cette réflexion stupide qu'on fait presque toujours en pareil cas. Il eut la maladresse de contourner le chariot. La partie gauche du visage de la femme était complètement enfoncée, comme un relief inversé. Cette image allait l'obséder par la suite, hanter ses cauchemars. Il poussa un grognement de douleur et se rua vers la sortie, remonta l'escalier quatre à quatre. Dehors, malgré l'air frais, il n'arrivait pas à retrouver son souffle. Il se remit à marcher droit devant lui. Il était seul au monde. Il ne voulait plus voir personne. Il ne repassa pas par la Réception de l'hôpital.
Larcher tournait en rond dans l'appartement qu'il avait rejoint désespéré, seul havre de tranquillité au sein de cette horreur. Il soulevait des objets, des bibelots, sans les voir. Elisabeth, partout, bien sûr. Ivre de fatigue et de douleur, il se laissa tomber dans le canapé du salon, se saisit du téléphone. Prévenir les parents, il fallait bien. Malheureusement, ni les siens, ni ceux de sa femme ne répondaient. Il laissa sonner des minutes entières. Il aurait voulu soudain partager son chagrin mais il n'y avait personne pour l'écouter. Il oublia le téléphone, reprit sa marche en rond. Il se sentait affreusement seul. Il n'arrivait pas à expliquer l'acte absurde de sa femme. Pourtant, il ne lui en voulait pas. Il avait l'impression angoissante d'être confusément coupable, d'être en partie responsable. Il aurait dû prévoir, être plus présent auprès d'elle. Elle avait probablement voulu lui dire quelque chose. Elle avait souffert sans qu'il se rende compte de la profondeur de son désespoir. Trop tard à présent. Il retrouva des lettres, des photos, s'apitoya sur ce passé déjà presque ancien, imagina des attitudes, une vie, des futurs différents. Il s'aperçut tout à coup que le soir était tombé, voulut allumer une petite lampe de coin qui l'aurait sorti de l'obscurité sans blesser ses yeux, son esprit fatigué, mais elle ne marchait pas. Il mit longtemps à réaliser que l'électricité de l'appartement était coupée. Panne de secteur. Il s'énerva à manipuler tous les interrupteurs inutiles. Par la fenêtre, il put constater qu'une grande partie de la ville était plongée dans la nuit. Pas de circulation à part quelques voitures de police et de pompiers qui se poursuivaient stupidement, dans des sens contraires. Leurs sirènes lui vrillaient les tympans et il porta douloureusement ses mains à ses oreilles. On ne le laisserait donc même pas tranquille ! Au loin, vers l'horizon, par-dessus les toits obscurs, une gigantesque tâche rougeâtre donnait une impression de coucher de soleil. Un incendie ? Ca ne l'intéressait pas. Larcher fut réveillé en sursaut par la lumière soudain revenue. Il se précipita pour éteindre. Il avait eu le temps de voir l'heure à sa montre : presque quatre heures du matin. Il entendit, étouffés, des cris, une bousculade dans l'escalier et pour ne plus subir les assauts de cet univers indifférent, il se jeta sur le lit de la chambre, enfouit son visage dans l'oreiller, s'endormit presque aussitôt dans un sommeil agité, peuplé de fantômes inidentifiables. Le jour, un rayon de soleil agressif le réveillèrent. Il tourna la tête pour fuir mais les souvenirs et la douleur étaient revenus. Il était toujours aussi fatigué.
Tous droits réservés
copyright 943R3EB
 votre commentaire
votre commentaire
-
Vendredi 28 mars
Le Directeur de Cabinet du Ministre de l'Intérieur se racla la gorge avant d'inviter, d'un geste impatient, les participants de la réunion à s'asseoir autour de la longue table de bois noir et remarquablement lisse, apportée en toute hâte dans le lieu, en même temps que le meuble de téléconférence dont l'écran obscur reflétait les contours imprécis des silhouettes. Attendant que cessent les derniers murmures et bruits de chaises, il laissa traîner un oeil fatigué sur les murs de la petite pièce Empire où ils avaient pris place, loin des lambris et dorures des grands salons du Ministère où se pressait toute une population bruyante et affolée. Son regard revint à ses invités, à présent muets et attentifs. Il y avait là une pléiade de hauts fonctionnaires et de sommités de la médecine rassemblés pour ce qui devait être une réunion de crise absolue. Et qui paraissaient s'en remettre à lui comme s'il allait leur apporter une explication, une marche à suivre susceptibles de dénouer cette situation invraisemblable. Poussé par l'angoisse de se savoir tout aussi impuissant que les autres, il ne perdit pas de temps en présentations. D'ailleurs, la plupart des présents se connaissaient.
- Mesdames et Messieurs, attaqua-t-il d'une voix forte qui résonna métalliquement dans le silence absolu, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir bien voulu accepter de participer à cette réunion informelle de mise au point. Je sais combien depuis quelques heures votre emploi du temps est chargé et combien sont nombreuses les sollicitations diverses et toutes aussi urgentes les unes que les autres dont vous faites l'objet. Venons en donc directement à ce qui motive notre présence. Comme vous le savez - qui pourrait encore l'ignorer ? - notre pays est depuis trois jours confronté à une crise sans précédent. Je dis notre pays mais je puis aujourd'hui vous confirmer, comme cela était prévisible, que le problème qui se pose à nous a largement débordé nos frontières, à supposer d'ailleurs, mais rien n'est moins sûr, que le point de départ de la crise se soit situé ici. Monsieur Van der Vilen qui représente parmi nous la Communauté européenne nous en dira quelques mots tout à l'heure. Donc, pour aller à l'essentiel, depuis lundi ou mardi derniers - nul ne sait vraiment -, le pays est l'objet d'une vague soudaine et inexpliquée de violences, violences prenant les formes les plus diverses et dont l'extension ne cesse de croître. Nous devons impérativement prendre, et cela le plus rapidement possible, c'est-à-dire sur le champ, les mesures qui s'imposent. Toutefois, on ne combat bien que ce que l'on connaît, aussi est-ce pour cela que j'ai demandé à plusieurs éminents spécialistes de nous donner leur interprétation de ces événements préoccupants. Monsieur le Professeur Vernay-Chantre, responsable du département des Maladies Mentales de l'hôpital St Anne, va se faire l'interprète de ses confrères et tenter - je dis bien tenter - de nous faire y voir plus clair. Professeur, je vous cède la parole.
Le professeur Vernay-Chantre se leva, tous les yeux se fixant immédiatement sur lui. C'était un homme grand et maigre d'une soixantaine d'années, le visage osseux, au costume impeccablement coupé et dont les yeux incisifs se dissimulaient derrière de volumineuses lunettes. Lui non plus ne perdit pas de temps en formules de politesse.
- Mesdames, Messieurs, mes Chers Collègues, je vais tenter de résumer le peu que nous savons sur ce qui apparaît bien être une nouvelle forme de pathologie mentale. Au préalable, toutefois, je souhaite insister sur le caractère assez hypothétique de ce que je vais dire. Nous n'avons eu ni suffisamment d'éléments, ni suffisamment de temps pour avoir ne serait-ce qu'un début de certitude.
- Et nous n'aurons pas plus de temps, Professeur, coupa le Directeur de Cabinet.
- Hmm, oui, bien entendu, reprit Vernay-Chantre. Voilà. Depuis plusieurs jours, une partie de nos contemporains, dont le nombre semble hélas progresser assez vite, présente des troubles du comportement dans le sens d'une agressivité violente. Une agressivité dirigée soit vers eux-mêmes - d'où un grand nombre de suicides - soit vers autrui, d'où la multiplication d'actes irrationnels, parfois très violents. Pour faire vite, chez ces malades, on note en fait une double possibilité : soit une agitation désordonnée, déstructurée conduisant à des actes de violence imprévisibles, soit, au contraire un état d’abattement extrême confinant à une espèce de profonde dépression dont le sujet ne semble sortir que pour se nuire. Parfois, en quelques heures les deux tableaux se retrouvent chez le même malade. Pour nous autres psychiatres, cela rappelle un peu une maladie que nous connaissons bien et que nous appelons la maladie bipolaire, l’ancienne Psychose Maniaco-Dépressive ou PMD. Mais dans le cas qui nous occupe, nous constatons avec cette affection des différences considérables. D'abord, le rythme de ce que nous appellerons faute de mieux les crises : ici d'une rapidité tout à fait déconcertante, quelques heures le plus souvent, alors que dans la PMD, l'évolution se compte en mois. De plus, au contraire de la PMD, dans la maladie dont nous parlons, il ne semble pas exister de périodes de rémission, spontanées ou thérapeutiques, en tous cas observées jusqu'à maintenant. Afin d’être parfaitement clairs et pour que nous parlions tous de la même chose, nous nous sommes proposés d'intituler cette nouvelle affection - et ceci bien sûr tout à fait provisoirement - SMDA pour Syndrome Maniaco-Dépressif Acquis. Car, et j'arrive là au deuxième élément des plus troublants, si pour la PMD classique on ne connaît pas réellement l'étiologie, la cause si vous préférez, on sait quand même que celle-ci tourne probablement autour de la génétique. Dans le SMDA, rien de tel bien entendu. Il s'agit à l'évidence d'une espèce d'épidémie dont le mode de transmission nous est pour le moment totalement inconnu. Peut-être respiratoire comme dans le SRAS ou la grippe. Ou par simple contact comme avec le virus Ébola.
- Mais alors, comment peut-on se protéger ? s'exclama vivement une femme en tailleur Channel et lunettes d'écaille, sous-directrice de la communication au cabinet du Premier Ministre.
Le professeur Vernay-Chantre se tourna vers elle, l'examina une fraction de seconde avant de laisser tomber :
- C'est bien là que le bât blesse, Madame. Dans l'état actuel de nos connaissances, cela est extrêmement difficile pour ne pas dire quasiment impossible.
Un brouhaha suivit sa réponse et il fut assez malaisé de faire revenir le calme. Vernay-Chantre attendit plusieurs minutes avant de reprendre sa démonstration.
- Il paraît effectivement extrêmement difficile d'envisager une protection parce que nous ne connaissons rien du vecteur : est-il infectieux, et, si oui, quel est l'agent en cause ? Une bactérie semble peu probable mais pourquoi pas un virus ? Dans ce cas, comment expliquer qu'il puisse agir aussi rapidement ? Ou bien s'agit-il plutôt d'une pollution d'ordre alimentaire mais par quel mécanisme et avec quel support ? A moins qu'il s'agisse de tout autre chose, quelque chose que nous ne soupçonnons même pas ? Nous sommes aujourd'hui dans l'incapacité d'apporter une réponse quelconque à ce qui...
- Mais la contagion, la contagion, comment faire pour s'en protéger ? Comment savoir qui est malade ? Comment savoir comment la maladie risque d'évoluer ?
L'interruption était venue d'un homme jeune en costume de velours bleu, à l'aspect vaguement négligé tranchant sur les autres participants mais dont l'anxiété ne faisait que traduire le malaise général. Le psychiatre haussa les épaules sans répondre, l'air désolé. Un silence consterné suivit l'éclat de l'homme au costume de velours. Chacun s'était plongé dans des pensées moroses. Le Directeur de cabinet reprit la parole.
- Continuez, Professeur. Essayez, s'il vous plait et si cela vous paraît possible, de nous fournir un maximum de renseignements fiables - et devant la mimique du professeur Vernay-Chantre - ou du moins les plus probables. Disons, des éléments raisonnablement probables, possibles, sur lesquels nous pourrions travailler car il nous faut absolument discuter un plan d'action que nous devons soumettre à qui de droit...
- Bien, je vais essayer mais je vous demande de ne pas hésiter à m'arrêter si je suis un peu trop technique. Hmm, voyons. A mon avis - à notre avis - il y a quatre points principaux à considérer. Premièrement la clinique, c'est-à-dire la forme que prend l'affection. Deux possibilités : la dominante mélancolique, dépressive, qui conduit le plus souvent le sujet au suicide après une phase de tristesse et de douleur extrêmes. Les malades sont en pareil cas incapables de communiquer, insensibles à toute sollicitation raisonnable venue de leur environnement. Le plus souvent, ils sont plongés dans un mutisme total ; ils restent immobiles, prostrés durant des heures entières; ils ne s'alimentent plus. Parfois, semble-t-il mais c'est plus rare, ils déambulent au hasard; ils se lamentent, pleurent, s'accusent de tous les maux. Exactement comme dans la forme de la PMD que nous appelons l'accès mélancolique. Ils peuvent même aller jusqu'à s'automutiler, acte que l'on peut assimiler ici à un suicide a minima. Ce qui est dramatique dans ces cas, c'est que, outre eux-mêmes, ces malades peuvent être dangereux aussi pour leur entourage, je veux dire leurs proches, leur famille, car ils peuvent chercher à supprimer ceux qu'ils aiment pour leur éviter ce qu'ils s'imaginent être des souffrances atroces. A l'opposé, dans le pôle maniaque du SMDA, ce qui domine est à l'évidence l'agressivité vis-à-vis des autres, de tous les autres. La dangerosité pour l'entourage - quel qu'il soit - est ici maximale : le sujet est en fait en état de démence, au sens de la Loi, incapable de se rendre compte de ce qu'il fait. Il est surexcité, instable, irritable. La moindre contrariété peut entraîner chez lui un accès de fureur terrible, incontrôlable. L'impression du malade, sa vision à lui, est qu'il est supérieur à tout ce qui l'entoure, qu'il est plus intelligent, plus brillant, qu'il sait tout, quoi ! D'où sa fureur, sa violence, si on le contre, si on semble s'opposer à lui, ce qui, soit dit en passant, est une différence de plus avec la maladie bipolaire où l’on sait bien que le malade passe exceptionnellement à l'acte sur autrui. J'ajoute, pour être complet, que, en revanche, comme dans un accès maniaque authentique, il peut être victime d'hallucinations et de fausses reconnaissances ce qui complique encore le tableau. Non, messieurs, si vous le permettez, encore un moment : je voudrais terminer ce petit exposé et, mes collègues et moi-même, nous essaierons de répondre ensuite à toutes vos questions. Bon. Hum, ce qui est à peu près sûr aussi, c'est que dans la réalité ces deux aspects peuvent s'intriquer, ou se succéder. Nous manquons bien sûr de recul pour savoir si certains sujets restent uniquement dans une des deux formes que je viens de décrire schématiquement. Mais, au delà de cela, ce qui est tout particulièrement préoccupant, c'est l'incroyable rapidité du déclenchement de la maladie : quelques heures, cinq, six, parfois moins... Et sans signes précurseurs, du moins identifiables jusqu'à présent par nous... Voilà en gros ce que l'on peut observer, ce que l'on peut dire, de ces troubles qui nous laissent, vous devez bien vous en douter, tout à fait perplexes. Concernant les autres points, ayant encore peu d'éléments, je serai, hélas par force, plus bref. Le deuxième point est donc celui de la transmission de la maladie, on l'a déjà un peu évoqué. Pour le moment, nous en sommes réduits aux hypothèses, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais un élément est certain : la contagiosité semble extrême. Comment ? Vraisemblablement par le contact direct, ceci dans le cas où nous retenons l'hypothèse d'un phénomène infectieux, disons viral. Peut-être la salive. Ou plus exactement les gouttelettes de sludge, c'est à dire, les minuscules gouttelettes de salive que nous produisons en permanence, en respirant, en parlant par exemple. C'est en tous cas la voie de transmission qui nous apparaît à l'heure où je vous parle comme étant la plus vraisemblable mais loin, très loin d'être certaine. D'ailleurs qui nous dit qu'il n'y en a pas plusieurs ?
- Donc, on peut se protéger en portant un masque si je comprends bien, interrompit un homme ventripotent, assis juste en face de Vernay-Chantre et qui avait de hautes responsabilités au Ministère des Affaires Sociales. Le psychiatre le fixa quelques secondes comme pour évaluer l'homme et sa question afin de décider s'il devait répondre sur le champ.
- Oui et non, monsieur. A moins de se protéger en permanence et partout. Mais un morceau de tissu est-il suffisant ? D'ailleurs, et j'en reviens à mon propos, les autres possibilités ne doivent certainement pas être abandonnées. Certainement pas. Je parle des mécanismes de transfert de la maladie, de la contagion. Peut-être le point de départ est-il alimentaire ? Ou allergique ? Ou chimique, ou toxique, à porte d'entrée cutanée, que sais-je ? C'est un véritable casse-tête, nous aurons certainement l'occasion d'y revenir, mais je voudrais à présent évoquer un autre aspect, celui de la thérapeutique. Malheureusement, cela sera court : pour le moment, nous ne connaissons pas de traitement réellement efficace...
Devant le murmure qui grandissait, Vernay-Chantre s'empressa de poursuivre.
- Je veux dire que les drogues médicamenteuses que nous avons utilisées chez les premiers malades qui nous ont été amenés sont très décevantes, de même que les autres moyens classiques, comme, par exemple, la sismothérapie, heu, les électrochocs si vous préférez. A fortes doses, on a des résultats, oui, mais pour un temps très court. Vingt-quatre heures et il faut tout recommencer. Et, entre-temps, nos services se sont désorganisés un peu plus et... mais monsieur le Directeur de Cabinet abordera cet aspect des choses plus tard. Quatrième et dernier point enfin : les réactions des individus à l'affection paraissent variables et assez imprévisibles. Oui, évidemment, la plupart de ceux qui sont atteints le sont rapidement et intensément mais sans que l'on puisse vraiment préjuger de la forme exacte que revêtiront leurs troubles. Mais ce n'est pas cela que je voulais évoquer. Nous n'avons bien entendu qu'un recul infime, moins d'une semaine, pour apprécier, toutefois il semble bien que certaines personnes ne soient pas immédiatement contaminées. J'ai deux ou trois cas en mémoire en vous disant cela. De là à avancer que certains d'entre nous sont peut-être, comment dire ? insensibles à l'agent causal, immunisés en quelque sorte, il y a un grand pas que je ne peux pas, vous vous en doutez, franchir aujourd'hui. Mais l'espoir demeure. Oui, l'espoir demeure, martela le psychiatre, comme pour s'en convaincre lui-même. Espoir pour de tels sujets, bien sûr, mais aussi pour les autres car, soyez-en persuadés mesdames et messieurs, si nous arrivons à comprendre... Voilà, c'est tout pour le moment.
Le directeur de Cabinet frappa deux fois du poing sur la table pour faire revenir le silence.
- Avant d'aller plus avant, je voudrais d'abord remercier monsieur le professeur Vernay-Chantre pour son très clair exposé : même moi, je crois avoir compris tout ce qu'il nous a expliqué...
Avant de poursuivre, il fit du regard le tour de son auditoire. Quelques uns de ses vis-à-vis avaient ébauché un sourire et il se fit la remarque que le simple fait d'avoir décrit, d'avoir essayé de systématiser le mal paraissait avoir détendu un peu l'atmosphère. Le Directeur se tourna sur sa gauche, vers une petite femme brune d'âge moyen qui, depuis le début, était restée droite sur sa chaise, les yeux invariablement baissés sur le bloc de papier vierge et le crayon qu'elle avait trouvés face à elle en s'asseyant.
- Madame Zirkaoui ici présente, qui est une de mes collaboratrices les plus précieuses, va - rapidement, s'il vous plait, madame Zirkaoui - nous dresser un bilan actuel de la situation concernant l'ordre public. Beaucoup d'entre vous savent déjà que la situation est préoccupante mais j'aimerais que nous fassions un point à partir duquel nous pourrons envisager les mesures de première nécessité à adopter. En accord et en pleine collaboration, bien sûr, avec les autorités communautaires et internationales, ajouta-t-il en regardant le commissaire européen.
La collaboratrice du Directeur de Cabinet se leva et sortit de la poche de sa veste de tailleur deux ou trois feuilles de papier qu'elle installa devant elle mais, tout le temps que dura son intervention, elle ne les regarda pas. Elle prit la parole d'une voix tendue, presque émue, et néanmoins parfaitement intelligible. Il ressortait de son exposé que la situation était des plus critiques. En l'espace de quelques heures, la désorganisation de la vie publique, souligna-t-elle avec force, était intense et cela allait en s'amplifiant. Les troubles avaient gagné une grande partie du pays, encore inégaux dans leur intensité mais - tous les rapports concordaient - toujours dans le sens d'une aggravation. Les décès multiples de cause violente étaient innombrables et l'activité du pays était sur le point de se paralyser complètement. Depuis longtemps, les hôpitaux, centres de soin, postes de police, prisons, ne pouvaient plus faire face à l'augmentation rapide du nombre de sujets atteints, d'autant que leurs personnels payaient un lourd tribut à la maladie. Des scènes de pillage avaient déjà été rapportées et les autorités hésitaient à faire monter en première ligne des troupes que l'on ne savait pas réellement comment protéger. Les transports collectifs étaient le plus souvent interrompus, l'électricité venait à manquer à certains endroits, plongeant notamment les centres des grandes agglomérations dans une anarchie qui aggravait le désordre ambiant, et les pompiers ne pouvaient plus faire face aux multiples incendies. Même la presse qui, la première, avait évoqué une épidémie virale - un quotidien était allé jusqu'à parler de SIDA ou d’Ébola psychiatrique -, semblait à présent pratiquement réduite au silence, faute de moyens ou peut-être déjà de compétences. La promulgation de l'état d'urgence était attendu d'une minute à l'autre mais ensuite ? Ensuite ?
La femme se rassit dans un silence pesant. Tous les participants paraissaient ruminer ces informations qui dépassaient leurs prévisions les plus pessimistes. Le Directeur de Cabinet reprit la parole, l'air faussement assuré.
- J'ai déjà évoqué avec différentes personnes, et avec monsieur le Ministre lui-même, quelques grandes orientations dont je souhaiterais que nous discutions. Il va de soi que ce ne sont que des ébauches d'action et que toute suggestion est la bienvenue. D'abord et avant tout, nous devons assurer l'ordre public et... Oui, professeur ?
- Veuillez excuser mon interruption, monsieur le Directeur, mais, mes collègues et moi, nous souhaiterions retourner...
- Assurément, messieurs les Médecins, assurément. Néanmoins, j'apprécierais grandement que l'un d'entre vous reste avec nous. Ses conseils pourraient nous être des plus précieux. Professeur Vernay-Chantre, voulez-vous avoir l'amabilité... Merci.
Il avait déjà repris la parole avant que les autres médecins aient quitté le salon.
- Oui. D'abord, l'ordre public. Monsieur le Ministre de l'Intérieur en a parlé il y a peu avec Monsieur le Président de la République et certains membres du gouvernement : si nous en sommes tous d'accord ici-même, nous avons l'autorisation de faire appel immédiatement aux forces spécialisées de l'armée qui viendront ainsi épauler les différents fonctionnaires de police et les unités spéciales d'intervention urbaine. D'ailleurs, Monsieur le Gouverneur Militaire de Paris, qui est en contact permanent avec la plupart de ses collègues de province, ainsi qu'un représentant de l'Etat-Major, devraient nous rejoindre d'une minute à l'autre. J'ajoute que nous espérons établir sous peu une liaison directe avec les différents responsables de province, notamment les préfectures de régions, déclara-t-il en désignant d'un bref mouvement du menton le grand écran noir auquel il tournait le dos. Nous en saurons alors un peu plus sur l'état en temps réel du pays. Quoiqu'il en soit, il paraît clair que l'ordre doit être maintenu coûte que coûte. Les points que nous devons, entre autres, discuter est comment procéder ? Et également comment protéger les forces d'intervention ? Car ces personnels ne sont bien sûr pas à l'abri et certains d'entre eux ont déjà commencé à présenter des troubles en rapport avec le... la... l'épidémie. Pour le moment, les responsables nous disent avoir la situation globalement bien en main. Mais cette situation évolue rapidement. Peut-être même va-t-elle se dégrader encore dans les heures à venir. Nous devons donc décider - et rapidement - de la meilleure tactique à adopter. Bien. Monsieur Van der Vilen, peut-être quelques mots sur la situation hors de nos frontières et après, nous ouvrons la discussion ?
Tous droits réservés
copyright 943R3EB
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires